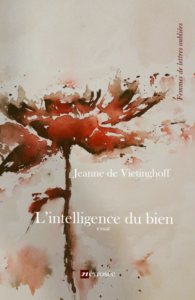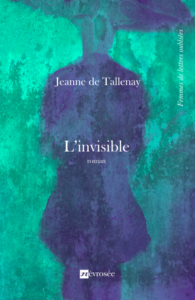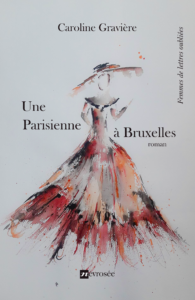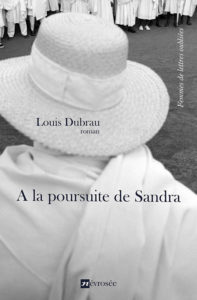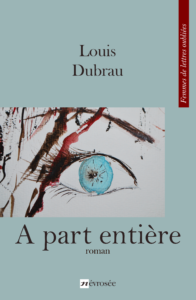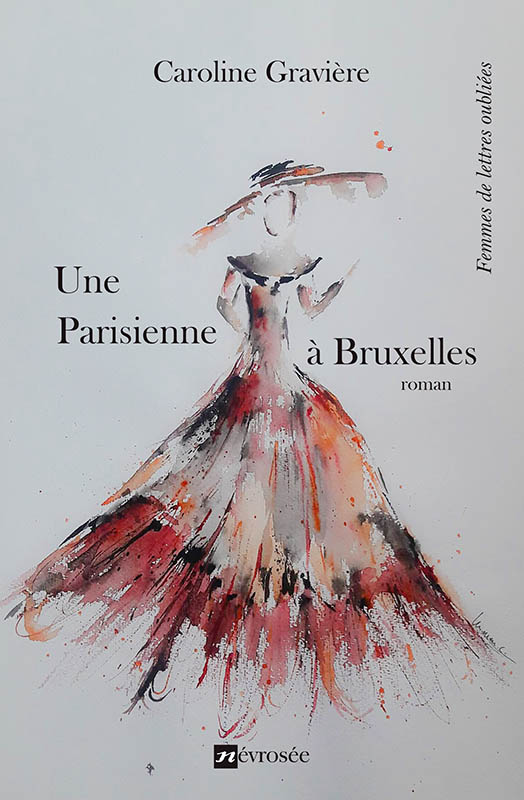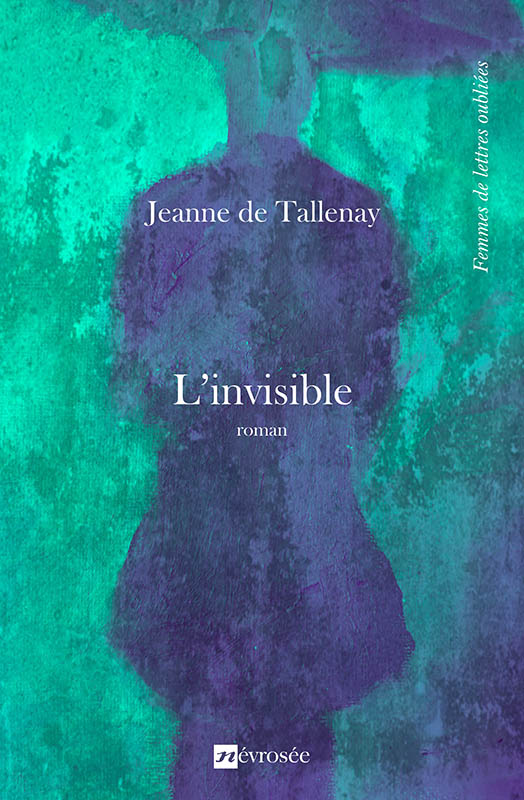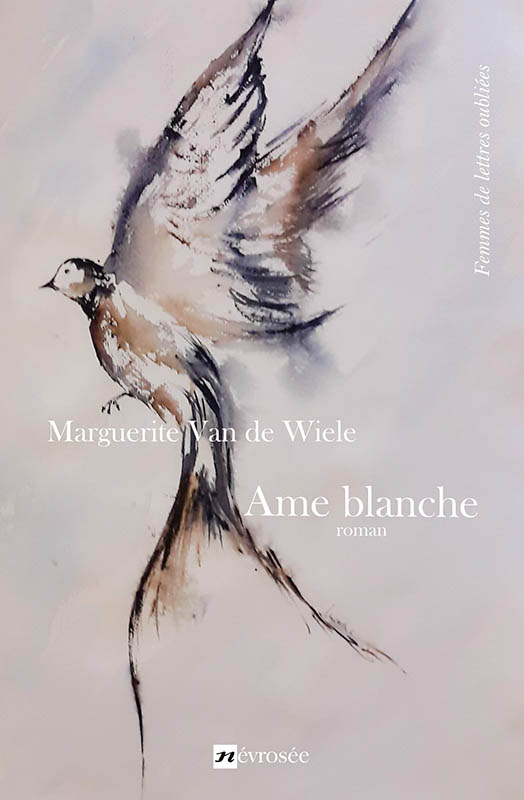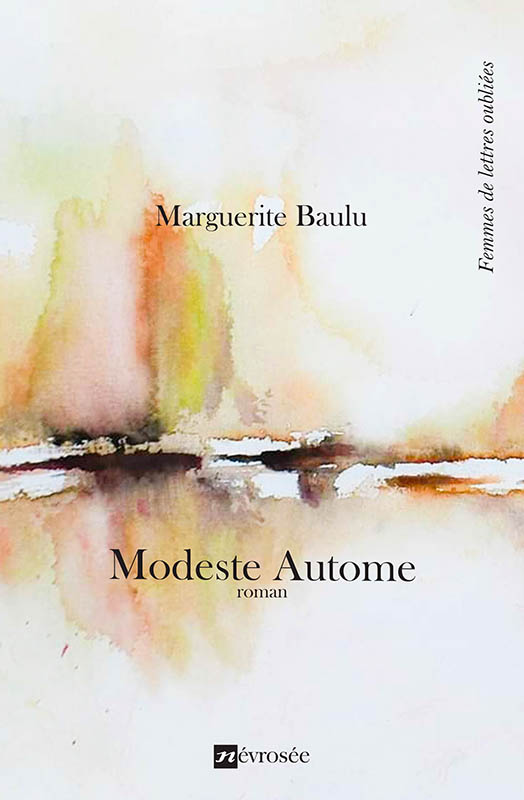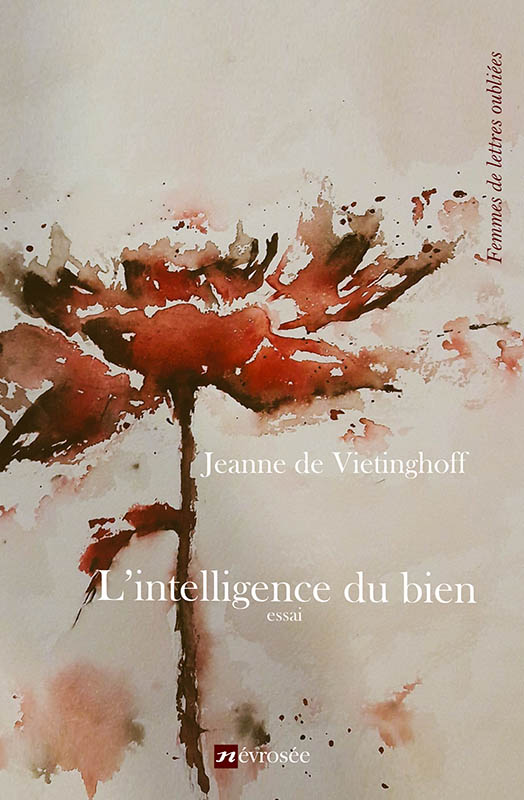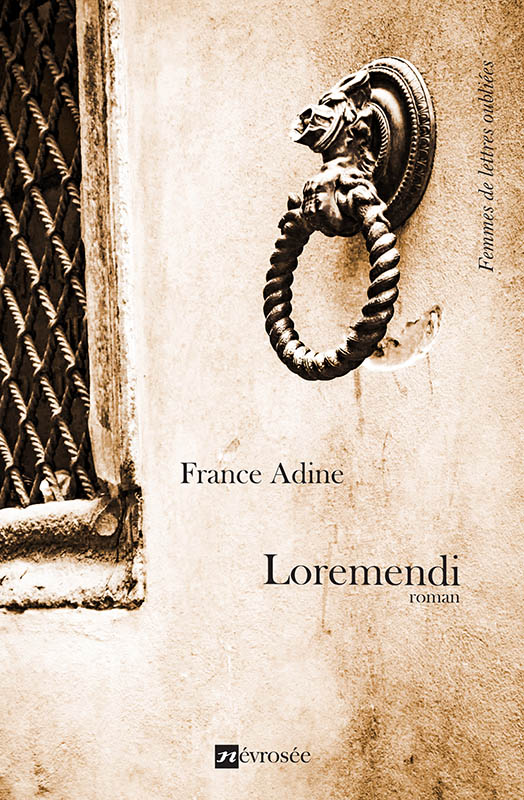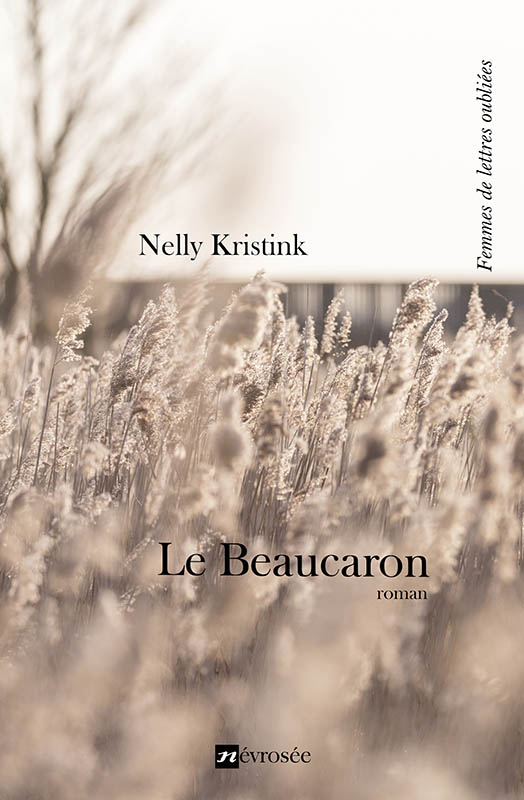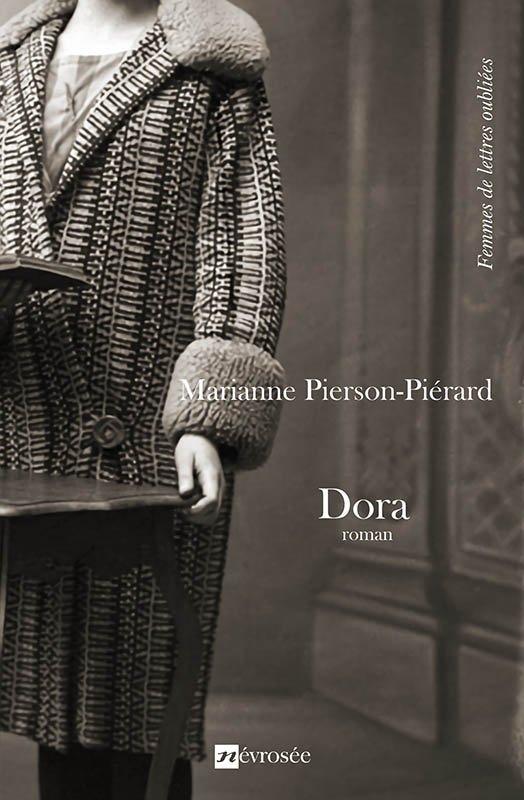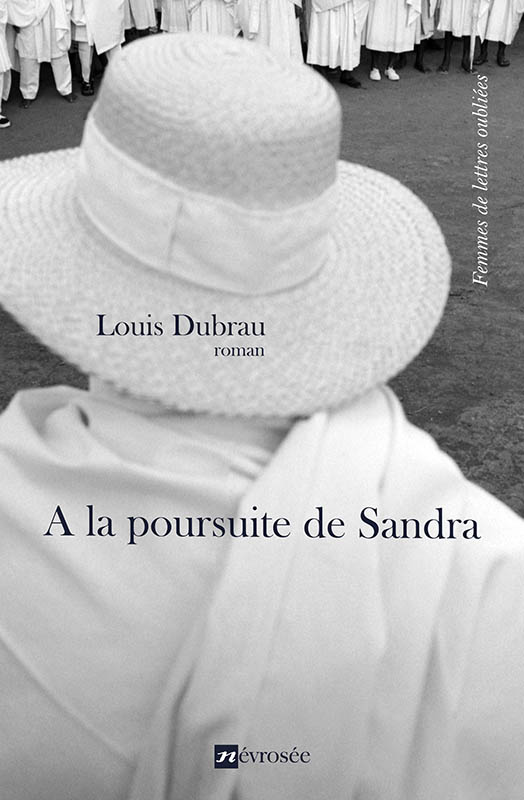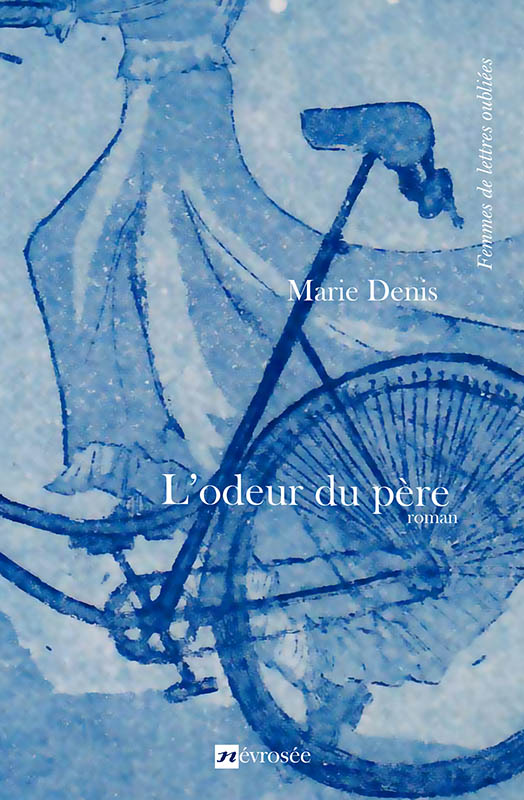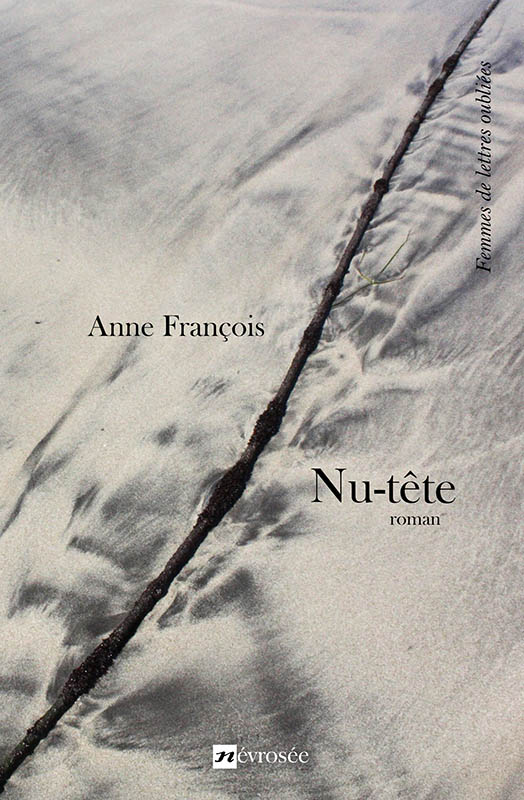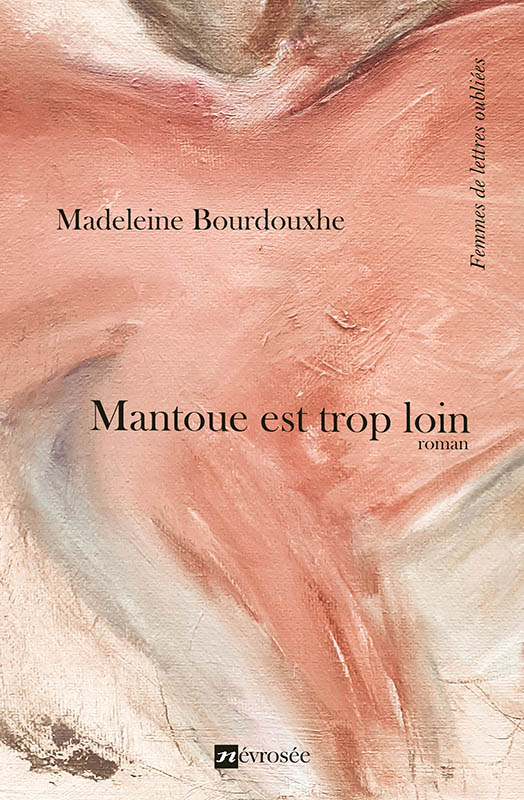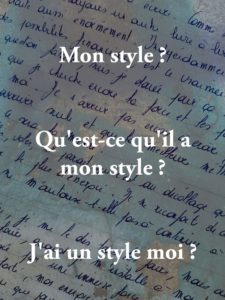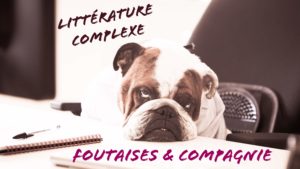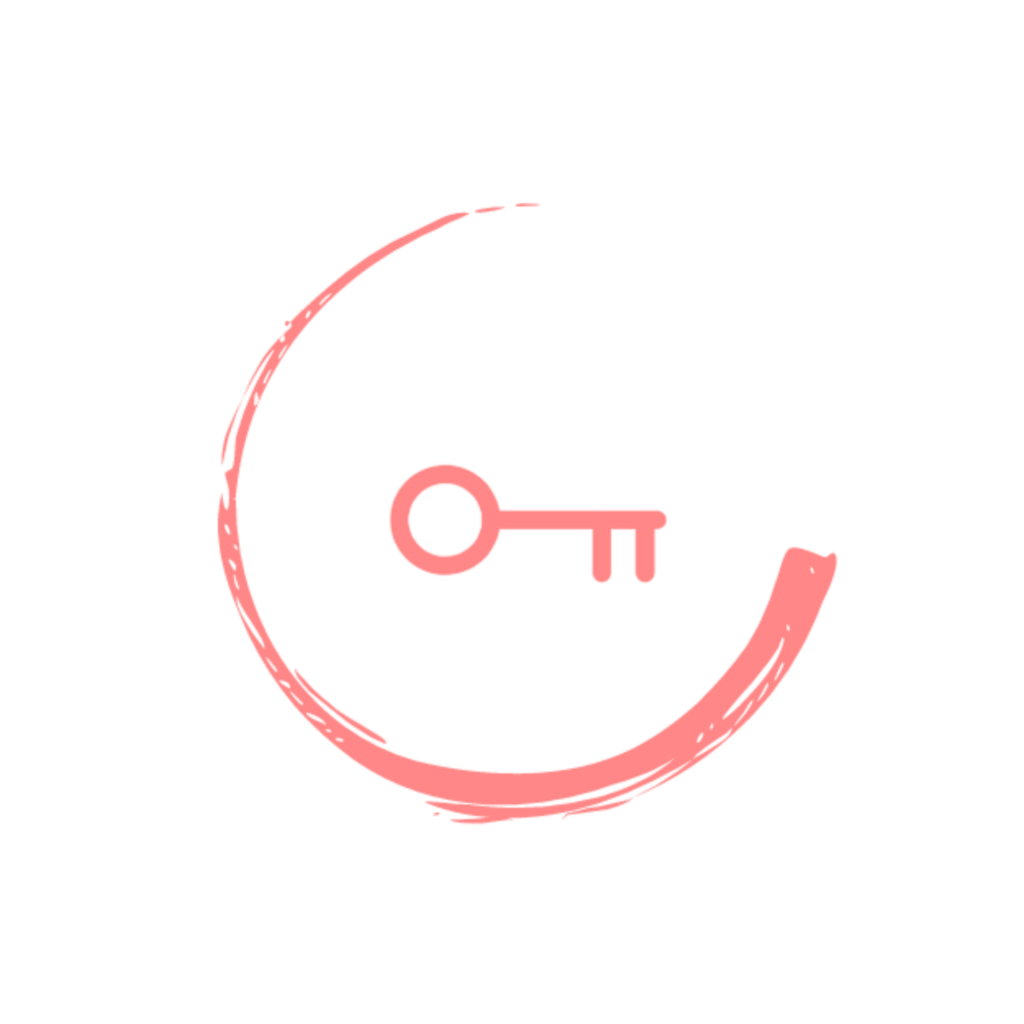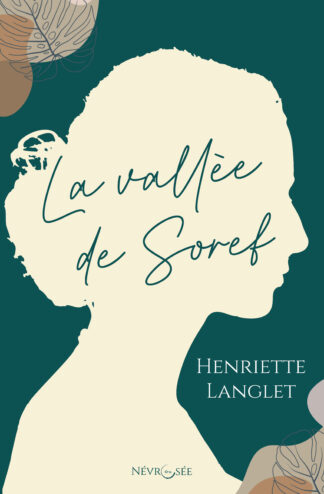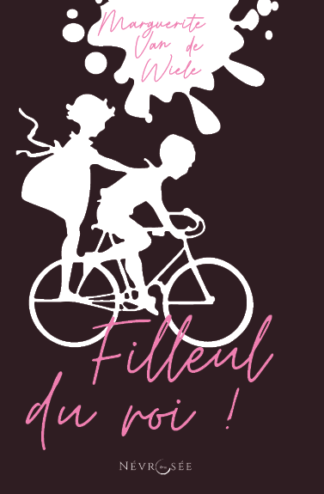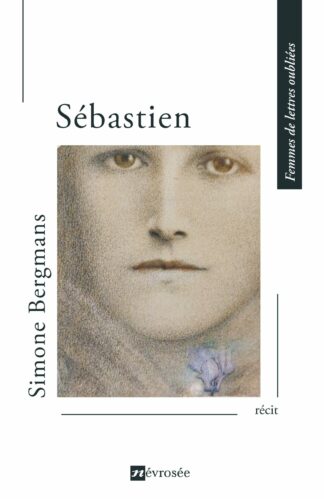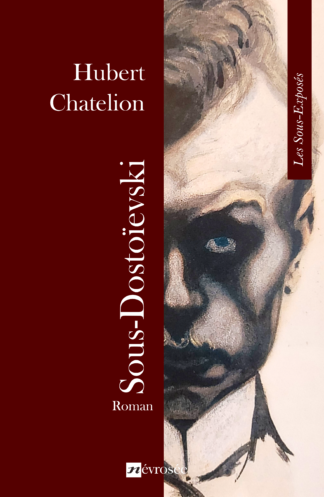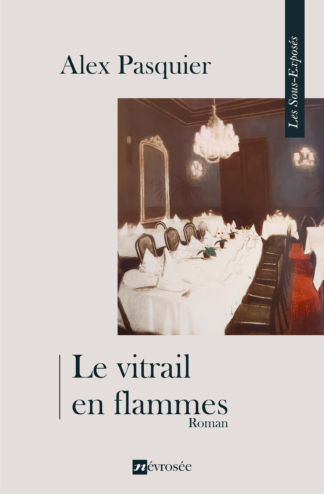La littérature complexe. J’ai entendu ce terme récemment dans une émission radio qu’au demeurant j’apprécie. L’émission parlait du « recul de la littérature complexe ».
Je me demande si je
dois rire ou pleurer. Je suppose que, comme pleurer ne sert à rien, il vaut
mieux rire. Ça n’empêche pas de pousser un petit coup de gueule.
Je ne suis pas la première à le faire. Un auteur bien plus prestigieux et célèbre que ma pauvre personne, Bernard Werber a piqué le sien dans un article paru dans le Figaro : plaidoyer pour une autre littérature. Et si, apparemment, ça ne semble pas faire bouger les choses, ça fait plaisir à lire.
La littérature complexe, mais qu’est-ce que c’est?
Mais que peut bien
être cette littérature dite complexe ?
Ne serait-ce pas une manière hypocrite de désigner ce que d’aucuns considèrent comme la littérature intelligente par opposition à celle qui ne le serait pas.
Quelle prétention. Et quelle suffisance de sous-entendre que le « recul » de cette littérature soi-disant plus intelligente serait le fait de la paresse ou d’un déficit d’intelligence de la part des lecteurs.
Comment ne pas se demander si l’on se pose les bonnes questions ?
Un double discours insupportable
D’un côté, on
stigmatise les gros succès. Les qualifiant d’œuvres faciles ou, je suppose, de
« non complexes » ou de « non suffisamment complexes ». De
l’autre, on s’insurge du désintérêt du public pour cette soi-disant littérature
complexe. Comme si le succès était gage de médiocrité. Mais si c’était le cas,
que seraient devenus Victor Hugo, Zola ? Et puis, si le succès est si
méprisable, les défenseurs de la littérature complexe devraient se féliciter de
ce « recul ». Ils devraient y voir un gage d’intelligence. C’est
mathématique.
Tout ce qui a du
succès n’est pas intelligent
La littérature
complexe n’a pas de succès
Donc la littérature
complexe est intelligente
Alors, pourquoi
s’insurger du recul de la littérature complexe et surtout pourquoi
culpabiliser le lecteur ?
Je sais, le raisonnement est un peu facile. Voir sophistique. Néanmoins, l’absurdité de la situation doit être dénoncée. Parce qu’il est facile de prétendre faire des œuvres « intelligentes » d’un côté et s’insurger du désintérêt d’un public qu’on mésestime de l’autre. Comme il est facile de sous-entendre que le désintérêt du public est une conséquence de sa faiblesse intellectuelle, de sa tendance à se laisser aller à la paresse. Comme il est facile d’utiliser les travers bien connus de notre époque engendrés par les écrans, les réseaux sociaux, la facilité des images, pour critiquer ce qu’on a peut-être soi-même engendré et éviter de se remettre question.
Et si on se posait les bonnes questions?
Plus personne ne
conteste que dans un divorce, les deux parties ont généralement leurs torts.
Plutôt que de s’insurger passivement contre les torts du lecteur, ne serait-il
pas temps, pour les auteurs, les éditeurs et autres professionnels du livre, de
se remettre eux-mêmes en question ?
N’ont-ils pas leur
part de responsabilité dans la situation actuelle ?
Borges, un auteur sur lequel nombre d’auteurs contemporains s’appuient aujourd’hui pour justifier ce qui, parfois, relève du nombrilisme, s’abstienne de rappeler ce conseil qu’il donnait à ses étudiants et sur lequel j’ai déjà insisté dans un autre article :‘si un livre vous ennuie, abandonnez-le ; ne lisez pas un livre parce qu’il est fameux, ou moderne, ou ancien. Si un livre vous ennuie, ne le lisez pas ; c’est qu’il n’a pas été écrit pour vous. La lecture doit être une des formes du bonheur ». Parce que selon lui, lire, c’est chercher un plaisir et un bonheur personnel.
Quelle peut bien être l’utilité de cette dichotomie entre littérature « complexe » et « non complexe ». N’est-ce pas ce genre de discours qui creuse le fossé entre la littérature et les lecteurs ?
Se faire plaisir et faire plaisir au lecteur
Il n’y a pas une manière de faire un livre. Il y a autant de manières de faire un livre que d’individualités. Il est primordial d’arrêter de sous-entendre le contraire. Ou de sous-entendre qu’il y aurait de meilleures manières de faire que d’autres. Si ce n’est que la seule voie possible soit celle de l’authenticité. Encore un héritage de ces génies que l’on cite à outrance et que l’on semble pourtant avoir oublié : un chef d’œuvre c’est un petit peu de talent mais c’est surtout beaucoup, beaucoup de travail. Et j’ai parfois l’impression qu’on néglige le travail au profit de considérations qui seraient plus orientées sur cette prétendue meilleure manière de faire, imposée par certaines affinités. La recette est amère. Elle ne fonctionne pas. Les seuls ingrédients qui comptent sont le travail, et l’authenticité. Le reste n’est que fanfaronnades. Etre authentique et fournir la quantité de travail nécessaire. La seule manière de se respecter soi-même et de respecter le lecteur.
Il y a de la place pour tout le monde. Pour toutes les affinités. Ni les affinités de l’auteur, ni celles du lecteur ne méritent d’être méprisées.
Remettre le lecteur au centre de nos préoccupations
Et si nous nous
mettions à la place du lecteur. Comment ne pas comprendre qu’il puisse se
sentir perdu face à la masse de livres qui sortent chaque année. Il y a plus de
livres que de lecteurs.
De quels outils dispose-t-il pour se frayer un chemin dans cette énormité et s’assurer de trouver un bon livre. Un bon livre pour lui s’entend. Non pas celui qui aura gagné un prix ou qui aura été « validé » par les intelligents. Celui qui lui procurera le plaisir qu’est censée procurer la lecture.
Choisir un livre est
devenu une loterie pour le lecteur. Un jeu dont il sort bien souvent perdant et
qui le conforte dans l’idée que, la lecture, ce n’est décidément pas pour lui.
Mais la lecture est pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde.
Littérature francophone versus littérature anglo-saxonne
Je suis toujours étonnée de constater la différence entre la littérature française et la littérature anglo-saxonne. La littérature française est si prétentieuse, sérieuse et grave qu’elle en devient parfois dégoûtante. Pire. Elle est devenue égoïste. Autocentrée sur ses propres tourments. Elle ne s’intéresse plus au lecteur. S’il ne la comprend pas c’est qu’il n’est pas assez malin, et tant pis pour lui. Parce que, elle, elle fait des choses intelligentes, et elle ne va tout de même pas s’abaisser à penser au plaisir du lecteur.
Mais quelle erreur.
Aurait-on oublié que sans lecteur il n’y a pas de livre ?
La littérature
anglo-saxonne n’a pas cette prétention. Il suffit de regarder la différence de
culture entre l’édition des livres anglo-saxons et celle des livres francophones.
D’un côté, vous avez l’impression d’être à Disneyland. Plein de couleurs, de
différences, d’exubérances même. Du chaos peut-être un peu, mais quel plaisir.
De l’autre, des couvertures ternes, respectant les mêmes codes sobres et
tristes.
Comme si le baroque enlevait un peu de qualité au livre. Comme si se préoccuper du lecteur, lui procurer de la joie, était vulgaire. Quelle gravité ! Et si on arrêtait de se prendre au sérieux ?
Arrêter de se prendre au sérieux
D’où vient dans la culture francophone cet orgueil teinté de honte ? Comme si rire était honteux. Que pleurer serait plus noble. Comme si, les choses intelligentes devaient se mériter et donc forcément être pénibles voir chiantes. Et voilà comment notre littérature est devenue ennuyeuse pour une grande partie du public. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Mais il s’agit d’une tendance que les nouveaux auteurs, perdus au milieu de la masse, se croient parfois obligés de suivre. Oubliant leur cœur, cachant leur honte de préférer un auteur mineur à un majeur. Ayant peur de raconter une histoire. De plonger dans l’imaginaire. Nous sommes ce que nous sommes, arrêtons de tenter d’être autre chose. Assumons nos contradictions. Assumons notre capacité à aimer à la fois Proust et à la télé-réalité. Sublimons le médiocre parce que nous sommes tous aussi stupides que géniaux.
Si la réflexion est
essentielle, le divertissement l’est tout autant. Et non, ces deux activités ne
s’excluent pas. Au contraire. C’est quand elle se confondent qu’elles
obtiennent les meilleurs résultats. C’est un principe général de
solidarité, de nuance, de complémentarité, d’ouverture. Il ne suffit pas de se
battre avec des mots contre le racisme et les inégalités pour avoir la
conscience tranquille. Et agir avec les lecteurs comme ceux contre qui on se
bat agissent avec les migrants : en les rejetant. En les dénigrants. En
les désignant comme responsables de nos propres maux.
Parce que c’est une catastrophe. Avec une telle attitude, le divorce entre littérature et lecteur risque bien de devenir définitif.
Revaloriser la fiction et l’imaginaire
Peut-être le temps
est-il aussi venu de revaloriser les histoires. Le message littéraire passe aussi
par les histoires qui accueillent généralement le lecteur plus qu’elles ne
l’excluent.
Les histoires c’est
pour les gosses ? Nous sommes tous des gosses. Et si les histoires
réveillent le merveilleux de notre enfance, elles ne nous empêchent pas pour
autant de grandir ni de réfléchir.
Revaloriser les
histoires, et l’imagination qu’elles convoquent. La littérature est peut-être
le dernier bastion contre les plaisirs faciles procurés par les écrans. Le
dernier bastion contre ce monde « clé sur porte » dans lequel l’imaginaire
se vautre dans une passivité gavée d’images. C’est l’imagination qui permet la
pensée. Son originalité. Son mouvement. Sans imagination, l’homme n’est plus un
homme. C’est d’ailleurs peut-être ce qui explique le succès que rencontrent
aujourd’hui les livres Fantasy.
Je n’ai rien contre le fait de casser les codes, mais casser les codes, c’est aussi en créer de nouveaux. Et s’y enfermer me semble de peu d’intérêt.
Mea maxima culpa
Je sais que quand je relirai
cet article publié, je me dirai que j’ai manqué de nuance sur tel ou tel point.
Je sais aussi que des gens reviendront vers moi avec des arguments qui me
forceront à pousser ma réflexion plus loin, que ces quelques mots sont trop
simples. Que ma pensée demain aura évolué, dans un sens ou dans un autre.
Qu’elle va se colorer. C’est comme ça qu’évolue la pensée. Assumons-le, les
choses, jamais ne peuvent être figées. Toujours mouvantes. El le beau, le bien,
l’intelligent sont des concepts qui se baladent, avancent, reculent. Personne
ne peut dire à qui ou à quoi ils s’appliqueront demain. Par conséquent, une
critique, un concours ne sont jamais que des avis. Fragiles. Mortels. Ne leur
donnons pas tant d’importance. Si nous nous arrêtons à ce que les autres
décident pour nous, nous ne pensons pas. Nous n’évoluons pas. Nous ne vivons
pas.
Surtout, accordons-nous le droit d’apprécier ce qui est mal considéré.
Quelques bons mots de Bernard pour finir
« Ce qui est nouveau fait peur à ceux qui se sont autoproclamés les «uniques représentants du système littéraire». Ce qui ouvre les horizons donne une impression de liberté difficile à supporter pour ceux qui vivent dans les entraves. Mais pourtant on ne pourra pas tout le temps vivre dans le nouveau roman et la littérature psychologique introspective sentimentale parisienne. Combien de temps les écrivains à la mode arriveront-ils à amuser la galerie avec leurs histoires de coucheries et leurs états d’âme existentiels ?
La littérature d’imaginaire a, à mon avis, une place méritée dans la littérature générale. Ne serait-ce que par respect envers les… lecteurs. »
Plaidoyer pour une autre littérature – Bernard Werber, Article paru dans le Figaro