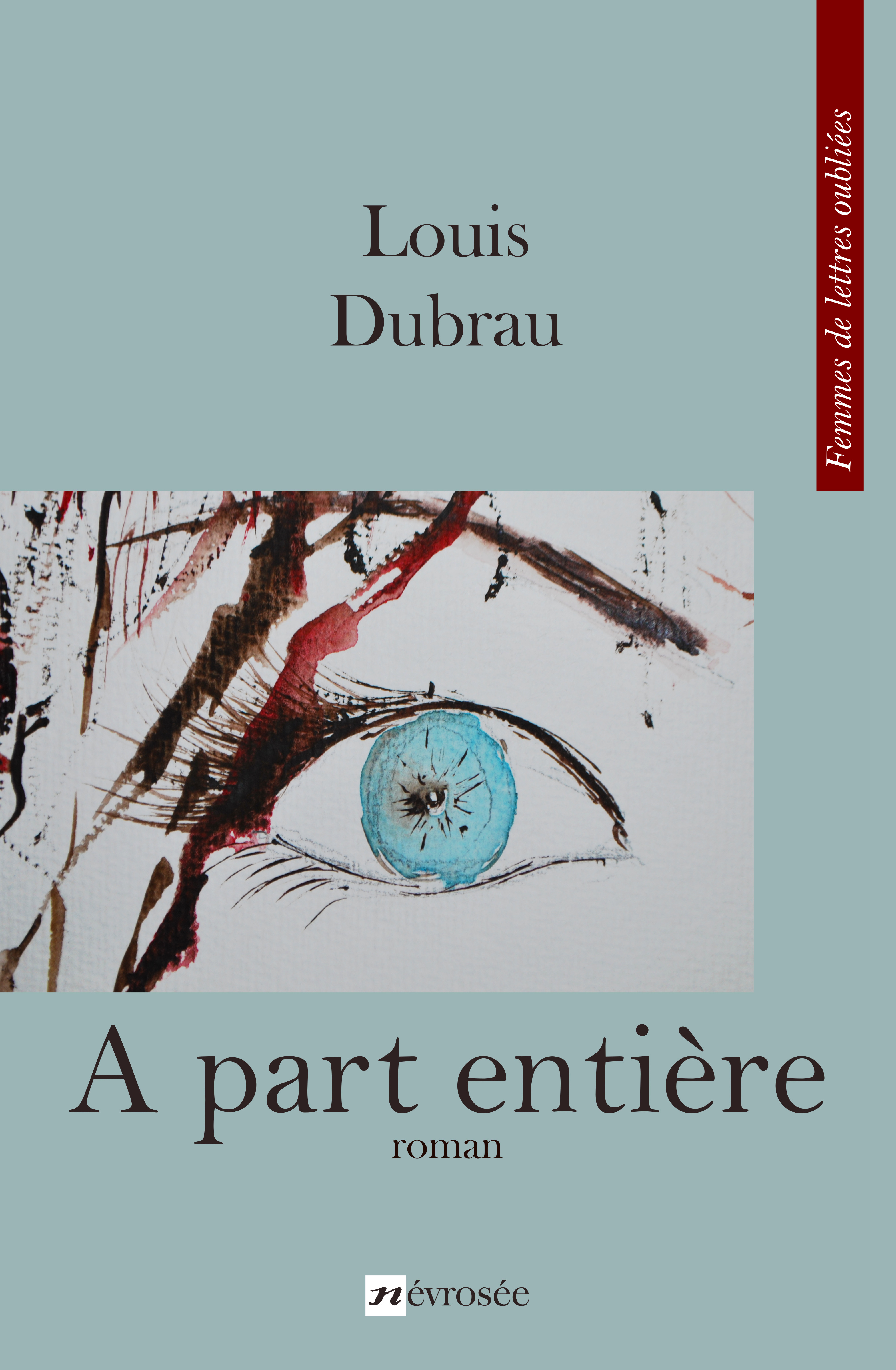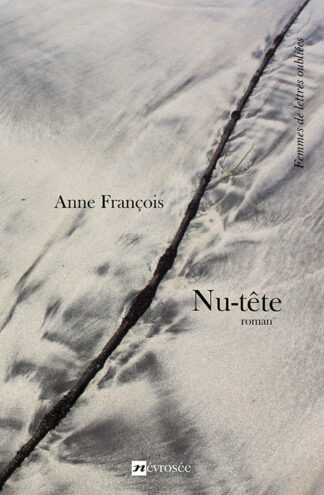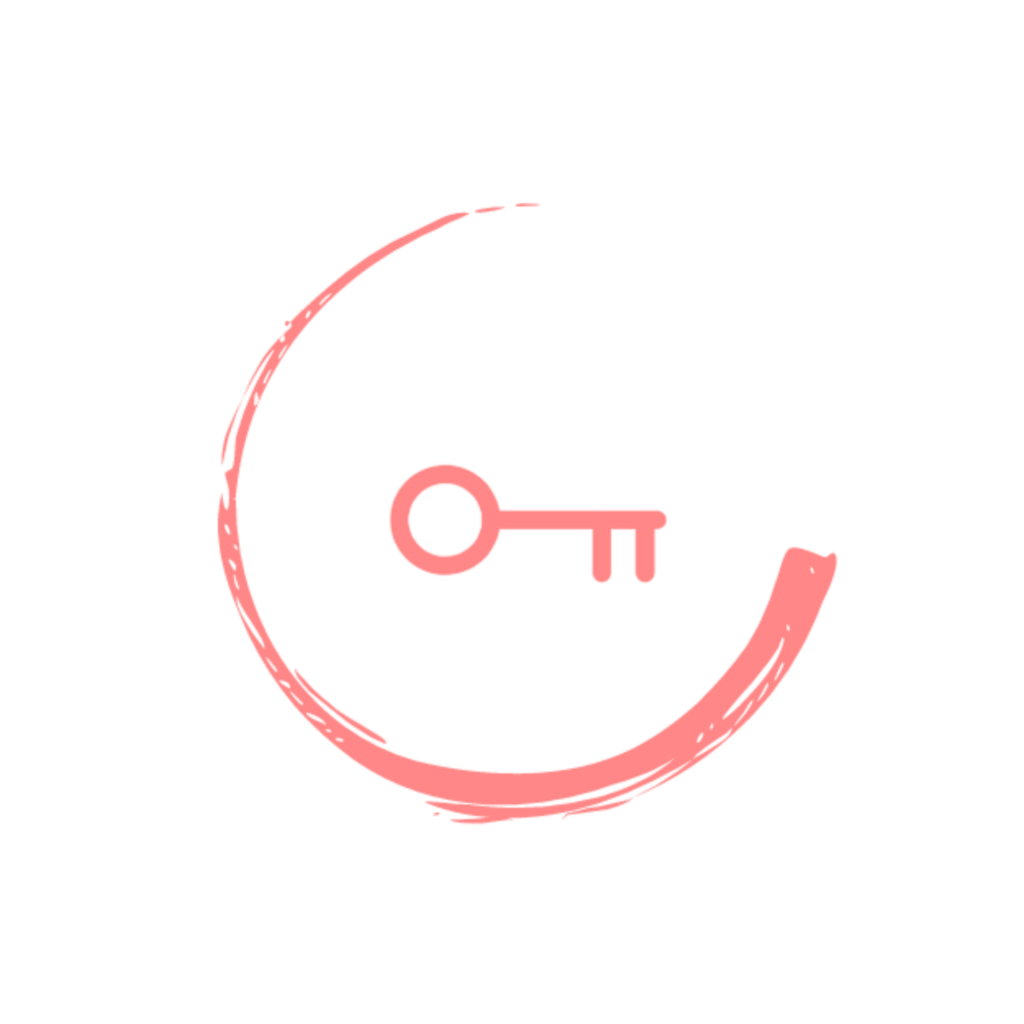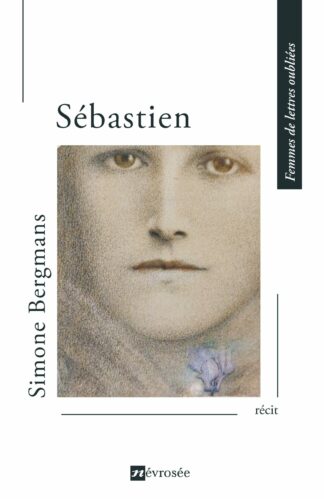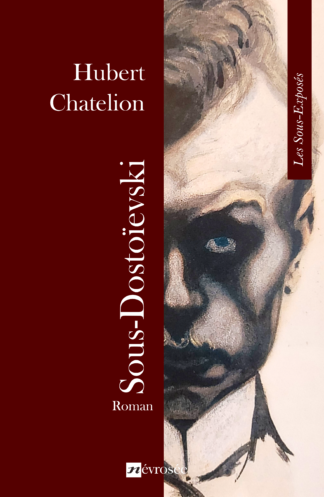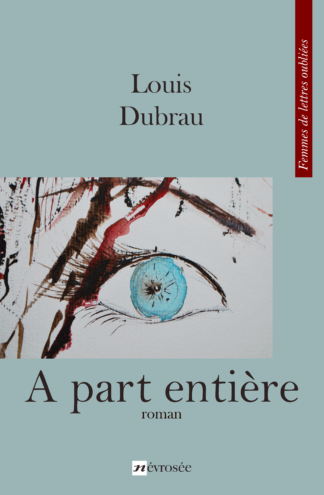I
Elle tomba tout d’un bloc, vint s’écraser entre les deux battants de la grille d’entrée. Une femme hurla, quelques passants s’immobilisèrent puis se ruèrent vers l’endroit d’où partaient les cris.
Elle gisait sans autre désordre que celui de ses cheveux défaits. Du sang lui coulait de l’oreille. Quelqu’un dit : « Elle vit encore, voyez, elle respire ».
Marie ouvrit les yeux. Son regard ignora les badauds rassemblés pour s’attacher à la façade qui se dressait devant elle à la verticale. Dans l’encadrement d’une fenêtre un homme se penchait.
— C’est Guillaume, dit Marie d’une voix étrangement forte. Il m’a poussée…
Un hoquet lui coupa la parole, un flot de sang lui jaillit de la bouche.
— Vous avez entendu ? Elle a dit : il m’a poussée. Un cri jaillit de la foule :
— Assassin !
Des poings se tendirent…
Ces pages, qui feraient croire au début d’un roman policier, je les écrivis d’un seul trait pendant qu’à la police on délibérait sur mon cas, mû par le besoin de rejeter dans l’irréel, dans la fiction, ce que je venais de vivre.
Ce n’était pas Marie dont le corps s’était rompu en s’écrasant sur les pavés, ce n’était pas ma femme qui, avant de mourir, m’avait accusé de l’avoir précipitée dans le vide.
Follement il me semblait qu’en adoptant une attitude détachée de romancier j’enlevais aux faits leur tragique authenticité. Mais une fois que j’eus écrit : « les poings se tendirent », la réalité se rabattit sur moi avec la force d’un soufflet, je me retrouvai parmi la foule vociférante qui m’attendait, massée devant la porte de l’ascenseur. Dieu ! que celui-ci avait été long à descendre ! Au fur et à mesure qu’il se rapprochait du rez-de-chaussée un grondement montait vers moi, comparable au bruit que fait le vent, certains soirs d’ouragan, en frôlant les étendues.
Dans leur hâte de m’écharper, quelques énergumènes tentèrent de l’ouvrir avant qu’il ne se soit immobilisé. Il fallut recommencer la manœuvre. Heureusement pour moi, car je ne sais ce qui serait arrivé si la police n’avait pas été là pour me protéger.
Police à l’intérieur, ambulance au dehors… Les curieux se divisèrent en deux clans. Les uns se précipitèrent au-devant des infirmiers, les autres refluèrent vers moi.
— Assassin ! Salaud !
Quelqu’un me fit un croc-en-jambe et je me retrouvai sur les genoux, les mains piétinées. Un ordre claqua. Le cercle s’élargit. Je pus me relever.
— Ma femme… ?
La main qui m’avait aidé à me mettre debout se resserra sur mon bras.
— Elle n’a plus besoin de rien.
— Qu’est-ce que vous dites ?
Je dus m’accrocher à la grille de l’ascenseur car je la sentis qui vibrait entre mes doigts tandis que la cabine remontait vers les étages supérieurs.
— C’est sans doute l’ouvrier peintre qui va descendre, dit la concierge. Il retouche les boiseries au huitième.
— Il était auprès de moi sur le palier. Nous bavardions. Je l’ai quitté brusquement lorsque j’ai entendu battre la fenêtre du living.
— Un instant.
Le policier se tourna vers la concierge.
— Où est votre loge ?
— Dans le fond du couloir, Monsieur l’Agent.
— Allons-y.
Ouverte sur la cour intérieure de l’immeuble, la loge de la concierge est plutôt obscure. Il me sembla que je la voyais pour la première fois. Je n’avais jamais remarqué le nombre d’agrandissements photographiques qui en garnissaient non seulement les murs, mais les meubles, l’aplat du poste de T.V. et jusqu’à l’appui de fenêtre où un animal empaillé, le cou ceint d’une faveur rose, montrait les dents. À dire vrai, je n’avais jamais bien regardé ma concierge elle-même. Je la découvrais comme tout le reste : incroyable, inattendue, transformée en juge. Il fallut que le policier intervînt pour qu’elle ne refoulât pas l’ouvrier peintre lorsqu’il se présenta. L’homme avait de la couleur sur une aile du nez et dans les sourcils. Il se précipita vers moi.
— Oh, Monsieur ! dire que nous parlions tranquillement pendant que Madame… Oh, mon Dieu !
Je me rappelle mal ce qui suivit. Cette journée ne me laisse guère de souvenirs. Je l’ai vécue comme un somnambule n’ayant d’autre volonté que celle des autres. Ce n’est que lorsque je me retrouvai dans la rue, seul, libre d’aller et de venir à ma guise, qu’une certaine conscience me revint, je pensai que je devais apprendre à ma mère la mort de Marie. Elle avait beau ne pas aimer sa belle-fille, son suicide ne pouvait manquer de la bouleverser. Mais lorsque mère vint m’ouvrir, je vis à son expression que je n’avais rien à lui révéler.
— Ta concierge m’a téléphoné, me dit-elle. La pauvre femme ne savait comment m’annoncer qu’on t’avait emmené.
— Emmené ?
Sans doute me voyait-elle les menottes aux poignets, prisonnier entre deux gendarmes. Je fus un moment tenté de la détromper. À quoi bon ? Elle avait adopté mon drame personnel et l’avait retaillé à ses mesures. En précisant la manière dont les choses s’étaient passées, je ne ferais que gâcher son scénario.
— As-tu suffisamment remercié ce peintre ? me demanda-t-elle.
— Le remercier ? Pourquoi ?
— Tu lui dois une fière chandelle ! Sans son témoignage…
Je ne pus m’empêcher de regarder mère avec stupéfaction. Si je n’avais pas eu d’alibi, aurait-elle pensé que l’accusation de Marie était fondée ? Me croyait-elle capable d’un crime ? C’était tout bonnement effarant. Certains de ses reproches me revenaient à l’esprit. Ils dataient de mon enfance. J’étais sans cœur, vaniteux, égoïste. Mère devina-t-elle le cours de mes réflexions et crut-elle le moment venu de mettre son registre de reproches à jour ?
— Malgré ton goût prononcé pour les aventures, tu n’as jamais rien compris aux femmes, et singulièrement à la tienne.
— Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
— De petites choses, et maintenant cette accusation. Elle me renverse. Je n’aurais jamais imaginé que Marie te haïssait à ce point.
— Marie ne me haïssait pas.
— Tu vas peut-être me dire qu’elle t’aimait ?
— Oui, je crois qu’elle m’aimait.
Le visage de mère s’est brusquement empourpré et j’ai su qu’elle était sur le point de céder à la colère. J’en fus ému. Il y avait quelque chose de touchant dans cette carnation juvénile tout à coup plaquée sur un visage de soixante-dix ans. Elle désavouait l’affaissement des tissus et donnait à penser que le caractère de mère ne portait pas de ride, n’avait pas d’âge. Je lui ai toujours connu de ces fureurs qu’elle domine à grand-peine et qui ont généralement pour cause des problèmes dérisoires. Loin de la servir, elles la déforcent car, une fois son courroux passé, mère se juge payée et ne poursuit aucune action. On peut d’ailleurs l’apaiser facilement, pour autant qu’on ne soit pas trop sourcilleux sur le choix des moyens. Il suffit de placer au bon moment un mot sentimental, un regret bien orchestré. Je m’y suis toujours refusé, non par honnêteté mais parce que le ridicule de ces éclats disproportionnés à leur objet me rend profondément malheureux, m’humilie. Je souhaiterais que ma mère ne cherchât point à en tirer gloire. Mais elle raconte volontiers ses colères comme d’autres les exploitent. Elle les magnifie de telle sorte que jamais personne ne s’avise de lui demander ce qu’elle en a retiré comme avantage.
Une de ses colères légendaires se rapporte à je ne sais plus quel bijou de prix qui lui a été réclamé indûment par une parente après un décès.
— Je lui ai jeté la bague à la tête en disant : « la voilà ; si tu la portes, tu auras du cran ! »
— Et elle l’a portée ? Mère fronce les sourcils.
— Oui, je crois.
— Mais alors ?
— Quoi, alors ? Tu trouves que j’ai eu tort de lui dire ?…
Plutôt que de réentendre l’histoire je m’étais tenu coi, devinant pour la première fois qu’on peut quelquefois être davantage dupe de soi-même que des autres. Cette fois encore la colère de mère s’orienta d’instinct vers ce qui lui permettait, croyait-elle, d’avoir barre sur moi.
— Ainsi, Marie t’aimait ! Il est heureux que je t’aie aimé autrement, car où en serais-tu aujourd’hui ?
— Je vous en prie, mère.
Elle s’approcha de moi, me pris la tête entre ses mains. Je sentis la forme de ses doigts peser sur ma joue, sa bague dont le chaton me griffait la peau.
— Ah, Guillaume, tout ce qui te blesse me blesse aussi. Tu es toujours mon petit. Tu…
Je repoussai brusquement ma chaise, me levai.
— Quoi, tu pars ? Où vas-tu loger ? Pas dans ton appartement tout de même ?
Tandis que je boutonnais mon manteau, mère me suivit dans l’antichambre. Elle était près des larmes, elle bégayait. Mais je n’étais plus capable de jouer le jeu, de la ménager. Son petit ! Voilà tout ce qu’elle avait trouvé ! Un petit de quarante ans passés, qui venait d’échapper de justesse à une accusation de meurtre !
Je sentis un sanglot me monter à la gorge. Qu’avais-je espéré de mère ? Et si je ne pouvais rien attendre d’elle, que pouvais-je attendre des autres ? Je connaissais la moitié de la ville mais je n’avais personne à qui aller me confier avec quelque chance d’être entendu. Des amis ? On a des amis quand on a vingt ans, quand on est tous plus ou moins sur la même ligne de départ. Mais à quarante ans on n’a plus que des relations. Il faut attendre l’âge de la retraite, et que chacun ne puisse plus rien changer à sa ligne d’arrivée, pour retrouver des amis. À qui demander conseil ? À Marie, ai-je pensé, oubliant qu’elle était morte, qu’elle était la cause de tout.
Alors que j’étais sur le point de refermer la porte, mère la maintint entrebâillée.
— Et Célia ? m’a-t-elle demandé. L’as-tu prévenue ? Comment se faisait-il que, de toute la journée, je n’avais pas accordé une seule pensée à Célia, alors qu’elle est ma maîtresse depuis bientôt trois ans ?
La question de mère me prit de court et, me sentant confusément en faute, c’est sur elle que je reportai mon blâme. Qu’elle fût au courant de ma liaison n’avait rien de surprenant, tout le monde l’était, à commencer par Marie. Était-ce une raison pour y faire aussi crûment allusion ?
Cependant mère avait raison ; il fallait que j’apprenne à Célia ce qui s’était passé avant qu’un autre ne s’en charge. Mais le soir venu, quand je me retrouvai seul dans une chambre d’hôtel, je ne pus me résoudre à lui téléphoner. Plusieurs fois je décrochai l’appareil pour le reposer l’instant d’après sur sa fourche. Mieux valait me rendre à l’évidence, reconnaître que je ne souhaitais pas me rapprocher de Célia, que je ne désirais pas l’entendre et moins encore lui parler. Tant pis si elle apprenait la vérité par d’autres. Mon associé la lui dirait peut-être, bien que je l’eusse prié d’être discret.
— Et quand reviendrez-vous à la Galerie ? n’avait-il pu s’empêcher de me demander, une fois son premier effarement passé.
— Dans quelques jours. De toute manière, après l’enterrement.
Nous avions ensuite discuté de la publicité qu’il convenait de faire en vue de la prochaine exposition, et sans doute Michel Marlier devait-il penser que je n’avais ni cœur ni sentiment. Je croyais l’entendre annoncer la mort de Marie au peintre qui exposait en ce moment à la Galerie :
— Il était d’un calme, d’un froid ! Il m’a même rappelé que je devais demander une ristourne à l’imprimeur !
J’étais calme et froid, en effet, tout au moins en apparence.
A la vérité je n’arrivais pas à croire à la réalité de cette journée. Je n’aurais pas été étonné de me retrouver chez moi en compagnie de Marie. La banalité de ma chambre d’hôtel y était pour quelque chose ; elle tissait autour de moi une sorte de cocon. Je me souviens cependant qu’au moment de revêtir mon pyjama je m’irritai de découvrir qu’il manquait un bouton à la tunique.
Je dormis pesamment, sans rêve. Ce fut la stridence du téléphone qui, le lendemain, m’éveilla.
— As-tu dormi ? me demandait mère.
— Oui.
— Eh bien, moi je n’ai pas fermé l’œil. Tout le temps je me disais…
Je n’écoutai plus, répétant seulement à intervalles réguliers : « Entendu… je te rappellerai… ne t’inquiète pas, je ferai le nécessaire… ». Mère avait dû passer la nuit à dresser des listes, à recenser des noms.
— … Il ne faut pas que l’enterrement ait lieu dans l’intimité. Tu aurais l’air d’avoir peur des gens.
Je raccrochai. Je n’avais pas peur des gens. Cependant, si j’avais prévu que, le surlendemain, Célia serait présente à l’enterrement de Marie, j’aurais pris certaines précautions. Lorsqu’elle passa devant moi, je m’efforçai de ne pas rencontrer son regard. J’ai les exhibitions en horreur. Que voulait-elle prouver, attester ? À cause de la foule qui s’y pressait, ces funérailles que j’avais souhaitées simples et discrètes ressemblaient à quelque funèbre vernissage. Je devinais les propos qui s’échangeaient.
— Il n’a pas l’air très affecté.
— Pourquoi le serait-il ? Il ne l’a pas tuée, c’est elle qui a été monstrueuse en l’accusant.
— Elle a seulement dit qu’il l’avait poussée.
— Comme si Guillaume était homme à faire pareille chose !
— Sait-on jamais ? Un jour, pour une vétille, il s’est pris de querelle avec mon mari. Si je n’étais pas intervenue, je vous jure qu’ils en seraient venus aux mains.
— Quoi qu’il en soit, Marie est déjà remplacée.
— Il y a longtemps qu’elle l’est. Il est vrai que, de son côté…
Fort heureusement la pluie se mit à tomber, une pluie rageuse qui s’en prenait au gravier des allées et rebondissait sur les dalles funéraires. Tout le monde s’égailla. Je pus prendre congé des derniers compatissants et regagner ma voiture. Grâce à Dieu, j’étais parvenu à convaincre mère qu’il était préférable à tous égards qu’elle restât chez elle.
C’est au sortir du cimetière que Pierre me fit sa proposition surprenante. Jamais je n’aurais imaginé qu’il pût se soucier de mon sort. J’avais mis sa présence à l’enterrement sur le compte de la curiosité. Apparemment je m’étais trompé. Depuis la mort de Marie il me fallait sans cesse corriger mon optique, apprendre que les indifférents ne sont pas toujours les moins secourables, comme ce ne sont pas toujours les objets chargés de passé qui entretiennent le souvenir. Pierre me proposait de passer une quinzaine de jours chez lui, ce qui tout d’abord me surprit car je savais qu’il partageait avec sa sœur l’ancien appartement de leurs parents. Mais je devais apprendre qu’il possédait, en fraude, un petit flat.
— C’est un peu en dehors de la ville, confortable et discret. Son offre venait à propos. Il avait suffi de quelques jours pour que ma chambre d’hôtel me fît horreur et je répugnais à rentrer chez moi. Je ne m’en sentais pas le courage. J’avais besoin de me réfugier dans un temps mort, une sorte de no man’s land. Le petit flat de Pierre était une aubaine.
J’y aménageai sans grand bruit : une valise, un pain de savon, un peignoir. Le quartier m’était inconnu, j’étais un inconnu pour les gens du quartier. Cet anonymat me donnait l’impression d’avoir chaque matin la possibilité d’incarner une personnalité de mon choix. C’est le regard d’autrui qui nous contraint à être le même que la veille. Les gens que je croisais en chemin ne s’étaient pas encore fait de moi une image précise, n’exigeaient pas que je m’y conformasse. Malheureusement l’illusion durait peu. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la ville, je redevenais prisonnier de mes soucis, je les revêtais comme un uniforme. Le processus était presque toujours le même. Je quittais le petit flat, je traversais la pelouse, et après avoir remonté une courte allée bordée de cerisiers du Japon, j’arrivais en vue du parking où j’avais garé ma voiture. Marie m’attendait là, prête à m’ouvrir la portière pour la rabattre sur mon tourment. Pourquoi s’était-elle tuée ? Pourquoi m’avait-elle accusé ? Que voulait-elle dire en prétendant que je l’avais poussée ? Poussée hors de la fenêtre ? Non, cela je ne le croyais pas. Son accusation devait être autrement interprétée. Je l’avais poussée à… poussée à quoi ? À se jeter dans le vide ?
J’avais beau me torturer l’esprit, je ne parvenais pas à deviner ce que j’avais pu dire à un moment donné de notre vie commune qui justifiât son geste.
Lorsqu’à la mort de mon père j’avais hérité de la salle d’exposition qu’il dirigeait, Marie m’avait aidé à faire de cette Galerie désuète un studio d’avant-garde. Jusque-là on n’y exposait que des œuvres d’amateurs. Si les femmes qui n’ont aucun don particulier sont volontiers poètes, les hommes préfèrent peindre. Tout d’abord ils le font en secret, presque honteusement, puis peu à peu prennent de l’assurance. Que vienne un flatteur habile et les voilà qui se mettent en quête d’une salle où exposer. Mon père était leur providence. Il n’avait pas son pareil pour répondre aux vœux des peintres du dimanche. Sa Galerie portait le nom de la rue où elle était située, ce qui ne compromettait personne. Pour ma part je m’étonnais parfois qu’elle n’attirât pas quelque sociologue désireux de percer à jour le secret de ses exposants. À quel mobile obéissaient-ils ?
Quelques-uns d’entre eux, loin d’être des ratés, occupaient des postes importants dans l’industrie ou la finance. Tous avaient cependant du raté la malveillance camouflée, la clairvoyance. Je devais apprendre en les fréquentant, et surtout lorsque vint pour moi le moment d’en prendre congé, que les ratés sont généralement de bons critiques. Leur sévérité est irréversible. Ils barbouillent pour leur propre compte mais décèlent dans les œuvres d’autrui les facilités et les faiblesses auxquelles ils n’ont que trop cédé eux-mêmes.