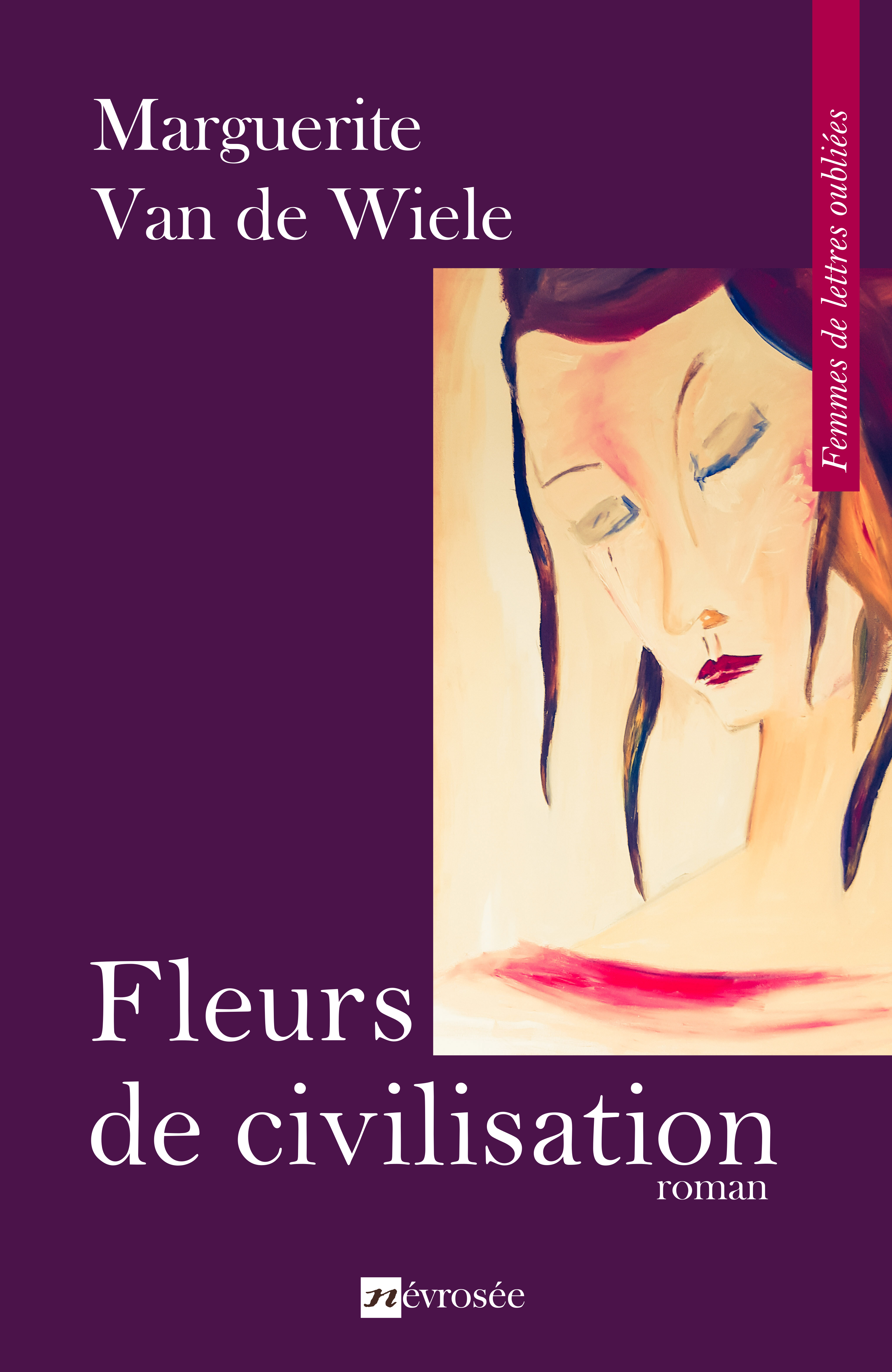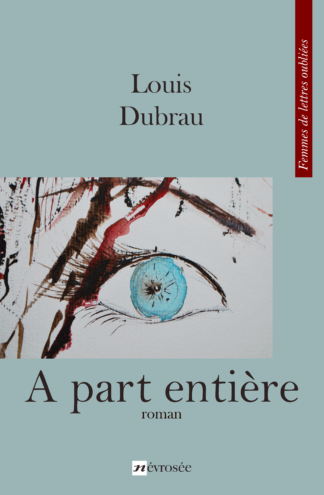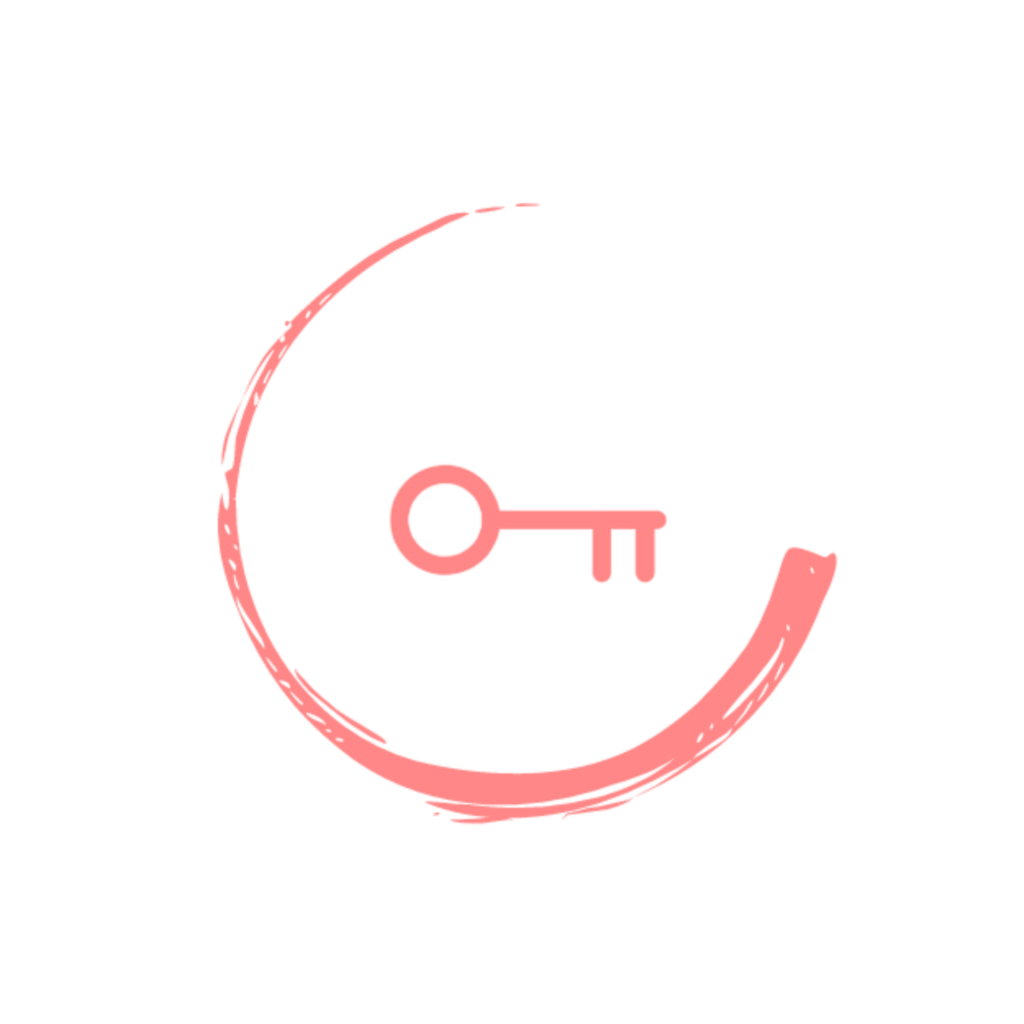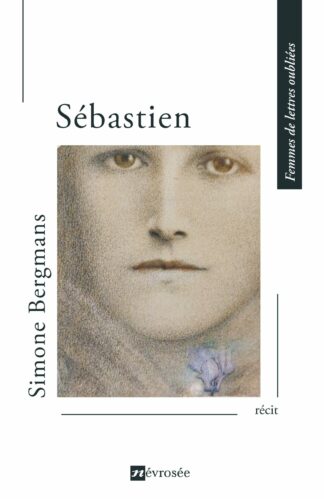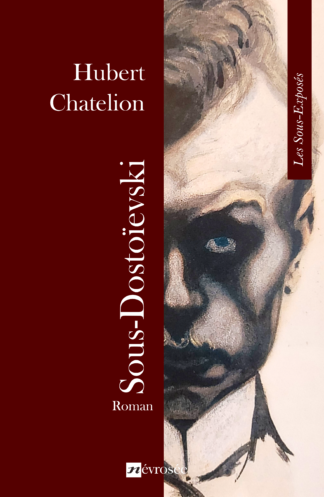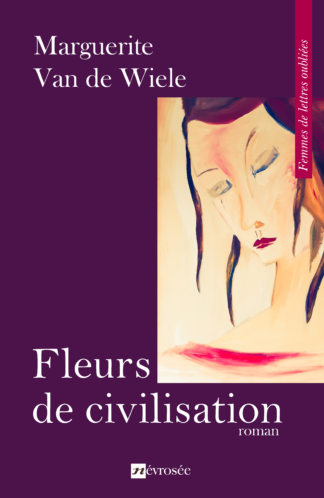I
Les yeux un peu égarés, luisant derrière le fin treillis de sa voilette, une rougeur de fièvre aux joues, Rosiane Meyse, la toute jeune femme peintre dont les débuts passionnaient Bruxelles depuis un an, descendit le Treurenberg, vers la place Sainte-Gudule ; elle allait très vite, sous une de ces pluies d’orage mêlées de grêle, comme le printemps en a aux premiers jours d’avril, et des paroles incohérentes s’échappaient de ses lèvres presque à haute voix, sans qu’elle en eût conscience. À deux reprises, elle joignit les mains, insoucieuse des passants : pourtant, ils étaient nombreux là, à cette heure de midi sonnant qui ouvrait toutes les écoles, tous les ateliers, toutes les administrations du quartier, qui lâchait dans la rue une foule moqueuse, déjà amusée des façons de cette dame dont l’ombrelle de soie blanche – à la vérité peu propre à garantir d’une si grosse averse – demeurait fermée, et qui ne songeait pas même à prendre un fiacre, alors qu’il y en avait une station devant elle. L’attitude de Mlle Meyse était celle d’une femme qui, brusquement, sans réfléchir, se serait échappée après quelque scène troublante, sous le coup d’une vive émotion.
Parvenue devant le portail de l’église Sainte-Gudule, elle eut un étonnement à se trouver là ; peut-être voulait-elle y entrer…, mais un bedeau l’ayant avertie obligeamment qu’on allait fermer, la messe étant finie, elle haussa les épaules avec indifférence.
Elle remontait le parvis, du côté de la sacristie, quand une voix l’accueillit de cette exclamation :
— Vous n’entrez pas chez nous, mademoiselle ? Elle tressaillit comme si on l’eût réveillée en sursaut, fit un pas en avant pour se rapprocher de l’homme qui lui parlait et finit par répondre, avec un pâle sourire hésitant :
— Si, au contraire, c’est chez vous que j’allais, Dirk ; M. Mathys est là, certainement ?
Et, sur la réponse affirmative de celui qu’elle avait nommé « Dirk » – un épais et solide domestique flamand venu à sa rencontre par le Treurenberg – elle songea que ce devait être le désir de voir Edouard Mathys qui l’avait menée, ainsi qu’une somnambule, vers cette rue du Bois-Sauvage, où tous deux s’arrêtaient, maintenant, devant une maison de la Renaissance espagnole, dont la façade était prise, du rez-de-chaussée à la hauteur du premier étage, par la vaste fenêtre d’un atelier d’artiste. Vis-à-vis de cette façade, de l’autre côté de la rue, le mur du cimetière de Sainte-Gudule, désaffecté, était fleuri de giroflées ruisselantes de pluie.
— Comme je suis mouillée ! fit la jeune fille, qui s’en apercevait seulement
Dirk ouvrait la porte de la maison et tout de suite, il l’introduisit dans l’atelier, avec ces simples mots :
— C’est Mlle Meyse. Puis il se retira.
Cet atelier était immense, et une immense toile ébauchée, tendue sur des châssis, en couvrait l’une des murailles contre laquelle un échafaudage était dressé. Rosiane, en levant les yeux, aperçut enfin celui qu’elle cherchait, juché haut sur cet échafaudage et qui peignait.
Edouard Mathys, inspiré et paradoxal, de conception toujours forte et d’exécution par fois très inférieure, était de la taille d’un nain ; il avait la double gibbosité de Polichinelle et une tête sublime d’intellectualité. Son orgueil, qui était sans bornes, lui faisait entreprendre des compositions de trente mètres auxquelles il travaillait avec la fougue d’un pur esprit que les difficultés matérielles embarrassent peu. Penché sur son tableau, le buste en avant, les pinceaux et la palette à la main, si chétif en cette vaste pièce, il faisait penser à quelque insecte aptère, à une de ces actives et frémissantes araignées ouvrant son tissu aérien qui, à mesure qu’il prend de l’étendue, de l’ampleur, semble s’écarter de l’ouvrière et lui devenir plus étranger, par son importance même, par ses dimensions sans rapport avec celles d’une créature si petite.
En le regardant, Mlle Meyse songea que le hasard l’avait bien servie qui la conduisait vers le seul être dont elle eût pu supporter la parole, en la crise qu’elle traversait. Il avait été son premier maître et était resté son guide, son juge, son confident pour tout ce qui concernait leur art. Des souvenirs d’enfance et des théories esthétiques lui revenaient à la mémoire pêle-mêle, rien qu’à le voir, cet infirme épris d’idéal, avec ses longs et soyeux cheveux noirs flottant, comme une crinière, sur ses épaules difformes ; avec ses yeux de flamme, où s’était réfugiée une splendeur incomparable, si lumineuse, si captivante que, le regard de Mathys vous ayant seulement effleuré, l’homme semblait ne plus être qu’une paire d’yeux et, soudain, vous paraissait beau, d’une surhumaine beauté.
— Ma chère enfant, qu’avez-vous ? Interrogea-t-il dès qu’il fut descendu de son échafaudage et qu’il eût contemplé la jeune fille de ses terribles yeux clairvoyants et hypnotiseurs.
— Oh ! Si vous saviez, maître, si vous saviez murmura Rosiane, d’une voix étouffée ; vous allez peut-être me juger bien puérile, bien pusillanime, car ce dont je souffre, ce sont des doutes, des incertitudes…
Elle s’interrompit, les lèvres tordues par une angoisse qu’elle n’avouait pas, de fines gouttes de sueur perlant sous ses bandeaux de cheveux blonds à frisures légères. Puis, comme Mathys lui serrait les mains d’un mouvement de protection émue, elle reprit bravement, avec toute la droiture de son caractère aux sincérités irrésistibles, passionnée pour le vrai :
— Cinq minutes de plus…, du soleil au lieu de la pluie qui attriste, qui démoralise…, le moindre incident capable d’entraver le cours de mes pensées…, et j’aurais eu beau rencontrer Dirk : je passais votre porte, je n’entrais point !
Mathys eut l’air de n’avoir pas entendu. Et il se demandait ce qui pouvait bien faire souffrir cette enfant qu’il savait avoir été presque constamment heureuse : restée orpheline de bonne heure, mais avec de la fortune, mais avec l’affection d’une parente qui l’avait prise chez elle en applaudissant à ses goûts artistes aussitôt qu’ils se manifestèrent, Rosiane, semblait-il, ne connaissait de la vie que les côtés riants. La mort des siens était arrivée quand elle était trop jeune pour sentir l’immensité de cette perte et, depuis, Mlle Kinna Meyse, sa tutrice, s’était si tendrement appliquée à lui tenir lieu de père et de mère qu’elle y était à peu près parvenue. Bien mieux, il se trouva que cette vieille fille appelée par Rosiane : « Ma tante » – mais dont les liens de famille avec elle n’étaient positivement démontrés que par la similitude du nom – il se trouva que cette vieille fille avait un esprit supérieur et admirablement organisé pour comprendre l’enfant d’élite dont elle prétendit faire l’éducation. Toute petite, Rosiane dessinait dès qu’on lui laissait aux doigts un crayon et du papier ; les murs de la maison, les portes des appartements, le sapin blanc des tables de cuisine lui remplaçaient parfois le papier ; et Mlle Kinna, loin de blâmer, s’émerveillait, disant à sa pupille :
— Continue, mignonne ; c’est très bien, cela !
Quand elle eut dix ans, Mathys lui-même, le hautain, le raffiné, le méprisant, lié avec Mlle Kinna et qui avait suivi les progrès de cette fillette, consentait, à devenir son maître.
Malgré son affranchissement de toute coterie, malgré son indépendance d’esprit, il n’était pas de ces peintres qui jugent l’étude inutile aux jeunes gens touchés de la vocation. À ceux qui, hostiles à l’enseignement académique, s’écriaient devant lui :
— Mieux vaudrait fermer les musées et les écoles d’art, car, quel besoin nos artistes ont-ils de connaître si exactement l’œuvre fournie par d’autres avant eux ? Ne la leur montre-t-on pas trop abondamment, et ce lourd bagage de souvenirs n’est-il pas aussi souvent une gêne pour eux qu’un secours ? Ne serait-il pas plus sage de leur servir simplement quelques leçons techniques, puis, de les abandonner à leur sentiment intime, de les laisser voler de leurs propres ailes, sans parachute, en s’inspirant uniquement de la nature ?
Mathys répondait :
— Pour pouvoir rendre plastiquement ce que nous sentons en présence de la nature, il faut d’abord connaître le métier de l’art par nous choisi…, et, pour cela, la connaissance de ce que les autres, tous les autres, firent avant nous en cet art n’est pas superflue. Certes, l’inspiration naïve, primesautière, ingénue, l’inspiration des gothiques, par exemple, si l’on possédait le moyen de la faire renaître, le mieux serait de la laisser agir sans y rien ajouter. Malheureusement, les grandes époques d’art ne fleurissent pas spontanément ; elles procèdent de lois constantes, étroites, formelles et sans l’avènement du christianisme, l’ardente foi en une religion à peine affranchie, il est très probable que l’art gothique ne serait pas ou serait autrement. Pour le faire revivre, il faudrait, d’abord, nous retrouver absolument dans les conditions matérielles et morales des iconographes de l’époque, et cela est irréalisable. Je comprends le regret de ces temps de parfaite santé intellectuelle, où le praticien créait son œuvre candidement, instinctivement, comme l’oiseau chante, sans souci d’imiter un passé dont il était ignorant, sans préoccupation d’aucune règle : c’était l’âge d’or de l’art. Mais, avons-nous le choix du moment où nous-aurions aimé vivre ? Et puisque nous ne saurions plus être des impulsifs et des naïfs, ne serait-ce pas le meilleur moyen de nous élever, à notre tour, que de tendre très volontairement vers une formule esthétique réfléchie, habile, superlativement ingénieuse, qui aurait l’esprit de notre temps, son génie, sa particularité ? Si l’art moderne doit avoir quelque originalité, s’il doit apporter sa note caractéristique dans l’histoire artiste de tous les temps, ce sera certainement à force de science. Le comprendre serait la sagesse suprême, et la fin du XIXe siècle se distinguerait par-là bien mieux qu’en s’obstinant vers un retour en arrière décevant et stérile.
Et Mathys avait coutume de conclure sur ce mot de Pascal :
— « Toute la suite des hommes pendant le cours des siècles doit être considérée comme un seul homme qui subsiste toujours et apprend sans cesse. »
— Cet aphorisme, disait-il encore, me parait excellent à méditer pour l’artiste contemporain si copieusement renseigné sur la manière de concevoir et d’exécuter de ses prédécesseurs et qui, pour en profiter, n’a qu’à regarder autour de lui. Par exemple, une fois qu’il sera devant la saine, la divine, l’éternelle nature, qu’il s’occupe à la rendre telle qu’il l’aura vue et non à travers des souvenirs de chefs-d’œuvre. Les chefs-d’œuvre doivent aider à son éducation technique, rien de plus. Mais cette éducation est nécessaire, je persiste à le croire.
Il le croyait avec une violente énergie et une disposition invétérée au prosélytisme. Aussi, à seize ans, Rosiane entreprenait, sur les conseils de son maître, des études qui firent du bruit en Belgique, car elle ne se contenta point d’imiter les demoiselles amateures dont l’ambition s’arrête aux tableaux de natures-mortes, de fleurs, d’accessoires, mais voulut d’une éducation plus sérieuse et, bravement, s’attaqua à la plastique humaine et à des travaux d’après le modèle vivant.
La vocation s’était révélée chez elle si impérieuse et son talent donna vite de telles promesses que, rompant avec les habitudes antiféministes encore en usage à cette époque, l’école des beaux-arts de Bruxelles consentit à lui ouvrir ses portes. Là, elle reçut pendant des années les leçons, toutes les leçons, des jeunes gens qui se destinent à la peinture… ; et elle se montrait si bonne camarade avec eux, si enjouée, si charmante malgré une dignité très haute et même un peu ombrageuse, que les plus disposés à la moquerie hostile avaient fini par l’aimer, d’une de ces amitiés enthousiastes et profondes comme l’extrême jeunesse en voue parfois à ce qu’elle admire et estime.
En même temps que ses études à l’école de la rue du Midi, Mlle Meyse en continuait d’autres dans l’atelier de Mathys, ce même atelier où ils se trouvaient maintenant et où, si souvent, ils s’étaient plu, tous les deux, à des conversations élevées et délicieuses dont ils jouissaient en intellectuels délicats pour qui l’art seul existe, qui ne voient au monde que la poursuite de leur rêve.
C’était Mathys qui avait formé Rosiane, se bornant d’ailleurs à développer en ce vierge cerveau tout ce que la nature y avait semé d’exceptionnel et de rare. Il avait eu sur elle une influence énorme, le savait et en arrivait à conclure qu’une déception d’artiste était, sans doute, ce qui la mettait dans l’état où il la voyait. Tout ce qui est de l’ordinaire préoccupation des jeunes filles, la devait laisser froide, car il l’en avait détournée ; et il professait sur les choses essentielles de la vie des préceptes extraordinairement simplistes, étroits, absolus, que son élève partageait certainement :
— L’artiste, voyez-vous, ma chère, avait-il coutume de lui dire, l’artiste est un monstre au point de vue physique ; nous sommes des êtres modifiés dans notre espèce et dans notre race, chez qui toute matière s’est changée en matière cérébrale : le prodige et la merveille de la civilisation qui s’est avisée de vouloir faire de l’animal-homme autre chose qu’un animal. Entre notre ancêtre, le bipède des temps primitifs, et nous ; il y a toute l’échelle de l’Humanité gravie et nous trônons au degré supérieur, à de telles altitudes qu’il ne faut pas songer à aller au-delà : ce serait la mort. Considérés par rapport au type, nous-mêmes, nous sommes déjà des phénomènes peu sains. L’artiste est un esprit, une flamme, le chef-d’œuvre de l’artificiel dans l’espèce zoologique ; les lois de la nature ne sauraient plus lui être appliquées et il a fini de les subir. Ainsi, on parle de l’amour, en le déclarant inévitable, fatal pour tous : je n’ai jamais été amoureux, moi, et vous non plus, vous ne serez jamais amoureuse, j’en jurerais. L’amour ?… Mais c’est la normalité, cela ; c’est l’instinct naturel dont la satisfaction doit produire la perpétuité de l’espèce et nous l’avons déformé, cet instinct, pour la satisfaction de créer des œuvres dont nous espérons cette extravagance : la perpétuité de notre nom devenu immortel ! – Ah ! bien, oui, la normalité… quand nous sommes aussi loin de l’état normal que les roses devenues bleues par l’ingéniosité des chimistes !
Rosiane souriait de ces exclamations de son maître, tout en étant fort disposée à lui donner raison car elle ne se connaissait alors de passion que pour la peinture, et l’amour a des réalités physiques qu’elle devinait répulsives à son sentiment trop subtil, presque maladivement affiné par l’art.
Après des années de bon travail soumis à des théories peut-être un peu surannées à l’Académie, peut-être un peu subversives chez Mathys ; après des voyages aux pays classiques de l’art et l’étude raisonnée des maîtres, Mlle Meyse remportait tout d’un coup, à un Salon des Champs-Élysées, un éclatant succès, et son Van Artevelde y obtenait la médaille d’honneur : il la méritait. Rosiane avait choisi dans l’histoire du plus populaire des tribuns flamands ce moment pathétique où après avoir vainement harangué, de sa fenêtre, la foule vociférante qui l’accuse d’avoir fait passer le trésor de Flandre en Angleterre, il descend au milieu des mutins, seul, sans armes, front découvert, paisible et serein, malgré l’orage grondant et la hache de Gérard Denys déjà levée sur sa tête. La jeune fille, dont les préceptes scolaires trop conventionnels s’étaient toujours trouvés contrebalancés par ceux de Mathys, avait su mettre en cette composition historique, correcte selon les règles d’un classicisme un peu étriqué, de la vigueur et de l’intérêt. Son Van Artevelde avait une magnanimité, un calme surhumains devant la populace déchaînée, et une émotion se dégageait de la scène qui, irrésistiblement, allait de ce tableau au spectateur. Acquis par le gouvernement, un peu pour son mérite, beaucoup pour le patriotisme de son sujet, et mis en belle place au Musée de Bruxelles, il sacrait Rosiane Meyse « grand peintre », selon la tradition, à un âge où cela pouvait paraître prodigieux. Aussitôt, ce fut pour cette presque enfant la célébrité et toutes ses griseries : on ne parlait que d’elle ; les reporters lui demandaient des interviews et les « illustrés » publiaient son portrait, tandis que le Van Artevelde, reproduit en lithographie et en photogravure, s’étalait aux vitrines des marchands d’estampes. Mais comme elle avait une imposante popularité parmi ses anciens condisciples de l’Académie, le chaleureux dévouement de tout un groupe de jeunes, ce qu’on appelait « la bande de Rosiane Meyse » et qui lui constituait une force, ce rapide succès l’avait laissée heureuse, presque sans adversaire et avec de si nombreux amis dans la presse que la combattre eût été la pire des fautes pour ceux qui auraient voulu la desservir. Aussi, on ne la combattait point, on l’admirait sans trop l’envier ; son réel talent, son sexe, sa jeunesse lui faisaient une place à part. Et elle fut décorée à vingt ans, sans que personne y trouvât à redire, bien que ce fût extraordinaire.