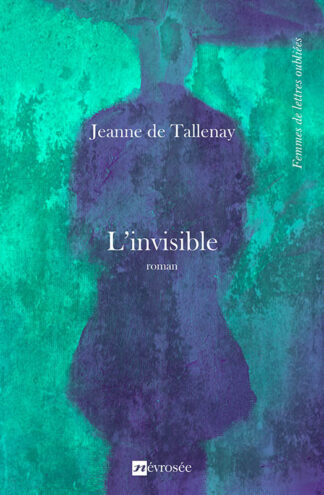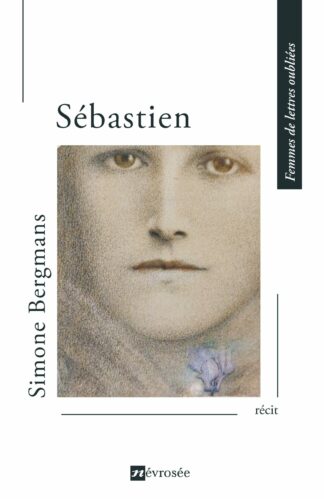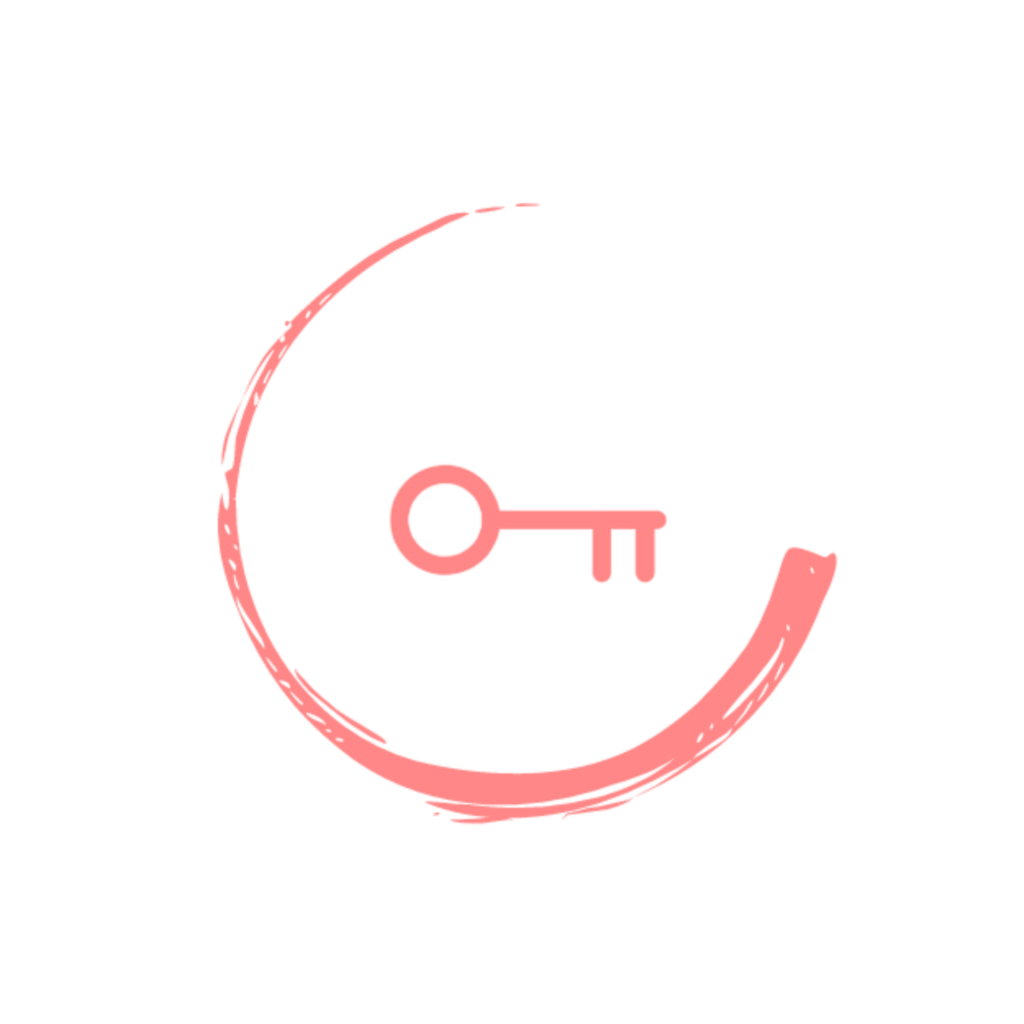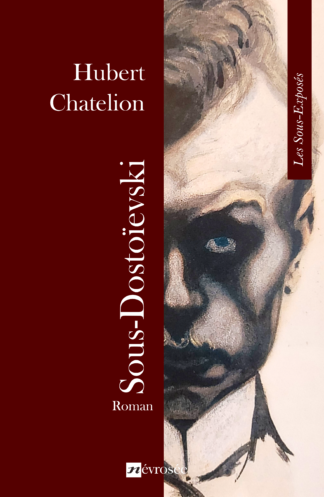I
Le souvenir le mieux précisé qui me reste de ma mère, avant son internement chez le professeur Oppelt, est, aussi, le plus lointain de mon enfance : j’étais toute petite, c’est à peine si je marchais seule… ; pourtant, j’avais réussi à me glisser derrière le piano où elle jouait quelque chose de doux et de fort triste.
J’avais d’abord entendu jouer Mme Veydt sans y faire attention, en trop jeune être, incapable de différencier les bruits et qui donnait à tous la même importance ; puis, j’avais prêté attention à celui-là, j’avais écouté, y trouvant un grand charme : la mélodie me venait en ondes plaintives, très sonores à la place où j’étais. J’en reçus bientôt une impression extraordinaire, tout à la fois ravie et mélancolique, qui me sortait de moi-même, qui me rendait comme folle… J’avais envie de rire et de pleurer : chaque note nouvelle me tombait sur le cœur, poignante autant que délicieuse, et, dans tout mon organisme à peine sorti des limbes, la magie énervante de la musique, agissant pour la première fois, fut si profonde que je m’évanouis. J’ai la conscience de n’avoir pu résister à ce que j’éprouvais en ce moment et de m’être laissé terrasser par une force tellement supérieure que rien, rien n’aurait pu me soustraire à son action.
Combien de temps je restai là, derrière la table harmonique de ce piano, sans connaissance, je ne saurais le dire. Quand je revins à moi, j’étais sur les genoux de Mme Veydt, près d’une fenêtre ouverte, et des bouffées d’air me caressaient le front, saturées d’une odeur de vinaigre et d’eau de Cologne : deux grands yeux bleus levés vers moi, anxieusement, sous des sourcils arqués et délicats ; un visage ovale dont le teint mat paraissait encore plus blanc aux tempes qu’encadraient des bandeaux de cheveux châtains… ; une robe rose, ample et molle, de cette mousseline qu’on appelait Zéphir et qu’on eût dite tissée avec des fils de la Vierge…, la chaleur d’une main tendre qui serrait les miennes toutes froides… , une voix frémissante d’angoisse, murmurant, dans un baiser :
— Lina, ma petite, mon enfant…, tu me vois, n’est-ce pas, tu m’entends bien, tu n’as mal nulle part ?
Et c’est ce que je me rappelle de plus net, de plus exact concernant ma mère à cette époque.
Pourtant, je crois bien que plus d’une année pleine passa sur cet accident avant qu’elle quittât la maison ; il en est ainsi des souvenirs de la première enfance : ce sont les plus reculés qui se gravent le mieux dans notre esprit. À l’heure actuelle, quand je pense à la jeunesse de ma mère, c’est toujours comme cela qu’elle m’apparaît : très pâle, l’air inquiet, vêtue de rose. Certaines phrases de musique suffisent à évoquer pour moi son image et je ne peux sentir un parfum d’eau de Cologne légèrement acide sans que ces mots me reviennent à la mémoire, avec l’accent de Mme Veydt :
— Lina, ma petite, mon enfant…, tu me vois, n’est-ce pas, tu m’entends bien, tu n’as mal nulle part ?
Certes, j’ai d’autres souvenirs d’elle et ma notion de ce qu’elle fut en l’heureux temps où aucune maladie n’avait encore atteint son intelligence ne s’arrête pas à ce seul épisode : une fois, en rentrant de la promenade, elle m’apporta des livres, de beaux livres à vignettes violemment enluminées, où l’on rencontrait des chiens verts jappant aux trousses de messieurs en culottes bouffantes ; une autre fois, comme elle cousait et que le petit bruit de son aiguille, frappant le dé sans cesse, m’intriguait fort, elle me mit son dé au doigt, puis, m’invita à le cogner moi-même contre l’aiguille qu’elle tenait…, et, d’ouïr le même petit bruit me fit sauter de joie frénétiquement. J’ai encore, dans le fond de mon passé d’enfance, cette vision de Mme Veydt en grande toilette, décolletée, avec des perles au cou, me souriant, en entrant, pour me dire adieu, dans la salle où une bonne s’occupait à me distraire, à l’aide de vieilles cartes à jouer dont elle faisait des châteaux. Si je m’absorbe dans la contemplation rétrospective de cette heure à jamais enfuie, j’entends le roulement de la voiture qui, bientôt après, emporta ma mère à quelque fête, et je m’entends, moi, pleurant et me désespérant parce qu’elle ne m’avait pas emmenée.
J’en pourrais citer d’autres, beaucoup d’autres…, mais ces heures-là n’ont pas conservé dans le kaléidoscope de mon cerveau la sûreté parfaite, la décision ni la rigueur de dessin que m’a imposée celle où, si petite et marchant à peine, je m’évanouis pour avoir écouté trop de musique et repris enfin mes sens dans les bras de ma mère.
La couleur qu’avait la lumière ce jour-là : un jour d’automne frais et déjà assombri par le crépuscule tombant…, les objets autour de nous, le coin de rue qu’on apercevait par la baie de la fenêtre, tout m’est présent comme à la minute même.
Dans un vase en barbotine — que j’ai encore, du reste — je revois un bouquet de chrysanthèmes dont quelques-uns, flétris, se sont effeuillés sur la table du salon où nous sommes. Un tapis rouge recouvre cette table, et je le revois, mis un peu de travers, bordé d’une frange à grelots ; je revois la cheminée surmontée de sa glace, la pendule qui est au milieu, les deux candélabres qui en complètent la garniture ; je vois le cahier de musique, tombé du chevalet sur le clavier du piano, tandis qu’à la place laissée vide par le tabouret, reculé en hâte au moment où l’on s’apercevait de ma présence et de mon malaise, une étroite carpette montre des traces d’usure là où le talon frotte quand la bottine de l’exécutant s’appuie sur la pédale.
Si j’étais peintre, je pourrais mettre sur la toile ma mère telle qu’elle était alors, avec ses traits, l’expression de sa physionomie, son mouvement de sollicitude apeurée et l’interrogation de ses beaux yeux. Ses mains étaient particulières, avec les longs doigts nerveux des pianistes, et elle avait les ongles carrés… ; je pourrais dire quelles bagues elle portait, comment était sa coiffure, et que son col était un col droit, de crêpe blanc, uni.
Souvent, dans la suite, on s’est entretenu devant moi de cette étrange syncope, que Mme Veydt, probablement, avait racontée et dont on prenait texte pour certifier que je n’étais pas une enfant comme les autres et que la pauvre femme, avec son éducation artiste, m’avait donné une impressionnabilité ridicule, un système nerveux vibrant comme la harpe éolienne. Peut-être est-ce à ces rappels nombreux que je dois d’avoir retenu si minutieusement un incident, à la vérité, moins frappant que d’autres, qui se produisirent après, quand j’étais plus âgée et, partant, plus capable, semble-t-il, d’observer et de retenir.
Ce qu’il y a de certain, c’est que je n’ai aucun souvenir si clair, si positif, si vivant que celui-là, et que la forme physique de ma mère, avant la catastrophe, ne se présente jamais à moi autrement que telle que je la vis en ce jour d’automne assombri et frais, comme je revenais d’une faiblesse dans ses bras.
J’avais quatre ans lorsqu’on nous sépara.
Mon père, lieutenant aux guides, était mort quelques mois auparavant, au Congo, où il était parti en exploration, à l’exemple de nombre de ses camarades, tout jeunes, comme lui, et qui jugeaient les moyens de parvenir à un haut grade dans l’armée vraiment trop rares et trop difficiles en Belgique.
Qu’il y avait eu d’assez sérieux désaccords entre mes parents, peu après ma naissance, et que ces désaccords avaient influé sur la détermination de Jules Veydt s’expatriant après trois ans de mariage et s’en allant si loin, dans ce pays perdu…, je l’ai su plus tard et cela m’a expliqué bien des choses.
Son mari mort — et, non d’une de ces maladies sournoises qui, là-bas, tuent les hommes traitreusement, au débarqué, sans leur laisser le temps de donner la mesure de leur courage, mais, en héros, dans une affaire avec les indigènes — son mari mort, ma mère qui, sans doute, l’aimait toujours, se prit à regretter les déplorables commencements de leur union. Elle eut des remords, s’accusa de mille fautes imaginaires et souffrit d’un chagrin si intense qu’elle s’en rendit malade.
C’était une nature fine et passionnée, un tempérament nerveux qui devait se désorganiser aussitôt que les nerfs ne le soutiendraient plus. Cela arriva : insensiblement, comme une plante privée d’air, elle se mit à décliner ; elle maigrit, pâlit, s’étiola, eut des palpitations de cœur et des insomnies, des accès d’humeur noire dont rien ne pouvait la tirer. Du jour où on lui avait appris son veuvage, elle n’avait plus voulu sortir du tout, ni recevoir personne, ni ouvrir son piano, elle qui en jouait à miracle et pour qui la musique avait toujours été le meilleur plaisir, la plus douce consolation ! Moi-même, je lui fus à charge et elle me livra aux servantes, sans souci de mon existence.
J’entendis cette phrase prononcée par des commères, un matin, au marché où mon ancienne nourrice devenue ma bonne, m’avait conduite : « Mme Veydt est folle ».
Rentrée chez nous, je demandai à voir maman ; on me répondit qu’elle ne voulait pas ; j’en conclus qu’être folle c’était ne plus aimer son enfant et refuser de le voir.
Peu après, comme elle prenait l’habitude de s’enfermer dans sa chambre, et d’y rester des journées entières, repoussant toute nourriture, on vient la chercher pour la conduire à Uccle, chez le professeur Oppelt.
C’était vrai ; elle était folle.