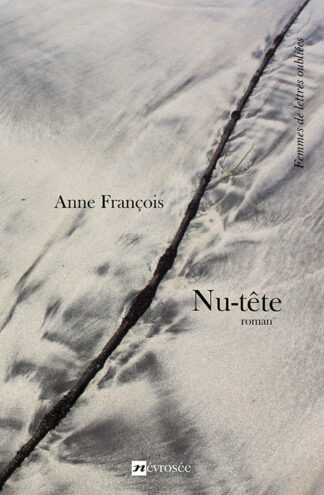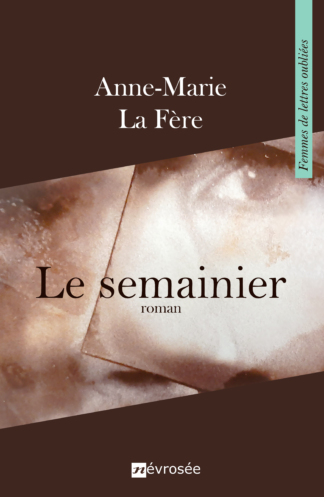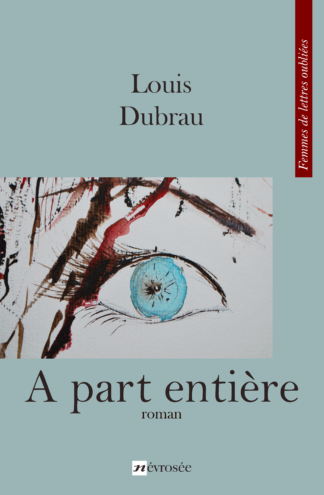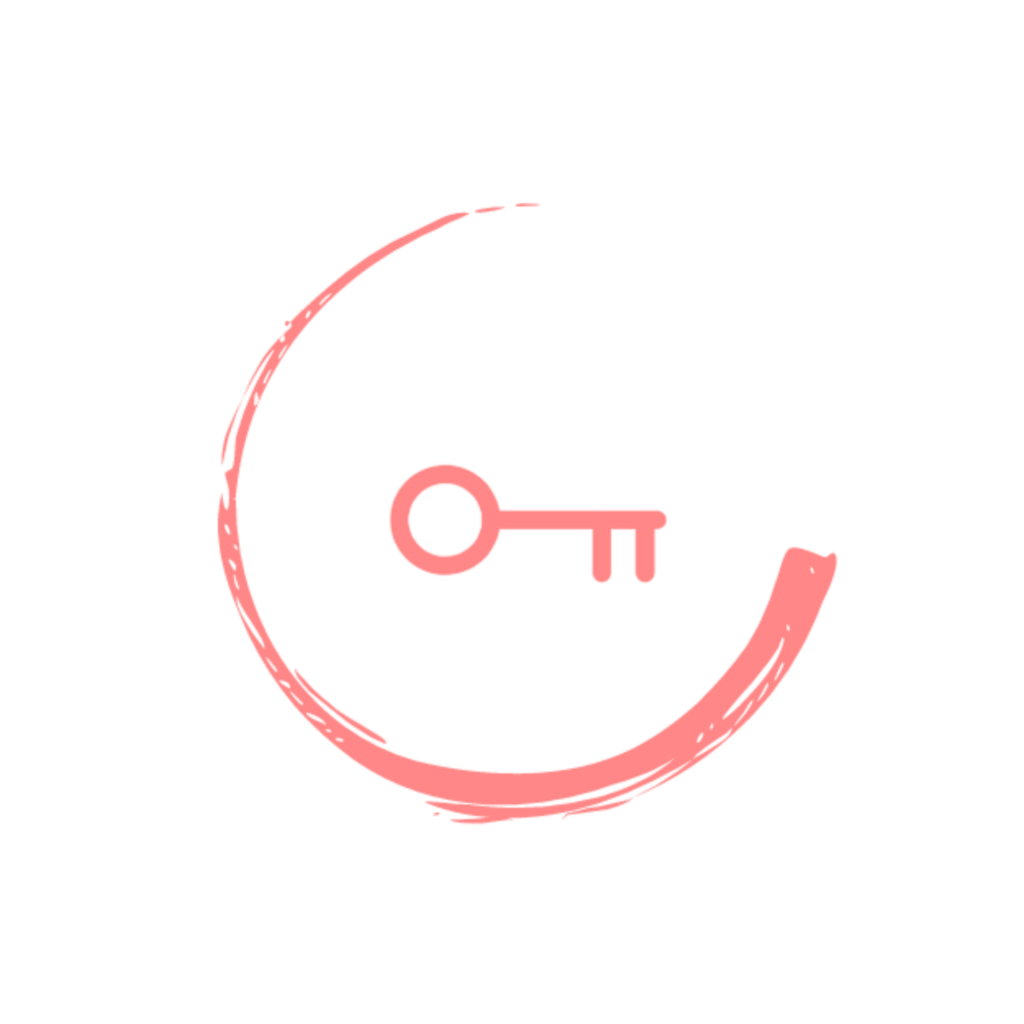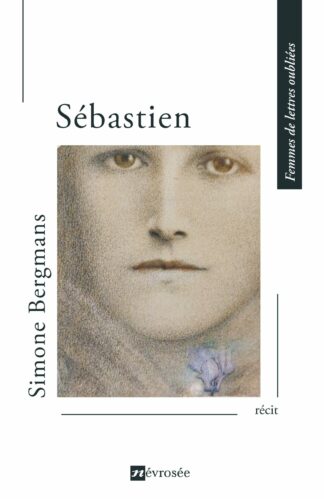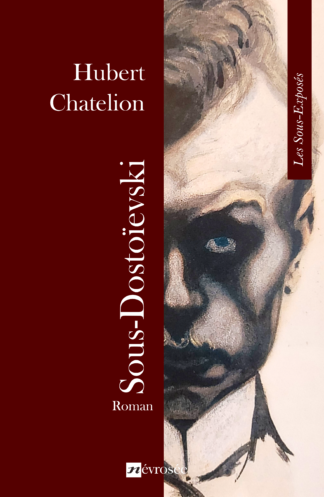Le bien
La végétation s’étendait opulente et diaprée, le long des torrents, sur les plaines et jusqu’aux cimes des monts, mêlant ses effluves printanières aux bruissements des insectes, aux chants des oiseaux ; et la nature, souriante, satisfaite, baignée de lumière, s’épanouissait indéfiniment sous la chaleur du ciel … La source du bien sommeillait mystérieuse sous les frais ombrages de cette nature virginale ; elle était l’âme vivifiante qui donnait aux forêts leur parfum, leur sourire aux fleurettes des champs.
L’homme faisait partie de la création, il était heureux du bonheur des fleurs et des oiseaux, tout l’enchantait : la vigueur de son corps, la douceur de son lit de mousse, le rayonnement du jour, l’étendue verdoyante des plaines. Il était en accord avec la nature ; il n’accomplissait pas le bien, il se reposait dans le bien universel, comme l’enfant se repose au foyer d’une famille vertueuse dont il accepte d’avance les ordres et les habitudes, persuadé que rien ne peut exister au-delà de ce petit monde dont il est issu, et auquel il tient, par toutes les fibres de son être.
Mais l’esprit exige autre chose que la paix inconsciente.
Au jour marqué pour son évolution, l’humble source du bien jaillit ; troublant la calme assurance du monde satisfait elle fit trembler le cœur de l’homme, qui, pour la première fois, sentit s’ouvrir en lui les abîmes du vouloir. Ce ne fut qu’un éclair, mais il effaça à jamais de son front la quiétude tranquille des jours heureux.
Une force nouvelle s’était emparée de lui ; à mesure qu’elle grandissait, elle l’obligeait à se détacher de sa mère, la nature, à choisir son sentier, à lutter, à souffrir, à être !
Désormais l’alouette eut beau lui chanter son cantique matinal et le soleil dorer sa retraite, l’homme ne vit plus l’alouette ni le soleil : un doute avait pénétré dans son cœur, le doute qu’inspire, à l’égard d’un état primitif, la découverte d’un état supérieur. Il existe donc autre chose que ce qu’il avait connu jusqu’ici ? … Mystérieux passage de l’inconscience à la conscience ! Ce doute allait engendrer un désir : connaître ce qui le dépasse ; puis ce désir lui imposer une action. Créature libre d’agir par soi-même, l’homme a découvert qu’il possède seul au milieu de la nature inconsciente le pouvoir de développer ou de défigurer le bien préexistant. Cette action devait provoquer une rupture, une faute : la désobéissance à l’ordre établi.
L’homme est arrivé à la réalisation du moi, de la personnalité qui le distingue de tout ce qui l’entoure. C’est un moi à l’état brut, inculte, la force de l’égoïsme naturel qui sait dire : « Je veux », mais non encore discerner ce qu’il veut, ni pourquoi il le veut.
Mais il suffit de vouloir pour faire infraction à la règle. C’est le premier pas vers le désordre, le déchirement, la mort, mais aussi vers le triomphe et la royauté. « Celui qui n’a pas vécu pleinement, ne peut non plus ni mourir, ni renaître pleinement ».
La première manifestation du réveil de l’Âme se traduit par un désir de vérité. L’homme conscient de sa vocation veut devenir parfait. Pour réaliser cet idéal, il possède un moyen : l’effort ; un guide : la loi. Il s’efforcera donc de connaître cette loi, de l’accomplir ensuite dans toute sa rigueur. C’est l’école de la volonté où toutes les énergies de l’être se mettent en œuvre, pour dompter les instincts, soi-disant fâcheux, et pour produire les vertus réglementaires.
Ce formidable travail achevé, l’homme est arrivé enfin à faire de sa vie un modèle accompli. Mais, Ô mystère ! Son cœur n’en est guère plus satisfait, car sous le poids artificiel d’une activité voulue, le bien naturel et instinctif qui se trouvait en lui s’est étiolé et dépérit.
L’effort de l’obéissance a fait grandir sa force, la déception que lui a value l’expérience du bien conventionnel le détourne de la morale courante. Meurtri, désabusé, il ne veut plus suivre une loi illusoire ; il veut être, et chercher la vérité qui lui est propre. Aventure périlleuse où il s’égarera peut-être, où il subira sans doute de sérieux dommages, et où il encourra inévitablement la désapprobation du monde.
L’esprit exige autre chose que l’ordre établi : l’infraction à la règle est nécessaire, elle est une conséquence de l’affirmation de la vie personnelle ; souvent elle est une faute, elle est toujours une douleur.
La première affirmation de la vie personnelle, qui nous oblige à penser et à être nous-mêmes, est presque toujours considérée comme une faute, parce qu’elle lèse l’ordre établi. Mais elle n’en reste pas moins une faute nécessaire, sans laquelle aucun progrès ne serait possible. Il est des vertus qui ne peuvent naître que de l’erreur, des richesses que l’on n’obtient qu’au prix d’une perte momentanée. L’infraction à la règle est la conséquence et la condition de la naissance de l’esprit. En effet, toute idée nouvelle est une infraction aux idées anciennes ; le réveil de demain une infraction au sommeil d’aujourd’hui. Aussi longtemps que l’homme évoluera, c’est-à-dire qu’il se détachera du chaos, pour s’exprimer en une forme plus pure, il brisera quelque chose. En brisant il désobéit, en brisant il crée.
« Il faut que le scandale arrive », a dit Jésus. Sans le scandale l’homme serait resté à l’état de vie végétative. « Malheur à celui par qui le scandale arrive ! » La souffrance en est la conséquence inévitable.
Chez les natures pures et très rares comme celle de Jésus, l’émancipation de la pensée personnelle se justifie par la force de l’âme qui l’a produite : passage naturel d’un ordre primitif à un ordre supérieur. Mais s’il n’y a pas eu faute au point de vue de l’âme, il n’en est pas de même aux yeux des hommes. Ils furent nombreux sans doute, ceux qui reprochèrent à Jésus enfant l’oubli qu’il commit à l’égard de Marie et de Joseph, en s’attardant au temple pour « s’occuper des affaires de son Père ».
Dans son indifférence, l’égoïsme naturel viole la loi par besoin de jouissance ; l’égoïsme sanctifié la viole par nécessité et se résigne à blesser, s’il le faut, pour créer la vie supérieure qui lui est assignée.
Pure ou impure, l’âme doit accepter son calvaire. C’est au moment où elle pressent son but final qu’elle assume la responsabilité et l’horreur des conséquences de son vouloir, et qu’elle encourt jusqu’à sa propre condamnation.
Nous ne savons pas toujours pourquoi nous agissons ; il arrive même qu’un instinct secret nous avertit très distinctement des souffrances que nos actes entraîneront pour nous. Nous agissons néanmoins et avec pleine conviction, parce qu’une force irrésistible nous pousse, malgré nous, vers l’accomplissement de noire suprême destin.
L’infraction qui nous est imposée par la voix du devenir, peut se présenter à nous sous des formes diverses : faute contre les conventions sociales, émancipation de l’autorité paternelle, affranchissement de la morale courante ; différentes pour chacun, ces infractions sont nécessaires pour tous, sitôt qu’elles mettent obstacle au nouveau devenir.
L’existence du mal, dans le monde, est sans doute indispensable à l’éclosion du bien. Chez l’individu, la mise au jour des imperfections morales, sous la forme de fautes, est préférable à leur dissimulation ; le contrôle conventionnel et factice n’a jamais produit qu’une vertu d’apparence.
Une faute qui nous réveille, est préférable à une vertu qui nous endort.
Il est du reste impossible d’avancer sans errer ; un enfant trop sévèrement tenu ne se développe guère ; une personne qui, sous prétexte de devoirs religieux ou sociaux, se retire du contact de la vie n’aura jamais qu’une vertu d’emprunt : elle possède la théorie de la vertu, elle un ignorera toujours la pratique. Sa vie exempte de fautes, est l’expression d’une âme sans valeur.
Le sculpteur qui taille le marbre, pour en dégager la forme de son idée, éparpille nécessairement autour de lui mille éclats de pierres. Les erreurs de notre vie consciente, au milieu desquelles s’élabore notre être spirituel, sont semblables à ces débris accumulés autour d’un chef-d’œuvre. S’appliquer uniquement à la correction de sa vie, c’est agir comme un sculpteur qui craindrait de s’attaquer au marbre, de peur de déranger l’ordre de son atelier.
Dans le domaine spirituel, comme dans le domaine matériel, il faut oser pour réussir : oser voir, oser croire, aimer, douter, souffrir, oser être. « Le royaume des cieux appartient aux violents. » Il faut oser, même au risque de se tromper. Quitte à constater ensuite ses erreurs et à les expier.
Dès qu’il porte atteinte à la sincérité, l’ami de l’ordre extérieur devient l’ennemi du bien individuel.
Une faute n’est pas toujours une chute ; lorsqu’elle procède d’une âme sincère en quête de vie véritable, elle est parfois une cause d’élévation. Elle ne devient nuisible au progrès de l’âme que du jour où elle diminue l’intensité de sa vie et ternit la pureté de ses aspirations. Cette déchéance est-elle possible pour les âmes vraiment nobles ? Leur valeur, accumulée sans doute au cours de plusieurs vies de lutte, n’aura-t-elle pas toujours raison des erreurs momentanées ? L’instrument perd-il de sa valeur, lorsque, sous une main malhabile, il donne un son discordant ?
L’âme doit-elle forcément déchoir quand la conscience dévie ? Nous ne pouvons perdre que ce qui n’est pas véritablement à nous, bien des vertus par exemple, parmi celles dont nous sommes le plus fiers. Un être arrivé à l’âge adulte peut-il retourner à l’enfance ? Ceux qui ont possédé la vérité ne sauraient l’oublier sans se renier eux-mêmes. La vertu vraiment nôtre ne dépend plus de nous, elle fait partie de nous.
« Laissez croître l’ivraie avec le bon grain. » Bonnes et mauvaises, il faut que les semences germent et grandissent ensemble, afin que nous puissions les distinguer et les séparer les unes des autres. Penchant au mal, aspiration au bien ; le secret de la victoire réside dans l’augmentation de la force vitale.
L’infraction à la règle est toujours une douleur.
L’homme fut la cause du mal, il en est aussi la victime ; le jour viendra où il en sera le maître.
Notre fidélité aux impulsions de la vie nouvelle entraînera la souffrance : elle nous expose à l’erreur, en nous plaçant, inexpérimentés encore, devant mille possibilités ; elle nous mène dans la solitude, tout appel à la vie étant taxé de révolte contre la routine morale et religieuse ; et surtout elle exige un sacrifice continuel.
Le vrai ne s’obtient pas à vil prix. Dès qu’une âme aspire à se réaliser dans sa véritable essence, il faut qu’elle accepte d’être dépouillée et vaincue. À travers cette défaite, l’homme spirituel se dégage et se fraye un passage vers un avenir agrandi, une destinée plus virile.
La naissance de l’esprit qui nous contraint à sortir de l’engourdissement de la matière pour entrer dans la lutte, travail de l’âme, est une des plus grandes souffrances que nous puissions éprouver.
Notre nature primitive se contente de biens visibles, mais à peine l’esprit nous a-t-il dévoilé le monde des biens invisibles que nos aspirations s’élèvent ; plus elles grandissent, moins elles peuvent être rassasiées.
La disproportion qui existe entre nos désirs de plus en plus vastes et nos ressources limitées, exige de nous un perpétuel sacrifice et finit par briser en nous le moi inférieur : l’égoïsme.
L’âme, à son réveil, se trouve en présence de trois possibilités : abdiquer son idéal, se résignant ainsi à la médiocrité courante ; se faire un idéal factice en fermant les yeux à la réalité ; ou courir le risque d’être broyée en restant fidèle à elle-même et clairvoyante vis-à-vis du monde. Le cœur vraiment pur semble seul capable d’affronter cette cruelle contradiction, non par goût ou par esprit de devoir, mais parce que sa nature l’oblige à préférer la mort à la perte de son idéal.
Le choc meurtrier des plus nobles sentiments contre la réalité brutale est la suprême injustice, car il est le châtiment du bien. Ce n’est qu’au prix de cette longue mort d’inanition que l’esprit peut triompher, comme la fleur qui éclot par le déchirement de sa gaine.
Dans le monde matériel, il est possible de jouir de biens mal acquis ; dans le monde invisible, il n’est pas de fortune gratuite. Nous y vivons de notre travail, nous nous y enrichissons de nos sacrifices : l’âme se remplit de lumière, de force, de grandeur, en proportion de la profondeur que la souffrance y a creusée.
Cette douleur est utile.
« Le cœur pur voit Dieu », Dieu lui dictant sa pensée, il n’a plus besoin de consulter les hommes, ni de s’efforcer d’accomplir leurs lois. Il vit la vérité, il est le bien.
Le cœur se purifie, dans la mesure où il est sincère. Par la souffrance il se débarrasse de tout ce qu’il contient de trouble, de faux, de mélangé ; car la souffrance volontairement acceptée le dépouille de ce qui est imparfait, ne lui laissant que ses aspirations originelles.
Ce n’est pas en allant au fond de la douleur, mais en ayant le courage de demeurer dans ses profondeurs que l’âme acquiert sa vraie valeur.
Cette douleur n’est pas éternelle.
Nous nous sommes habitués à attacher l’idée du bonheur non pas au mouvement intérieur mais aux avantages extérieurs, et nous doutons de la justice du sort envers celui dont la beauté spirituelle fut la seule récompense.
Cependant, si la naissance de l’esprit nous garantit les biens invisibles, elle ne nous frustre pas des biens de ce monde. Le sacrifice exigé par l’esprit n’est pas définitif, il marque le passage d’un état inférieur à un état supérieur dans lequel nos facultés transformées nous permettent d’envisager les choses sous un nouveau jour.
L’homme est né matière, il doit lutter pour devenir esprit : quand l’esprit est mûr, c’est-à-dire lorsqu’il a appris à gouverner, il rend à la nature ses droits et devient possesseur de toutes choses, car il a vaincu le mal, cause de l’interdit. Il a le droit désormais de jouir des biens dont il s’emparait jadis, au mépris de ce droit ; car ce n’est plus par faiblesse qu’il le fait, ou par ignorance, mais c’est dans la plénitude réfléchie de sa force. Il n’est plus un enfant qui obéit, mais un maître qui commande.
Chez l’homme naturel, la vie du corps étouffe la vie de l’âme ; chez l’homme volonté, la vie de l’âme éteint souvent la vie naturelle. Toutes les souffrances proviennent de ce conflit ; dans l’harmonie à venir, corps et âme ne feront qu’un, ce qui les séparait, à savoir le mal, sera vaincu.
L’homme régénéré est à la fois corps et âme, tout conflit ayant cessé, le corps n’est plus en scandale à l’esprit, ni l’esprit en opposition avec le corps, car le corps s’est laissé immoler par l’esprit, et l’esprit triomphant a ressuscité le corps agonisant. Mis en possession des droits spirituels, l’homme est pleinement autorisé à s’arroger les droits temporels.
L’esprit dit au corps : « Parce que tu as renoncé à tout, tu peux tout posséder ; par la mort, tu as acquis la dignité de vivre, je devais immoler tes désirs égoïstes qui n’avaient pas souffert ; aujourd’hui que tu es purifié par le renoncement, je me plais à combler tes aspirations légitimes ; tu entravais mon triomphe, aussi je t’ai chargé de chaînes, je t’ai réduit par la maladie, je t’ai soumis à d’inexorables lois, je t’ai interdit toutes les joies ; maintenant que tu es soumis, vois, je brise tes fers et je te fais participer à ma gloire, car j’ai besoin de toi, comme toi-même tu as besoin de moi. Ensemble nous réaliserons la parfaite harmonie du monde matériel et du monde spirituel, nous restaurerons le terrestre paradis.
La présence du bien reposant dans la nature est le bonheur primitif ; le développement du bien est la rupture avec la nature, donc la souffrance ; le fruit du bien est un retour à la nature, à une nature cent fois agrandie, c’est l’harmonie.
Cette harmonie se forme à notre insu par le devenir du bien qui germait en nous, en sorte que nous nous trouvons un jour posséder naturellement ce que nous avions essayé de produire artificiellement par notre obéissance aux lois extérieures. Aussi est-ce vers ce seul devenir que va désormais se tourner notre attention ; nos efforts seront consacrés à retrouver en nous la vie enfantine, à la débarrasser de tous ses gestes dénaturés et à lui donner l’espace nécessaire à sa croissance, et à son développement. Car ici nous avons le devoir de sacrifier et le droit d’enfreindre tout ce qui met obstacle à l’éclosion de la vie nouvelle, fût-ce l’aspiration la plus légitime ou la loi la plus pure. L’ordre intime est impétueux, et c’est de notre obéissance à cet ordre que dépendra notre vie éternelle. Le bien n’est pas un modèle accompli, mais une puissance en devenir. De tout temps, ses étapes progressives furent marquées par la venue des précurseurs qui, se détachant de la foule, s’avancèrent seuls au-devant des lueurs nouvelles. L’humanité fit alors un pas en avant.
De même, le bien dans le cœur de l’homme, ne peut suivre qu’une marche lente et presque imperceptible ; notre esprit a beau concevoir l’idéal, notre volonté le poursuivre, pour le vivre nous devons attendre que notre âme éprouvée ait acquis une force, une grandeur, une pureté capables de le réaliser en elle. Dès que nous voulons précipiter son évolution, en acceptant une vérité toute faite, en pratiquant une vertu qui nous dépasse, nous nous corrompons infailliblement.
Ce que nous oublions trop souvent, surtout dans nos rapports avec nos frères, c’est de tenir compte du degré de leur développement et de la patience que nous devons au progrès du bien. Demandons à chacun d’être vrai dans la phase qu’il traverse, mais n’exigeons rien de plus.
Personne ne peut nous donner la vérité, toutefois quand nous avons vécu certaines vérités, il arrive que nous en trouvions la confirmation dans l’expérience d’autres âmes ; et cette confirmation achève de les sanctionner en nous.
L’enfant qui a commencé par avoir part au salaire paternel, devenu adulte, doit à son tour gagner sa propre vie ; de même l’homme, éveillé par la voix du bien, mûri par la souffrance, doit travailler pour discerner, choisir et conquérir dans la vérité générale une vérité personnelle et vivante.
Il n’acquiert cette expérience qu’en mesurant ses facultés propres avec les forces du monde. Au contact éducatif de la vie, ses qualités inconscientes se développent ; elles deviennent partie intégrante de son moi, comme ses membres de son corps. Possesseur légitime d’un bien personnel, fondé sur l’expérience, il est à l’abri des influences étrangères, et il devient dès lors capable d’accomplir sa vraie destinée.
Le bien c’est la naissance et le développement de la vie divine en nous, c’est la découverte, par la foi, du monde invisible. L’homme naturel s’en tient aux apparences. Pour lui, mouvement signifie vie, sourire veut dire bonheur, une bonne action est synonyme de bien. Mais à mesure que s’exercent nos facultés psychiques, un nouvel être se forme en nous, un nouveau monde s’ouvre à nos yeux, et nous découvrons qu’un silence, une larme, un échec, peuvent représenter une joie plus profonde.
La matière, devenue transparente, nous laisse deviner l’âme des choses, et cette âme, nous la sentons vibrer à l’unisson de la nôtre, comme l’écho d’une voix unanime qui va se répercutant d’un bout à l’autre des régions immortelles.
Cette initiation progressive aux réalités invisibles constitue le vrai progrès, et nos conquêtes dans ces terres merveilleuses forment notre véritable patrie.
Sans le mensonge des apparences et le poids de notre raison alourdie, l’intuition naturelle, qui met en contact le divin en nous avec le divin universel, serait une marche triomphale à la beauté parfaite. Mais comme membres de l’humanité, nous avons à compter avec les obstacles de la vie, et comme parties d’un organisme, notre être supérieur est obligé de régler son vol au pas de notre être inférieur. Peut-être notre moi transcendantal, n’ayant guère dépassé l’état d’enfance, demande-t-il encore, pour ne pas s’égarer dans un azur affaibli et diffus, le contrôle de la logique humaine et les entraves de la vie quotidienne.
Cependant l’instinct secret, que la morale, l’art et la religion nomment tour à tour intuition, inspiration, grâce, n’en reste pas moins ce qu’il y a de plus grand, de plus réel et peut-être de seul immortel en nous. Il est l’organe du progrès et la vérité de l’avenir, celle qui prévaudra contre toutes les conquêtes de la force, de la raison et de l’intelligence.
Celui-là aura donc vécu pour le bien qui, à travers mille échecs, aura su donner à son âme le plus d’occasions de se réveiller, et celui-ci aura vécu pour le mal qui, malgré une conduite en apparence irréprochable peut-être, aura volontairement entravé l’éclosion du divin en lui.
La nature est œuvre divine ; nous naissons avec le germe du bien. Le bien que nous faisons sur la terre n’est donc pas un effort contre nature, mais une éclosion de notre vraie nature, un épanouissement de ce qui, en elle, est le meilleur et le plus vraiment nôtre. Ce n’est pas un devoir, c’est un bonheur, bonheur, il est vrai, que l’on obtient péniblement dans un monde où tout est entrave, mais que l’homme éclairé devrait rechercher aussi naturellement que les autres bonheurs.
Notre être intime destiné au bien, ne pourra se complaire définitivement qu’en lui.
Cet être si pur, dépositaire d’un germe sacré est solidaire également du monde souillé qui tend à le détruire en lui suggérant des aspirations faussées. Et, comme le développement du vrai dans la nature a créé le bien, la déformation des désirs naturels a produit le mal, le règne du mensonge, cause de toutes nos douleurs.
La mystérieuse présence, sur notre terre, d’êtres foncièrement mauvais s’explique par le fait des déchets que la nature a laissés, en se développant : scories qui gisent partout où passa la flamme vive, cocon vide d’où sortit le papillon, escorte des erreurs qui accompagnent tout progrès.
Le devoir de l’homme est de retrouver, au milieu du mensonge universel, le germe de vérité primitive, de le dégager, comme une parcelle d’or, pour lui donner enfin le développement et l’éclat d’un joyau royal.
Lorsqu’il aura ressaisi ses aspirations premières et légitimes, l’homme aura retrouvé le bien, son moi véritable.
Ainsi toute aspiration au bonheur, quelque défigurée qu’elle soit, n’est au fond qu’une aspiration vers le bien, la nostalgie du paradis perdu.
Le bien est toujours l’objet de ton désir ; mais comme un petit enfant, tu peux prendre de l’hysope pour du miel ; voilà pourquoi on a dû exprimer la vérité par des lois, et les lois par des mots ; mais celui qui sait tous les mots peut se trouver aussi éloigné des grandes pensées que celui qui obéit à la loi peut être loin de la compréhension du bien.
Le danger pour l’homme, c’est le savoir et la liberté qu’il a d’en user. Le savoir peut l’éloigner de la vérité, mais il peut aussi l’y ramener, pourvu qu’il reste humble et conscient de son insuffisance.
Ce qui nous détourne de la vérité, c’est la connaissance, employée dans un but intéressé. Le désintéressement est la condition première de tout bien. Il faut que j’apprenne à vouloir, par amour de la beauté, non par amour de la jouissance, et je découvrirai que la beauté est la plus complète des jouissances.
On s’accorde à prêter au mal tous les pouvoirs, au bien toutes les faiblesses ; c’est l’éternelle histoire du loup et de l’agneau, et comme depuis des siècles nous assistons à l’oppression du juste, on ne songe plus à s’étonner de l’apparente défaite du bien ; se hasarde-t-il à revendiquer ses droits de suprématie, aussitôt il devient suspect.
Il est admis que le bien renferme toutes les qualités passives : la douceur, l’humilité, le désintéressement, la patience ; c’est un composé de vertus inoffensives, libres de se propager, comme les fleurs dans un jardin, pour l’agrément de chacun. Mais se souvient-on encore que, dans son essence, le bien est une force, une volonté, une puissance destinée à triompher par le combat.
De nos jours, l’homme de bien est un anémié ; il a perdu sa foi en lui-même ; ne distinguant plus nettement le but qui lui est assigné, il va au hasard en tâtonnant. Il craint de traverser les places publiques et demande humblement aux manants la permission de passer. Quand il doit paraître, il préfère se montrer en compagnie et ne s’affirme que soutenu par l’Église ou protégé par la loi.
Sa propre incertitude le rend faible vis-à-vis des autres. Il ne sait quand il doit faire sourire et quand il doit faire pleurer. La vue d’une goutte de sang l’effraye ; il s’attarde le long du chemin à redresser une fleur et marche avec précaution, pour ne pas écraser un insecte ; il épuise en attendrissements maladifs et gaspille en petites vertus aimables la conscience de sa mission royale et la force de son héroïsme. Le méchant, plus courageux et plus indépendant, fraye son chemin, bravant l’opposition, et surmonte ainsi les obstacles de l’ordre établi. Il sait ce qu’il veut, lui, et n’épargne aucun moyen pour atteindre son but. Les gens de bien, s’inspirant de son exemple, auraient avantage peut-être à imiter son audace, car la bonne volonté sans force risque souvent d’être plus nuisible que le mal.
L’idée du bien se résume, pour la plupart des hommes, en quelques formules officielles de la morale courante ; elle n’est pas une vérité vécue, individuelle, distincte de l’expérience commune. Cependant la force ne vient pas au fort de son adhésion au bien général, mais de l’énergie qu’il consacre à élaborer la vérité qui lui est propre. Car le bien, tout en s’adaptant à la généralité des hommes, demande, pour devenir efficace, à être éprouvé, et, pour ainsi dire, recréé par chaque individualité.
Comme le bien ne peut demeurer une chose vague, générale, il ne peut se contenter d’être un faux amour du prochain. Ce n’est pas en ménageant le faible, on nous apitoyant sur la misère humaine, mais en croyant au remède et en affirmant la justice, que nous devenons véritablement utiles aux hommes.
Une loi inéluctable veut que tout ce qui grandit écrase autour de soi ce qui reste petit : l’arbre dans la forêt, en étendant ses branches, étouffe plus d’un frêle buisson ; le génie, en poursuivant son idéal, foule aux pieds les intérêts vulgaires qu’il trouve sur son chemin, et la conscience éclairée qui s’affirme effarouche et blesse les ignorants ; ainsi la force semble parfois cruelle, mais elle se justifie par le fait qu’elle sort le progrès vrai de l’humanité.
Cette force, capable de produire toutes les audaces, d’assumer toutes les responsabilités, dans une parfaite indépendance, voilà ce qui manque encore à l’idée du bien !
Plus une idée est profonde et subtile, plus elle donne lieu à l’erreur ; il n’est peut-être pas de conception qui, passant par le filtre étroit de notre cerveau, n’ait été autant mutilée et rétrécie que celle du bien.
Si notre conscience a dépassé quelque peu celle du sauvage qui, après avoir égorgé son frère, rend hommage à son fétiche et s’en va satisfait, elle ne conçoit encore le bien que sous la forme éphémère et variable des lois humaines et croit avoir rempli tout son devoir le jour où elle a fait le tour de sa morale : ignorante du grand mouvement d’amour qui, depuis des siècles, la porte avec tout ce qui vit vers le triomphe universel.
Le bien n’est pas dans l’accomplissement d’une loi limitée, mais dans l’acquiescement à la vie grandissante et universelle ; c’est le développement en nous du germe éternel, la naissance d’une vie dont l’autorité est tellement supérieure à l’ordre ancien, qu’elle nous affranchit de la notion courante du bien et du mal et nous donne une appréciation nouvelle de toute valeur.
Le mal n’est pas dans l’infraction à la loi, mais dans le reniement de la vie, dans tout ce qui met obstacle à son développement et à son élévation : la froide raison qui tempère, le matérialisme qui engourdit, la paresse qui s’épargne, l’égoïsme qui accapare et le mensonge qui falsifie.
Il importe, pour que nous comprenions la puissance et la valeur du bien, que nous en retranchions l’idée d’une manifestation visible et sensible. Le vrai bien, celui qui fait notre salut, ne dépend pas de nos instables petits mouvements d’obéissance, de charité et de foi, mais de notre adhésion à l’universel progrès du bien en devenir. Comme la vie repose dans la plante, il est une force qui repose en nous, et nous porte, dès que nous nous y livrons, à travers les fluctuations bonnes ou fâcheuses de l’existence, vers l’accomplissement de notre suprême destin.
Le bien est le grand courant de vie : partant des profondeurs cachées de l’univers, il parcourt la terre, il la féconde, pour se précipiter enfin dans l’océan de l’infini, plénitude de l’âme en Dieu.