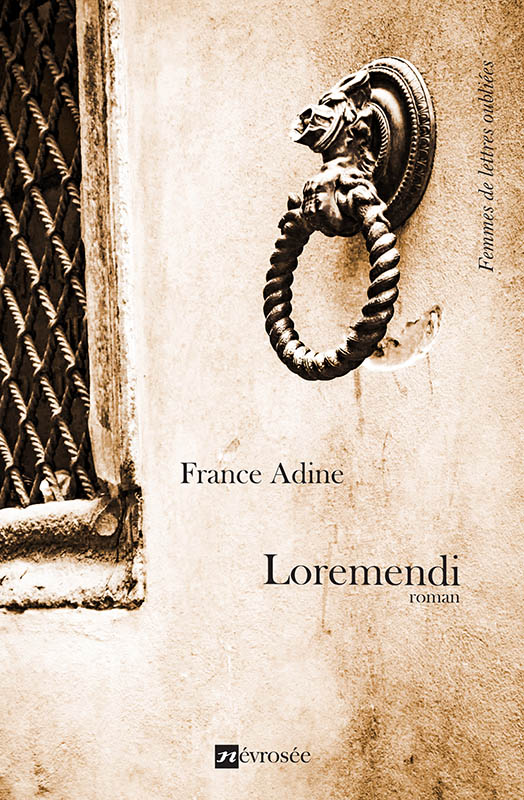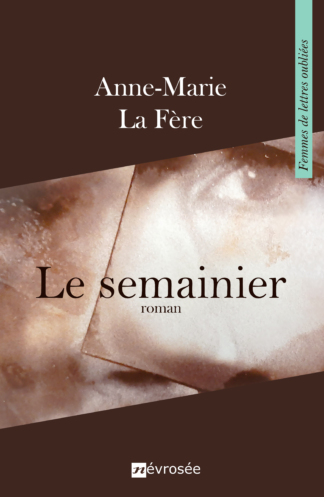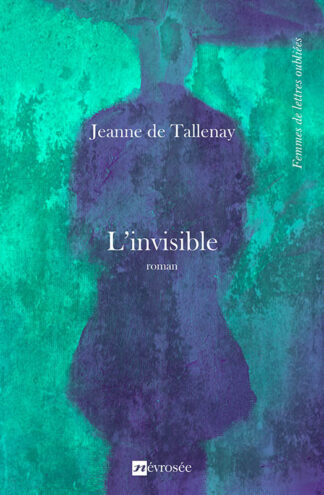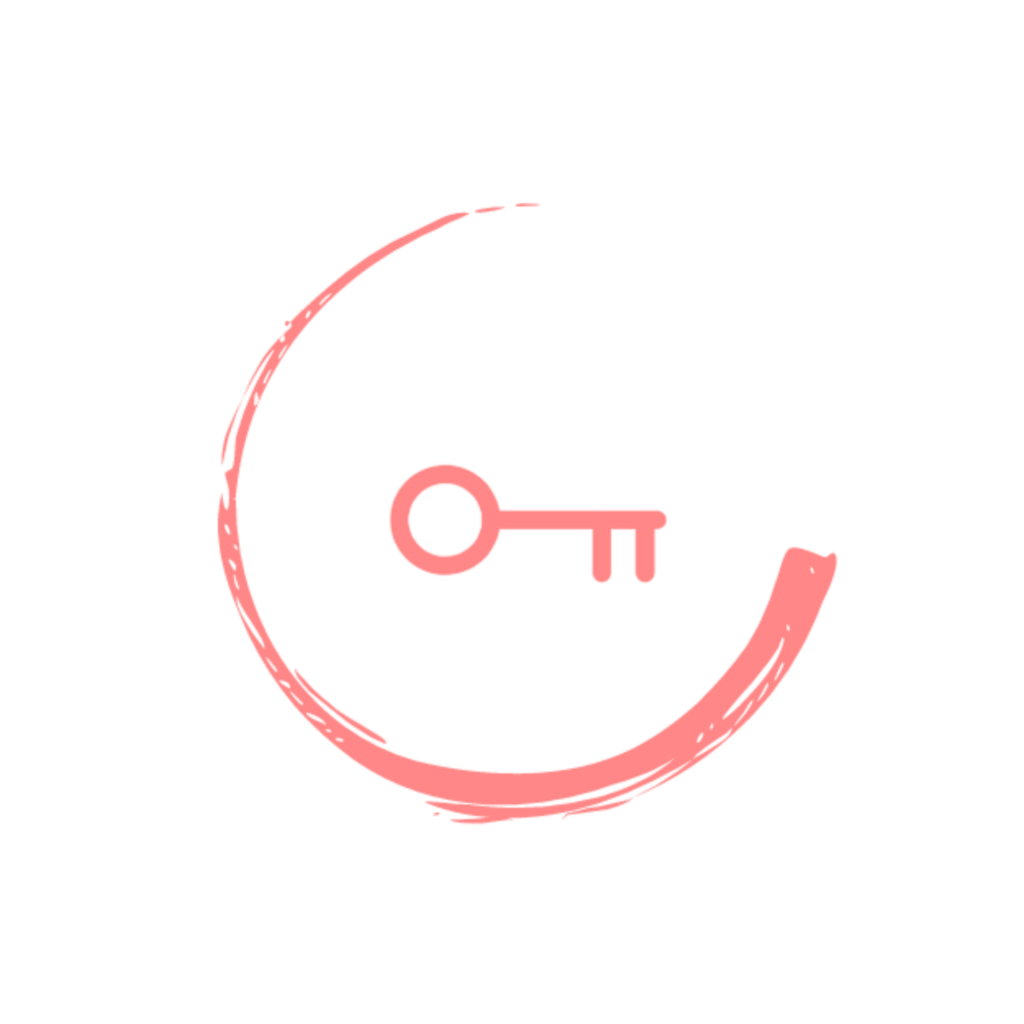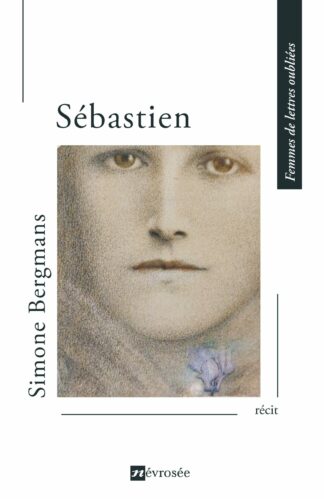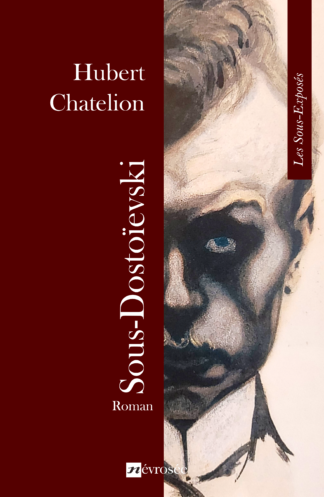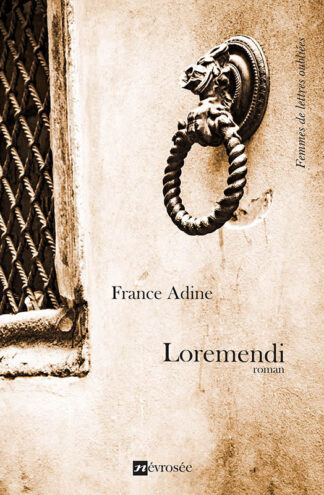Il ignorait absolument ce que serait le livre de son choix, mais il savait qu’il l’écrirait un jour. C’était comme un trésor déposé en lui et qu’il n’aurait pas eu la curiosité de regarder. Le moment de regarder n’était pas venu, et chacun sait qu’il est des curiosités sacrilèges, — ou du moins chacun le saurait s’il avait eu la sagesse d’étudier les contes de fées, qui sont des vérités éternelles. Par bonheur les fées veillent, ou peut-être les anges. L’ange de Philippe Dastières l’avait conduit par un chemin qui semblait plein d’agréments, — car il écrivait des romans d’aventures, — mais qui était pour lui plein d’austérité parce qu’il le faisait pour gagner de l’argent. Philippe atteignait quarante ans. Son ange et lui avaient sans doute grand besoin d’une détente. Ce qui devait arriver arriva, et il est à remarquer que les dieux se servent de moyens bizarres et d’expédients que les profanes qualifient de futiles ou d’infimes. Il nous faut donc garder des yeux attentifs et noter que Philippe Dastières, romancier qui fournit annuellement à son vaste public six volumes remplis de mystère, de luttes et de frissons, rencontra son destin parce qu’il avait soigné, au cours d’une froide nuit de printemps londonien, trois chiots Ayrdale qui venaient de naître.
Donc la nuit était froide et la chienne, revêche, ne se souciait pas de donner à téter aux trois malheureux qui cherchaient de toute leur faiblesse éperdue la chaleur de sa toison. Philippe aimait sa chienne, mais il fut choqué de voir le peu d’intérêt qu’elle témoignait à cette récente famille. Il fit mettre la corbeille dans sa chambre à coucher et surveilla d’un œil sévère cette conduite si peu maternelle. Eût-il voulu dormir que les chiots l’en eussent empêché. Ils ne cessaient de geindre que pour pousser des cris désespérés quand leur mère leur tournait fort proprement le dos et qu’ils se sentaient pressés entre une échine inhospitalière et une paroi d’osier plus rude encore.
Philippe se levait et rétablissait l’ordre des choses sous le regard faussement innocent de la chienne.
— Patsy, ma fille, ne soyez pas un cochon ! Et encore, je ne sais pourquoi je vous dis cela, car les truies sont des mères parfaitement dévouées, et elles sont parfois turlupinées par une douzaine de porcelets. Vous avez fait les choses avec une réserve aristocratique, vous n’avez que trois enfants, vous pouvez bien les soigner, que diable ! Je sais que le métier de mère a ses embêtements, comme tout autre métier, mais votre manque d’enthousiasme me dégoûte, tout autant que cet air aimable que vous affectez quand je vous parle !
De discours en discours, d’heure en heure où Philippe, en pyjama, repêchait non sans répugnance trois chiots gras et humides rejetés au loin pour les replacer entre les pattes maternelles, il finit par faire prendre conscience à Patsy de sa dignité, et par attraper une congestion pulmonaire.
Les dieux poussaient les pions sur l’échiquier et l’ange soupirait après une vacance paisible.
Philippe n’était pas encore convalescent quand son ami Henry Farrow vint, à son chevet, dresser des plans de campagne. Farrow admirait Philippe depuis l’école préparatoire, ce qui ne l’empêchait pas de le dominer en mainte occasion. Farrow avait découvert dans le jeune médecin sans vocation un romancier d’une fécondité rare. Homme de loi et ami dévoué, il avait forcé Dastières à considérer un travail que celui-ci regardait comme une amusette, — et qui depuis, l’amusa beaucoup moins ; — il avait surveillé les contrats d’édition et administré une fortune qui n’avait pas tardé à s’arrondir.
— Tu n’es pas un artiste, grâce à Dieu ! lui avait-il dit un jour. Tu es un habile fabricant de livres à bon marché. Cela, c’est une mine d’or.
Et Philippe, qui avait écrit un soir un récit des plus romanesques d’après les confidences d’un client, s’était aperçu qu’il pouvait, d’un point de départ, faire évoluer le roman de vingt façons différentes. C’était un jeu, une récréation, après son travail avec son père, médecin connu de Harley Street. Mais le zélé Farrow veillait. Les premiers manuscrits présentés par lui à un éditeur perspicace virent le jour soutenus par une abondante publicité et obtinrent un succès qui n’était pas entièrement illégitime. Dastières avait l’imagination ingénieuse, et ses récits prenaient un accent particulier. Il mêlait volontiers aux combinaisons les plus pathétiques un personnage irrésistiblement cocasse. En cela, il se conformait à la tradition des écrivains de grande lignée, affirmait-il à son ami. Et Farrow rétorquait que tout irait à merveille si Philippe voulait bien ne pas se prendre au sérieux tout en travaillant le plus sérieusement du monde. Le cinéma s’enrichit bientôt de ses scénarios. Toujours grâce au jeune solicitor, qui traitait les affaires de Philippe, l’enrichissement fut réciproque.
Le docteur Thomas Dastières — qui tenait son nom français d’un ancêtre rochelois — était trop sage pour retenir dans sa profession un fils qui préférait gagner sa vie d’autre manière. Farrow le prit complètement en main, car s’il savait que Philippe était capable d’écrire des livres, il ne savait pas moins qu’il n’en pourrait jamais tirer profit tout seul.
— Apporte-moi tous les deux mois un bon petit manuscrit pas trop intelligent, capable d’empêcher les femmes sensibles de dormir. Je me charge du reste.
Et Philippe, qui tenait en grande aversion les démarches, les discussions, voire la simple correspondance avec éditeurs, adaptateurs ou cinéastes, avait abandonné cette partie de son travail à son ami. Celui-ci s’en acquittait avec habileté, mais aussi avec une réelle satisfaction : la meilleure façon de dominer quelqu’un est encore de le servir, et Farrow croyait fermement que sa volonté était indispensable à la carrière de Philippe. Ce dernier partageait son avis et lui obéissait comme s’il eût été à ses gages. Il n’en gardait pas moins une secrète indépendance, ou plutôt une liberté en attente. Cette attente prit fin au cours même de sa maladie.
— Mon cher vieux garçon, lui dit alors Farrow, je me demande si vous serez assez bien pour entreprendre cette randonnée en Corse que vous jugiez nécessaire à vos vacances…
— Et à mon prochain livre, ajouta Philippe.
— Oui, sans compter votre projet de film.
— Je n’irai pas en Corse, j’écrirai une histoire de contrebande dans les Basses-Pyrénées. Il paraît que tout le monde est contrebandier là-bas. Je n’aurai pas de peine à trouver mes types et je n’aurai qu’à écouter ce qu’on raconte pour trouver des quantités de thèmes à romans.
Comme Henry Farrow ne connaissait pas plus le Pays Basque que Philippe, il accepta pour véritable cet audacieux « raccourci ». Ce qui l’occupait d’ailleurs, c’était cette décision que son ami avait prise sans le consulter.
— L’idée n’est pas mauvaise, dit-il. Comment vous est-elle venue ?
— Sais pas, dit très sincèrement Philippe.
Son ami le regarda avec attention
— Autant ce pays-là qu’un autre ?
— Non, plutôt celui-là qu’un autre. Pourquoi ?
— Sais pas. dit encore Philippe.
Son air rêveur provoqua chez Farrow, si adroit, un mouvement d’impatience.
— Mon cher vieux garçon, vous me faites penser à un homme qui a envie de s’enfuir !
Cette parole imprudente enchanta Philippe comme une révélation. Mais pour qu’elle gardât tout son charme, il eut soin de n’en rien dire. Il se contenta de sourires de l’air le plus distrait du monde.
— Enfin, oui ou non, comptez-vous travailler ?
— Dites à Fiery et Johnstone que je leur enverrai fin juillet deux cents pages avec beaucoup d’amour, beaucoup de danses — très peu de sang mais habilement répandu — et une fin heureuse.
— Bien entendu ! II ne faut pas attrister les clients de Fiery et Johnstone ; ils seraient capables de ne pas vous pardonner ! dit Henry avec conviction. En ce cas, mon ami, vous pourriez pensionner votre stylo.
— Ou chercher un autre éditeur.
— Quelle folie ! Fiery et Johnstone détiennent le genre que vous pouvez fournir.
— Qui sait ?
— Phil, vous m’inquiétez ! Est-ce que la congestion pulmonaire aurait eu le déplorable effet de vous rendre poète, par hasard ? Je ne vais pas oser vous laisser partir, ou je vais partir avec vous.
Philippe comprit que pour défendre sa liberté nouveau-née et qu’il sentait encore fragile, il lui fallait mentir.
— Rassurez-vous, mon vieux, je plaisantais, dit-il. Et comme Farrow, dubitatif, le regardait toujours, il ajouta.
— Dites-moi donc à combien s’élèvent mes revenus ?
— Quel rapport cela peut-il avoir…
— Oh ! aucun.
— Est-ce pour savoir la somme que vous pouvez consacrer à ce voyage.
— Je suppose que, subconsciemment, c’est là le motif de ma question.
— Vous avez, dit Henry avec un peu d’humeur, de huit cents à huit cent trente livres. Ce n’est pas encore le Pérou.
— Impôts déduits ou non ?
— Impôts déduits, répondit comme à regret le fidèle gardien de sa fortune.
— Pas si mal ! remarqua Philippe non sans complaisance. Avec cela, un célibataire peut vivre, surtout à l’étranger.
— Mais vous augmenterez votre capital, Phil ! L’année s’annonce bonne : Brouillard sur mer et Fleur-de-Neige acceptés à Hollywood, des traductions dans les pays scandinaves qui ont aussi, sans doute, leurs heures de… de…
— Mauvais goût.
— N’exagérons rien. Bref, un tas de circonstances heureuses pour compenser la perte de temps occasionnée par votre maladie, et, peut-être par cette fantaisie de voyage.
— Vous ne trouviez pas l’idée mauvaise !
Farrow ne répondit pas et se contenta de faire une grimace. Philippe le vit, mais une paresse heureuse l’empêcha d’en demander l’explication. Après un silence son ami reprit :
— Que diriez-vous si je venais vous rejoindre pendant les vacances judiciaires ?
— Je dirais que c’est fort gentil de votre part, — si je suis toujours là.
— Où là ?
— Là où je serai, dit sereinement Philippe.
Farrow se leva.
— Mon cher ami, je renonce à vous comprendre ce soir. À bientôt. Vous me préviendrez, j’espère, de votre départ.
— Oh ! oui, je dois examiner mes comptes avec vous, — et puis je désire vous confier Patsy et sa famille. J’espère que cela vous rend heureux ?
— Ah !… hum ! certainement. Est-ce que la famille est bien élevée ?
— À son âge ? Vous ne le voudriez pas !
— Grands dieux ! Et ma mère qui vient de s’offrir pour son anniversaire un ravissant tapis de Perse !
— Rien n’indique que ces chers petits chiens auront une prédilection pour ce tapis, Harry. Vous vous préoccupez de choses vaines…
— Une seule importe, n’est-ce pas, et c’est votre tranquillité d’esprit ?
— Exactement ! Allez en paix.
Et Farrow s’en alla, perplexe.
— Cher vieux garçon ! Incomparable ami ! dit Philippe qui, dans le confort de ses oreillers, goûtait la promesse de la délectable solitude à laquelle il rêvait, guide et complice de toute véritable aventure.