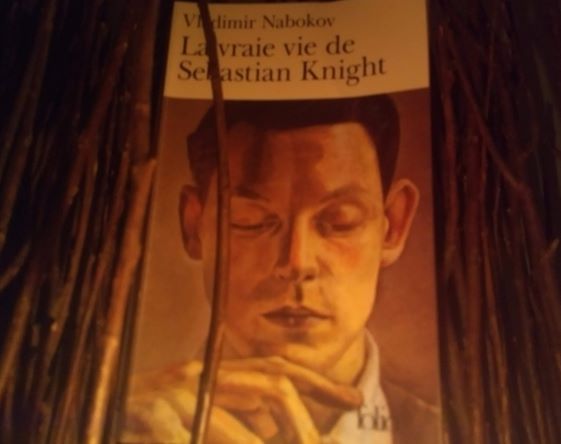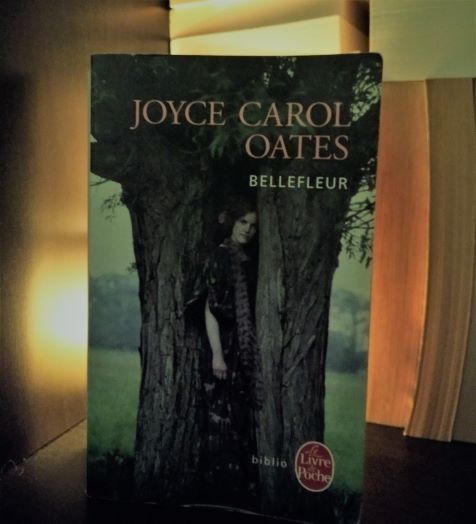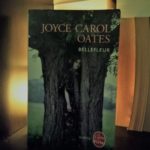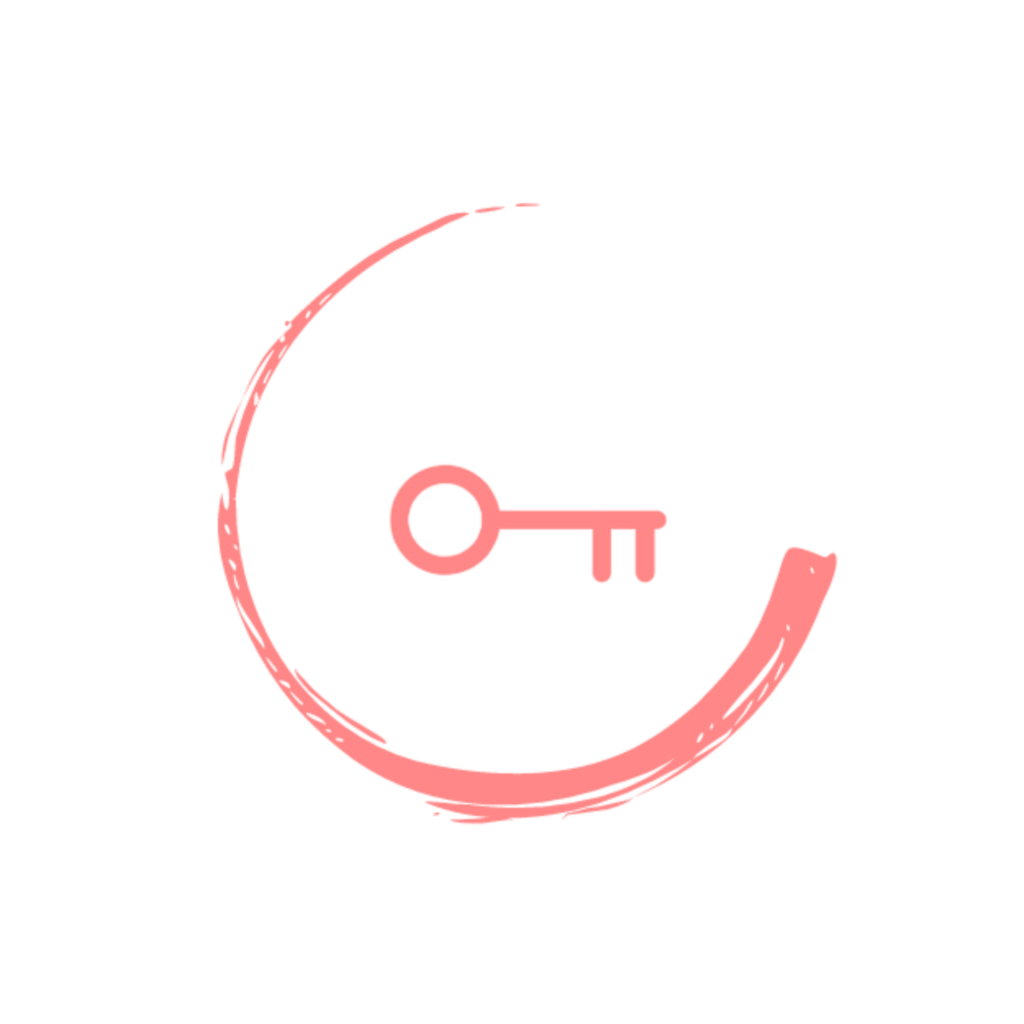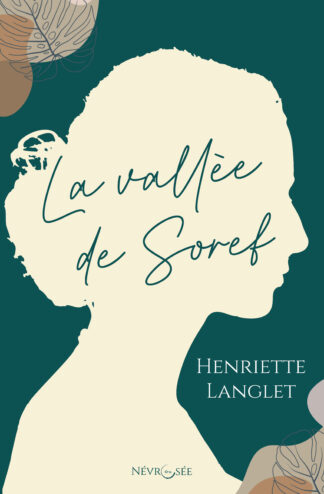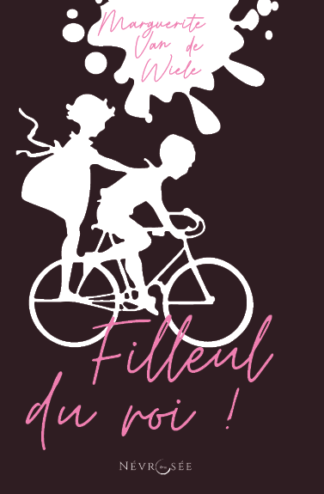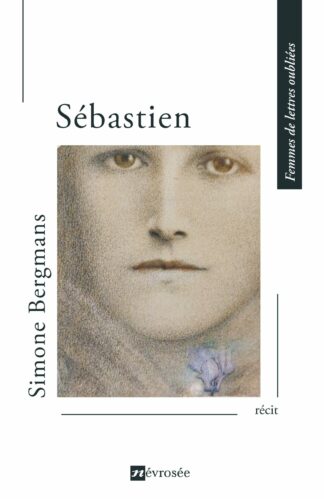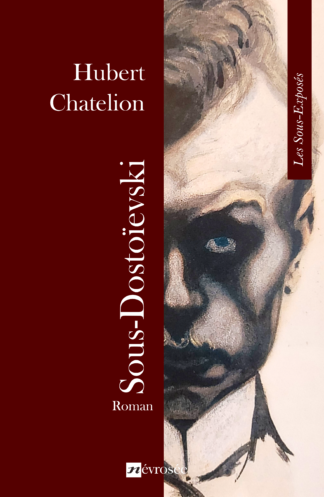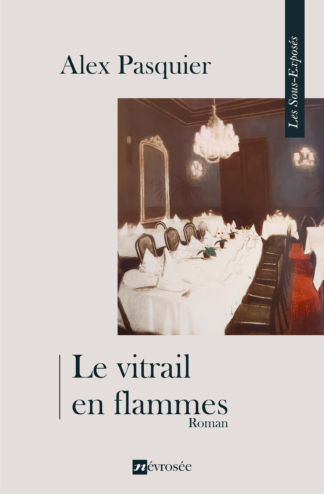Lignes de faille est l’un de mes romans contemporains préférés. Écrit par Nancy Huston, que j’ai déjà mentionné dans d’autres articles (dans l’article : « Plaidoyer pour la fiction notamment).
Écrivaine franco-canadienne, née au Canada dans les années 50. Elle est, parmi les auteurs contemporains, une de celles que je trouve la plus intéressante. Passionnée, engagée et en même temps humble. Elle ne prétend rien. Fait preuve, avec beaucoup d’intelligence, d’une authenticité devenue, à mon sens, trop rare dans la littérature française.
Lignes de faille a été publié pour la première fois en 2006. Ce n’est pas un long roman, un peu plus de 370 pages aux éditions J’ai Lu.
Une histoire racontée par des enfants
Lignes de faille est une histoire de famille, racontée par quatre enfants. Quatre enfants issus chacun de générations différentes.

Se mettre dans la peau d’un enfant est souvent hasardeux pour un auteur. Peu arrivent en effet à élaborer une voix suffisamment crédible pour que le lecteur y voit celle d’un enfant sans deviner l’adulte qui parle derrière. Mais Nancy Huston y parvient à merveille. Le lecteur y croit. Même si le discours n’est pas pour autant tout à fait enfantin. Au contraire. On pourrait d’ailleurs penser que la maîtrise du langage des narrateurs qui doivent avoir entre 6 et 7 ans pourrait décrédibiliser leur récit mais ce n’est pas le cas. Nancy Huston se tient sur un fil, en équilibre, et le récit tient la route.
Découvrir l’histoire à travers ces voix enfantine permet de capter presque instantanément l’empathie du lecteur. Parce que les enfants suscitent son instinct de protection. Le lecteur est alors plus apte à lui pardonner ses fautes ou défauts de caractère.
La construction du récit
Les récits qui se succèdent, sont incomplets. Comme des prélèvements d’un morceau d’enfance des protagonistes. Le lecteur devra donc recomposer lui-même les événements, dans leur enchaînement, mais également dans leurs relations de causes à effet. Ce dont l’auteur ne parle jamais. C’est une magnifique exécution du principe que tente de suivre tout écrivain : montrer plutôt que dire. Jamais Nancy Huston ne nous dit qu’untel est devenu acerbe parce qu’il à été confronté dans son enfance à de nombreux conflits avec sa mère ou son père, et pourtant, le lecteur en est parfaitement conscient. Mais il le découvre et le comprends lui-même, sans que l’auteur n’ait à le lui expliquer.
Lignes de failles nous montre, tant par son histoire que par sa construction originale, comment des chagrins ou des difficultés vécues par nos ancêtres, même si nous ne les avons pas connus, survivent à travers les générations futures. Par relations, conscientes ou non, de cause à effet. Tel chagrin engendre tel comportement qui conditionne le comportement de la génération suivante et ainsi de suite.
Lignes de faille sort le lecteur de lui-même
Un autre élément intéressant dans la construction du récit est la manière dont l’auteur agence les différentes histoires. On part de l’histoire la plus récente pour remonter à la plus ancienne. Nous retrouvons donc enfants, des personnages que nous avons abordés adultes, indirectement, dans les récits des enfants précédents. Ces personnages, initialement abordés de l’extérieur, à travers la voix d’un enfant sont tout à coup dévoilés au lecteur, non seulement à la première personne, mais également alors qu’il était lui-même un enfant.
Cette manière de procéder confronte le lecteur à ses propres schémas de fonctionnement. En lisant la première histoire, racontée par un enfant, il ne peut s’empêcher, fut-ce inconsciemment, de ‘prendre parti’ voir de juger certains intervenants. Mais le récit suivant est celui de l’un de ces intervenants que le lecteur s’était permis de juger. En découvrant son histoire, il se met à comprendre des actes qu’il a peut-être précédemment mal compris voire jugés absurdes. Il se met alors à relativiser. Se repositionner. Il s’adoucit.
Une humilité qui convoque l’intelligence du lecteur
En se limitant à donner au lecteur tous les ingrédients pour lui permettre de comprendre lui-même ce qu’elle ne dira jamais, Nancy Huston montre qu’elle fait confiance au lecteur. Lui laisse la place qui lui revient dans le récit. C’est en effet au lecteur qu’il appartient de construire la vie des personnages entre leur récit d’enfant et ce que nous découvrons d’eux, adultes, à travers les autres récits.
Par ailleurs, en présentant l’histoire dans un ordre antéchronologique, elle sort le lecteur de ses propres frontières, puisqu’en suscitant successivement, pour un même personnage, des émotions qui se contredisent, elle le force à sortir de lui-même pour analyser sa propre subjectivité et son incapacité à jamais comprendre le comportement des gens, tant leurs sources lui échappent.
Un roman à la fois humble et intelligent. Une magnifique leçon de vie sans prétention moralisatrice.