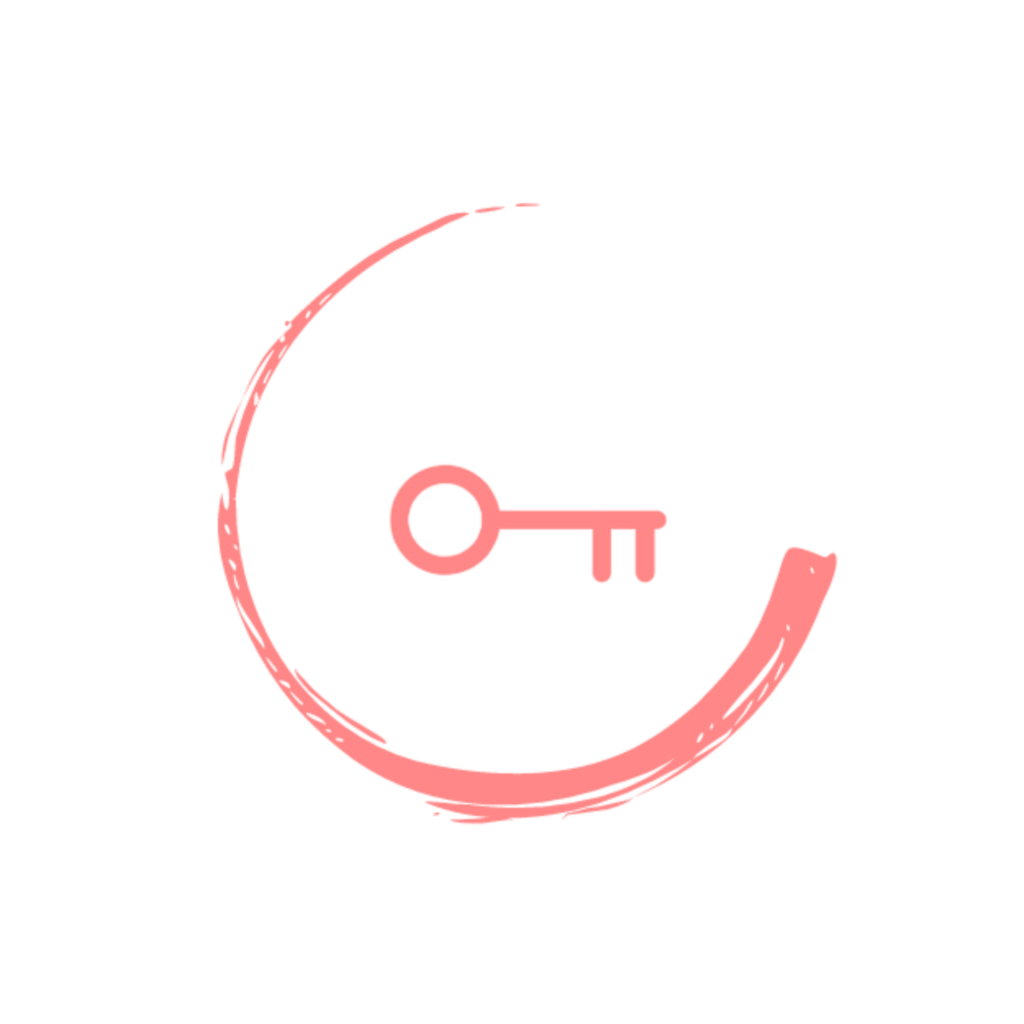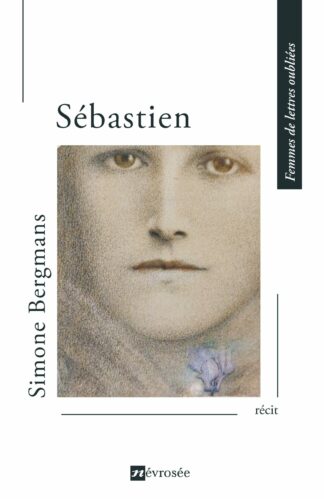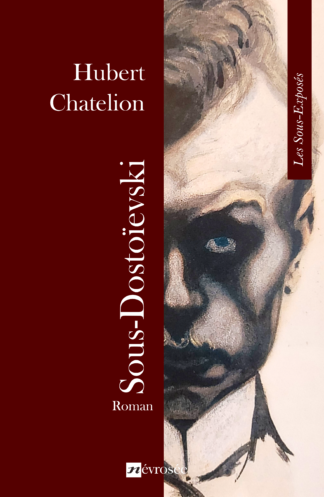I
Patrice Dormesson se leva de table, alluma une cigarette et entraîna au salon Dora, sa jeune belle-sœur qui venait d’être sa voisine de table.
Julienne, après s’être assurée qu’il ne restait plus une seule noix dans le plat de fruits, repoussa son assiette surchargée de coquilles vides et quitta la table à son tour.
Alicia resta seule entre ses deux beaux-frères : Christian Dormesson et Germain Savil.
Les deux hommes poursuivaient par-dessus sa tête une interminable discussion financière à laquelle elle ne prenait aucune part. Les mots glissaient sur elle sans accrocher sa pensée : dévaluation,… balance commerciale,… déficit budgétaire…
Son esprit suivait Patrice au salon, comme il l’avait suivi à table, dans tous ses gestes, dans toutes ses réparties. Elle ne pouvait s’intéresser qu’à son mari. Pensait-elle à son ménage, à ses enfants, à un livre, à un paysage, c’était comme à l’accessoire d’une vie que Patrice seul remplissait. Quant aux idées générales et aux discussions qu’elles pouvaient faire naître, elles ne l’agitaient que lorsque Patrice lui-même se mettait à en discuter devant elle. Elle restait alors suspendue à ses lèvres, devançant souvent sa pensée et ne concevant pas qu’il pût dire autre chose que ce qu’il disait. Depuis douze ans qu’ils étaient mariés, elle n’avait cessé de penser comme lui.
De la place où elle était restée, elle pouvait l’apercevoir, sur le long canapé de satin vert, assis entre Dora et Julienne qui se parlaient, penchées devant lui. Appuyé au dossier, les bras en croix derrière les deux femmes, il semblait considérer le groupe resté à table. Bien sûr, il l’attendait. Il ne pouvait admettre que sa femme n’eût pas quitté la table en même temps que lui.
Or, si Alicia restait assise à écouter, sans l’entendre, cette aride conversation entre ses deux beaux-frères, c’est qu’elle savait, comme toutes les grandes amoureuses, que la moindre distance rapproche les êtres qui s’aiment.
Elle le vit se lever, éteindre sa cigarette dans un cendrier et elle admira son grand corps élégant, vêtu avec une certaine recherche, plus fort, plus mâle qu’autrefois, et son visage rieur, aux plis tendres connus d’elle seule.
Elle ne perdait pas un mot de ce qu’il disait, des boutades sans importance, mais qui faisaient résonner la voix dont toutes les inflexions lui étaient chères.
« Au fond, se disait-elle, c’est comme cela, parmi les autres, que je le vois le mieux. Quand il est seul, devant moi, je subis tellement sa présence que je ne le vois plus, je ne sais plus comment il est. Et voilà bien pourquoi j’arrive à supporter ces dimanches en famille qui devraient m’être odieux, puisqu’ils me privent en partie de lui. »
À la mort de sa mère, Patrice ayant hérité de la maison paternelle où il était installé comme avocat, avait tenu à maintenir la tradition qui voulait que tous les dimanches les trois enfants vinssent manger chez leur mère. Il aimait, disait-il avec une fausse ironie, « ces mœurs patriarcales et désuètes ».
Du jour où il les avait présidés, ces repas dominicaux avaient changé d’allure. Du vivant de Mme Dormesson qui était au régime, on mangeait des plats fades sur une nappe blanche empesée et l’on parlait en demi-teinte de sujets anodins qui ne pouvaient blesser ses oreilles de vieille femme dévote. Ces déjeuners semblaient interminables et les jeunes ménages s’en allaient tôt, sous des prétextes divers.
Depuis qu’Alicia était devenue la maîtresse de maison, on mangeait, sur une table artistement dressée et fleurie, des mets choisis et l’on buvait, sans trop de mesure, les bonnes bouteilles que le vieil avocat Dormesson avait entassées dans sa cave, sa vie durant.
Patrice était heureux de pouvoir réunir sous le toit paternel, devenu le sien, son frère et sa sœur et d’éprouver ainsi, de manière tangible, une fois par semaine, le lien puissant qui les unissait. Il avait l’esprit de famille et il imaginait déjà ses propres enfants, parvenus à l’âge d’homme, se réunissant aussi, quand il n’y serait plus et recréant, par leur étroite entente, le symbole de l’amour qui les avait fait naître.
— C’est bien simple, disait Germain Savil pour se résumer, la France est en déficit depuis Louis XIV.
— Depuis bien avant, disait Christian Dormesson. Voyez cet amoncellement de châteaux et de cathédrales, de trésors enfouis dans les moindres musées de province. Il n’y a pas un coin perdu qui n’ait des vestiges d’une richesse inouïe. C’est tout cela qui a ruiné la France. Pas vrai ?
Il scruta un instant le regard d’Alicia pour savoir ce qu’elle en pensait.
— Évidemment.
Qu’aurait-elle pu dire d’autre ? Elle ne savait vraiment plus de quoi ces deux hommes parlaient.
— Alicia, le café.
Du salon, Patrice l’appelait.
Pourquoi ne disait-il pas « chérie » ? Sans doute par pudeur, devant sa jeune belle-sœur qui, il le savait, ne supportait pas les mots tendres et ne manquait jamais de les railler. Elle avait une verve mordante dont chacun se méfiait.
De sa place, Alicia pouvait la voir cette « petite Dora » comme on l’appelait toujours, tendue et mal assise sur l’extrême bord du canapé, visiblement gênée par le bras de Patrice. Elle écoutait Julienne qui s’enlisait une fois de plus dans les considérations psychologiques qui faisaient habituellement le sujet de ses conversations.
Dora était encore une toute jeune femme.
Elle sortait de pension et n’avait pas dix-huit ans quand Christian l’avait épousée, cinq ans auparavant, alors qu’on le croyait voué au célibat.
Invité par des amis à chasser, il l’avait rencontrée le soir au dîner qu’avait organisé chez lui, le notaire Damien, propriétaire de la chasse.
— Voilà ma fille Dora qui va vous faire les honneurs de la maison…
Les cheveux en bataille, maigre et efflanquée dans sa robe de pensionnaire, un regard furieux dans ses yeux de braise, Isadora Damien s’était exécutée. Elle avait servi le porto, placé les invités à table, manié la sonnette du service avec un minimum de bonne grâce et avait eu tôt fait de décourager par ses réponses laconiques les convives qui voulaient lui plaire.
Christian s’était subitement épris de ce qu’il appelait dans son cœur « une vraie jeune fille ». En moins d’une heure, il aimait à la folie ses cheveux flottants, aux boucles en désordre, son corps gracile et chaste dans sa robe lâche et, par-dessus tout, ses yeux noirs dont le regard ne pliait devant aucun autre. Trois mois après, il l’épousait.
Patrice et Alicia avaient eu assez de peine, au début, à l’apprivoiser. Farouche et agressive, elle ne se laissait pas facilement approcher. Dans la suite, elle s’était cantonnée dans une ironie volontiers cruelle, réservant toutefois à la femme de Patrice des élans d’amitié aussi inattendus que déraisonnables : « Alicia, je me demande si je vous aime. » ou bien « Alicia je me demande pourquoi je vous aimerais. J’ai toujours aimé les gens pour leurs défauts et vous n’en avez pas. » À de tels aveux, Alicia répondait de tout son cœur, car elle ne demandait, elle, qu’à aimer, c’est-à-dire à reléguer dans un grand cercle de sympathies tout ce qui excédait le noyau brûlant de sa passion pour Patrice.
— Alicia, le café.
De nouveau, son mari l’appelait. Cet appel banal qu’il venait de formuler, ce nom qu’il venait de crier à travers le salon, n’était-ce pas, tout de même, l’appel de son amour ? Car ce n’était pas tant le café qu’il réclamait que sa présence dont il avait lentement appris à ne plus pouvoir se passer.
Germain Savil rejeta sa serviette et se leva de table.
Christian essaya encore de capter l’attention de sa belle-sœur et de lui faire entendre les quelques arguments qu’il n’avait pas eu l’occasion d’exprimer. Il aimait ainsi retenir Alicia pour lui seul, sous le prétexte d’une discussion quelconque, car il y avait entre sa belle-sœur et lui un passé trouble qu’il espérait toujours faire renaître.
Alicia avait cru l’aimer au temps où ils fréquentaient ensemble l’académie. Joli garçon, il ravageait alors les cœurs tout en se gardant bien d’engager le sien. Mais qu’est-ce aimer pour une fille de dix-sept ans ? Une poignée de mains prolongée, une pochette dérobée, un compliment à la volée, des livres prêtés, jamais rendus…
Puis Patrice était venu, un Patrice très grand frère qui la faisait danser au bal en lui donnant des conseils : « Se garder d’aimer et de souffrir. » Entre ces deux abîmes, il avait su si bien la retenir dans ses bras… Christian Dormesson pouvait la regarder dans le fond des yeux tout en l’enveloppant de propos inutiles, jamais plus il ne s’y verrait.
Son beau-frère abandonna brusquement les finances publiques pour lui dire à brûle-pourpoint :
— Tiens ! Devine qui j’ai aperçu hier, en passant devant chez eux, en voiture ?
Son regard allumé fouillait celui de sa belle-sœur.
— …Les Mallien, le père et la mère. Je les ai parfaitement reconnus.
— Ah !
— Tu te souviens que j’étais amoureux de Simone ?… Ils doivent être revenus d’Argentine… et ils habitent toujours la même maison. Je me suis rappelé leurs petites sauteries, l’orangeade et le pain d’épices et le tapeur qui suait… Cela m’a fait un drôle d’effet… Voilà plus de quinze ans !… Tu devrais aller jusque-là… savoir ce qu’ils sont devenus, Simone et Bernard…
Il lui demandait cela d’une voix pressante comme s’il lui demandait un plaisir personnel.
Mais il vit qu’elle rêvait et crut devoir encourager sa rêverie :
— Quels gosses nous étions !… Cette première jeunesse, n’est-ce pas ce que nous avons eu de meilleur ?
Elle sourit et il voulut aussitôt déchiffrer son sourire :
— À quoi penses-tu ?
D’une voix contenue, il insistait :
— Je suis sûr que nous pensons à la même chose.
Elle le revoyait blond et mince, entouré d’un groupe de jeunes filles, dans l’embrasure d’une porte-fenêtre ouverte sur le jardin ensoleillé. L’anniversaire de Simone Mallien, par une chaude journée de juin. Elle lui avait offert un coffret de plâtre d’inspiration gothique qu’elle croyait fort beau et qui en réalité était fort laid. Elle avait revêtu une robe blanche brodée de points de croix, rouges et bleus, que Mme Mallien admirait. Elle s’ennuyait seule, au fond du salon…
Non, ils ne pensaient certainement pas à la même chose.
Mais soudain la voix de Patrice balaya l’écran du souvenir :
— Eh ! bien, chérie, ce café ?
Cette fois, il avait dit « chérie ». Son impatience l’avait emporté sur la crainte du ridicule. Alicia ne put réprimer un air de joie triomphante et quitta la table pour aller s’enquérir à la cuisine de ce café qui ne venait pas.
*
* *
Après le café, la table de jeux fut dressée au milieu du salon et les trois hommes s’y installèrent avec Julienne, comme quatrième, pour jouer au bridge.
Dora, qui ne jouait à aucun jeu de cartes, alla s’allonger sur le divan et se mit à fumer, les yeux perdus au plafond, plongée, semblait-il, dans une profonde rêverie. Mais Alicia, tout en ramassant les tasses vides, remarqua la jupe légèrement relevée sur les jambes bien faites, gainées de bas arachnéens, la main fine, aux ongles impeccables, négligemment suspendue dans le vide, le coussin vieil or, sous les boucles noires et elle pensa que tout cela n’était pas l’effet du hasard. Dora, qui était devenue une jeune femme ravissante et qui ne le savait que trop, tenait toujours à mettre sa beauté en valeur. À la table de bridge, les joueurs étaient trop absorbés par leur jeu pour se laisser distraire par de jolies jambes et Alicia finit par se dire que c’était à sa seule admiration que Dora dédiait son joli corps étendu.
Elle se serait volontiers installée à sa place, non pour montrer ses jambes, mais pour essayer de dormir et d’échapper ainsi à l’ennui de ces longues heures où Patrice, accaparé par les cartes, semblait se détacher d’elle.
Elle s’arma d’un tricot et vint s’asseoir au pied du divan où Dora s’était allongée.
Longtemps le silence régna entre les deux femmes.
Ce fut Dora qui, toujours immobile, parla la première et dit d’une voix contenue :
— Alicia, je vous admire.
Elle avait de ces accès de tendresse et d’abandon aussi déroutants que ses rudoiements.
Alicia se méfiait :
— Pourquoi ?
Dora se redressa et dit d’un ton brusque :
— Ah ! Il faut encore que je vous dise pourquoi ? Comme si vous ne le saviez pas aussi bien que moi. Quel est l’être au monde qui n’est pas imbu de sa supériorité ?
— Mais Dora, je ne vois vraiment pas ce que j’ai d’admirable, si ce n’est mon ardeur au travail, un dimanche. Vous savez que je déteste rester inactive.
— Ne faites donc pas l’idiote.
— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Qu’est-ce que je vous dis ?
Dieu ! que cette Dora était énervante avec cette façon de dialoguer.
En voyant l’air renfrogné de sa belle-sœur, Dora reprit aimablement :
— Vous ne croyez pas que chaque être, si médiocre soit-il, est tout de même particulièrement content de soi ?
— Peut-être ?
— Vous ne vous sentez pas supérieure à toutes les autres femmes ?
Dans le souci d’être sincère, Alicia prit la peine de réfléchir. Supérieure, sans doute, elle l’était, par la qualité de son amour pour Patrice, par l’exceptionnel bonheur qui lui était dévolu. Elle dit seulement :
— Je ne me suis jamais occupée des autres femmes. Mais il y a certainement des femmes qui me sont supérieures, et par leur beauté, et par leur intelligence…
Elle allait ajouter : « Vous par exemple ». Mais sa jeune belle-sœur ne lui en laissa pas le temps :
— Est-ce que vous admettriez par hasard que vous n’êtes pas seule digne de l’amour de votre mari, puisqu’il y a des femmes qui vous sont supérieures ?
On ne pouvait avoir avec Dora de conversation sensée et reposante. Il fallait sans cesse, avec elle, se tenir sur la défensive, parer à ses attaques, à ses questions insidieuses, à ses méchancetés gratuites.
Mieux valait répondre en plaisantant :
— Vous savez bien que l’amour est aveugle.
— Vous croyez donc qu’il vous aurait aimée laide et stupide ?
N’appréciant pas du tout ce genre d’investigation, Alicia cherchait à s’esquiver par des réponses évasives :
— Qui sait ?
— Dites que vous le prenez pour un imbécile.
Alicia prit le parti de rire :
— Pauvre Patrice !
Patrice, en entendant son nom, lança :
— Eh ! quoi ! On parle de moi ?
Dora jeta à sa belle-sœur un long regard de reproche et toujours en demi-teinte :
— Pourquoi me décevez-vous ? Je veux vous croire supérieure et toujours je vous trouve surfaite.
Alicia ne broncha pas et se remit à tricoter. Elle était habituée à ce genre d’effet chez Dora. Résolue à garder son sang-froid, elle lui dit après un bref silence :
— Vous savez bien que je ne suis pas susceptible. L’autre attrapa la balle au bond :
— Susceptible ? Mais au fait, dites-moi, qu’est-ce que c’est que la susceptibilité ?
Ah ! non ! Alicia en avait assez. Épiloguer sans fin sur des notions abstraites, vider les mots de leur sens pour en chercher le sens profond, c’était la passion de Dora, mais cela épuisait sa belle-sœur à qui douze ans de bonheur conjugal avaient donné cet équilibre qui dispense de douter des mots.
À ce moment, Julienne qui était « morte » au jeu se mit heureusement au piano. Il y avait ainsi, durant ce morne bridge du dimanche, durant ce tête-à-tête énervant avec un être capricieux, des oasis de musique où Alicia pouvait se détendre, oublier les intrus, retrouver, pour un instant, la sérénité de son âme.
Mais cela ne durait pas. Rappelée au jeu, Julienne s’interrompait souvent au milieu d’une phrase musicale, plongeant ainsi brutalement le salon dans un douloureux silence que rompaient aussitôt les annonces des bridgeurs.
Chopin… Alicia, oubliant son ennui, les questions harcelantes de sa jeune belle-sœur, se laissait aller au fil des notes. Elle se mit à penser à ses enfants qui passaient la journée chez sa mère et qui rentreraient à six heures. À cette heure-là, les autres s’en iraient. Elle donnerait le bain aux petits, les coucherait tôt, après les avoir fait manger à part. Alors, commencerait le meilleur moment de la journée, celui pour lequel cette journée d’ennui aurait valu la peine d’être vécue, ces heures tendres du soir où, l’un en face de l’autre, ils se grisaient du bonheur de s’aimer… Intimité…, cette chaleur…, cette confiance…
La jeune femme sentit le regard de son étrange belle-sœur peser sur elle. Souvent, Dora la fixait ainsi de ses yeux sombres, d’un insoutenable éclat. Une fois de plus, Alicia détourna la tête.
Pouvait-elle lui dire : « Ne me regardez pas comme cela. Laissez-moi jouir en paix de cette musique. Dans un instant, Julienne s’arrêtera et je redeviendrai volontiers votre proie. » ?
Soit lassitude, soit défaillance de mémoire, Julienne s’interrompit avant qu’on l’eût rappelée au jeu et Dora, comme si elle eût suivi la pensée d’Alicia, murmura :
— Vous me trouvez indiscrète ?
— Moi ? Mais pas du tout.
Alicia répondait au hasard, s’efforçant de sourire, de rester aimable.
Dora reprit son ton agressif :
— C’est bien ce que je vous reproche. Les gens trop heureux ne peuvent pas le cacher. Il faut que cela s’étale. C’est une véritable infirmité.
— Que voulez-vous dire ?
— Regardez-vous dans une glace. Votre bonheur éclate sur votre visage.
Le ton était redevenu indifférent. Elle ne lui aurait pas dit autrement : « Vous avez un bouton sur le nez. »
Dora quitta brusquement le divan pour aller se planter derrière Patrice dont elle fit mine de regarder le jeu.
Alicia vit son mari lever la tête vers « la petite belle-sœur » comme il l’appelait et lui sourire.
Elle pensa que c’était elle qui aurait dû se trouver derrière Patrice, elle qui aurait dû recevoir ce sourire. Elle sentit dans ses paumes la forme des chères épaules sur lesquelles ses mains se seraient appuyées et, n’y tenant plus, elle gagna la table, se glissa résolument devant Dora, mit ses bras autour du cou de Patrice et prit une voix enjouée et désinvolte pour demander :
— Alors, on gagne ?
Patrice ne répondit pas tout de suite. Il attendait la réussite d’une impasse qui ne se fit pas, puis à la façon d’un chat, il caressa de la joue la main qui s’attardait sur son épaule :
— Je perds tout ce que je veux.
La plaisanterie classique ne pouvait manquer de suivre. Dora s’en chargea
— Malheureux au jeu, heureux en amour.
Bien qu’Alicia sentît que Patrice retenait ses mains de tout son désir, elle les retira et retourna s’asseoir à l’écart de la table de jeu, à contre-jour, cette fois, pour cacher à sa belle-sœur sa joie retrouvée.
Mais Dora avait avancé une chaise et semblait ne plus vouloir quitter les joueurs. Germain insista pour l’initier aux cartes. Il ne pouvait admettre qu’on ne comprît rien au bridge.
Christian céda sa place à sa femme et vint s’asseoir auprès de sa belle-sœur. Le jour d’hiver baissait et l’ombre envahissait le salon. Assis tout près de la jeune femme, Christian s’abstenait de lui parler. Il aimait ainsi entretenir avec elle de longs silences pernicieux. Les explications bruyantes de Germain, à la table de jeux, les confinaient dans leur silence.
Alicia, cependant, restait maîtresse d’elle-même. Rien, dans l’attitude de Christian ne pouvait désormais la troubler et, si elle continuait de se taire, si elle ne faisait pas un geste pour éclairer le coin sombre où ils se trouvaient, c’est qu’elle tenait à éprouver cette indifférence. Tant pis pour lui s’il interprétait autrement sa façon d’être.
Mais Patrice aussi devait l’interpréter autrement, car il lui cria tout à coup d’une voix impatiente :
— Allume, on n’y voit plus.
Puis il supplia humblement :
— Viens t’asseoir à côté de moi.
*
* *
Pourquoi, au moment de s’en aller, Germain Savil émit-il l’idée de finir ensemble la soirée au théâtre ?
Le dimanche soir, la servante était sortie et Alicia ne pouvait songer à laisser ses enfants seuls. Elle insista, en vain, sous le regard narquois de Dora, pour que Patrice, qui aimait le théâtre, y allât sans elle.
Lorsqu’elle redescendit auprès de lui, après avoir couché les enfants, elle sentit que leur soirée était gâchée. Elle pensait que Patrice regrettait de ne pas être sorti avec les autres et elle eut la maladresse de vouloir le lui faire avouer.
Pourquoi protestait-il ? Ses protestations sonnaient aussi faux que les mots tendres dont elle usait pour le convaincre.
Il finit par s’écrier :
— Tais-toi ! si tu ne veux pas me faire regretter réellement de ne pas être allé avec eux !
L’aveu qu’elle souhaitait et redoutait tout à la fois ! Les larmes lui vinrent aux yeux.
Impatienté, Patrice attrapa une revue juridique qui traînait à portée de sa main et se jeta dans le premier fauteuil venu.
Alicia savait qu’il ne lui restait plus, dès lors, qu’à se retirer.
Tout rentrerait dans l’ordre si elle n’ajoutait pas un mot, si elle laissait Patrice se calmer, se ressaisir et retrouver son amour pour elle, hors de sa présence. Elle monta se coucher.
Les enfants dormaient déjà. D’une main légère, elle effleura leur front tiède, rajusta la couverture, cueillit de ses lèvres leur souffle égal. Le bonheur était là, dans la santé de ses enfants endormis.
En entrant dans sa chambre, elle surprit son image dans la glace : des yeux embués, une bouche amère, un visage prêt à pleurer. Où était donc cette impudente expression de bonheur que Dora lui reprochait l’après-midi même ?
Oui, on pouvait être heureuse et porter soudain ce visage triste, comme un masque.
Elle se mit à imaginer que Patrice était au théâtre. Entièrement absorbé par le spectacle, il n’avait pas une pensée pour elle. À l’entracte, il n’avait même pas le temps de regretter son absence, il commentait la pièce avec Dora… Il subissait le charme de ses yeux sombres, se laissait éblouir par sa faconde. Dora était belle. On la regardait et Patrice s’enorgueillissait d’être vu en sa compagnie…
Non ! C’en était trop ! Pourquoi s’amusait-elle ainsi à se torturer ? Comment pouvait-elle être ridicule à ce point ? Son mari n’avait-il pas refusé d’aller au théâtre sans elle ? Mais dès lors, pourquoi était-il de mauvaise humeur ?…
Le front appuyé contre la glace, les yeux fermés sur son tourment, Alicia ne s’apaisait pas.
Elle eut pourtant un sursaut d’énergie, s’arracha du miroir et se mit à se déshabiller.
« Sentimentalité de femme, pensait-elle. Ah ! Patrice ne divague pas, lui. Il lit sérieusement sa revue et est en train d’oublier cette soirée gâchée. Bientôt, il viendra se coucher contre moi, tendrement, comme chaque soir et mon envie de pleurer passera et mon visage, dans l’ombre, reflétera ce bonheur que Dora a l’air de m’envier. Dora… Curieuse fille. À la fois bonne et méchante, drôle et triste, fanfaronne et timide… M’aime-t-elle ? »
Enfin couchée, presque réconfortée, elle ne pensait plus qu’à Dora.
Quelle était sa vie auprès de Christian ? L’aimait-il comme il l’avait aimée elle, à dix-huit ans, alors qu’elle était enfin guérie de lui et qu’elle se mettait à aimer son propre frère ? N’avait-il pas, alors, parlé de se tuer ?…
Son esprit se cabra. C’était là le domaine interdit de sa pensée, les feuilles mortes, la page effacée. Elle s’était jurée de ne jamais ressusciter le souvenir de cet amour aboli. N’était-elle pas devenue une autre femme, une femme avec d’autres souvenirs ?
Rien n’était plus facile pour cette épouse consommée que de passer des mauvaises pensées aux bienheureux soucis de sa vie quotidienne.
Alicia se mit à composer la journée du lendemain. Les enfants la remplissaient : l’école, la promenade de Françoise, les devoirs, les jeux, la leçon de piano d’Alain. Son professeur le trouvait très doué. Elle le voyait, plus tard, donnant un récital, devant une salle bondée, ou dirigeant un grand orchestre. Elle tâcherait demain de finir le chandail qu’elle lui tricotait. Il lui restait à établir les menus. Quel légume ? Ah ! ils n’aimaient pas les légumes… à part Françoise qui se laissait bourrer de carottes. Jean aimait les pâtes. Mais c’est Alain qui aurait dû les aimer, lui qui était si maigre… Et Patrice ? Patrice, ce dieu tutélaire qui couronnerait de sa présence ces courtes fêtes de la journée qu’étaient les repas… Qu’aimait Patrice ?
Patrice n’abandonna sa revue juridique qu’après l’avoir entièrement lue et annotée. Il ne subsistait plus rien en lui, après cette lecture, de sa nervosité envers sa femme. Il la trouva endormie et, se glissant à côté d’elle, l’enferma dans ses bras pour la nuit.