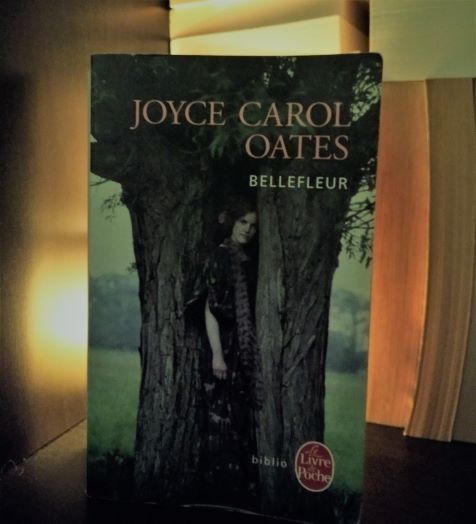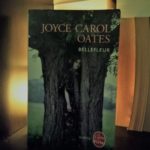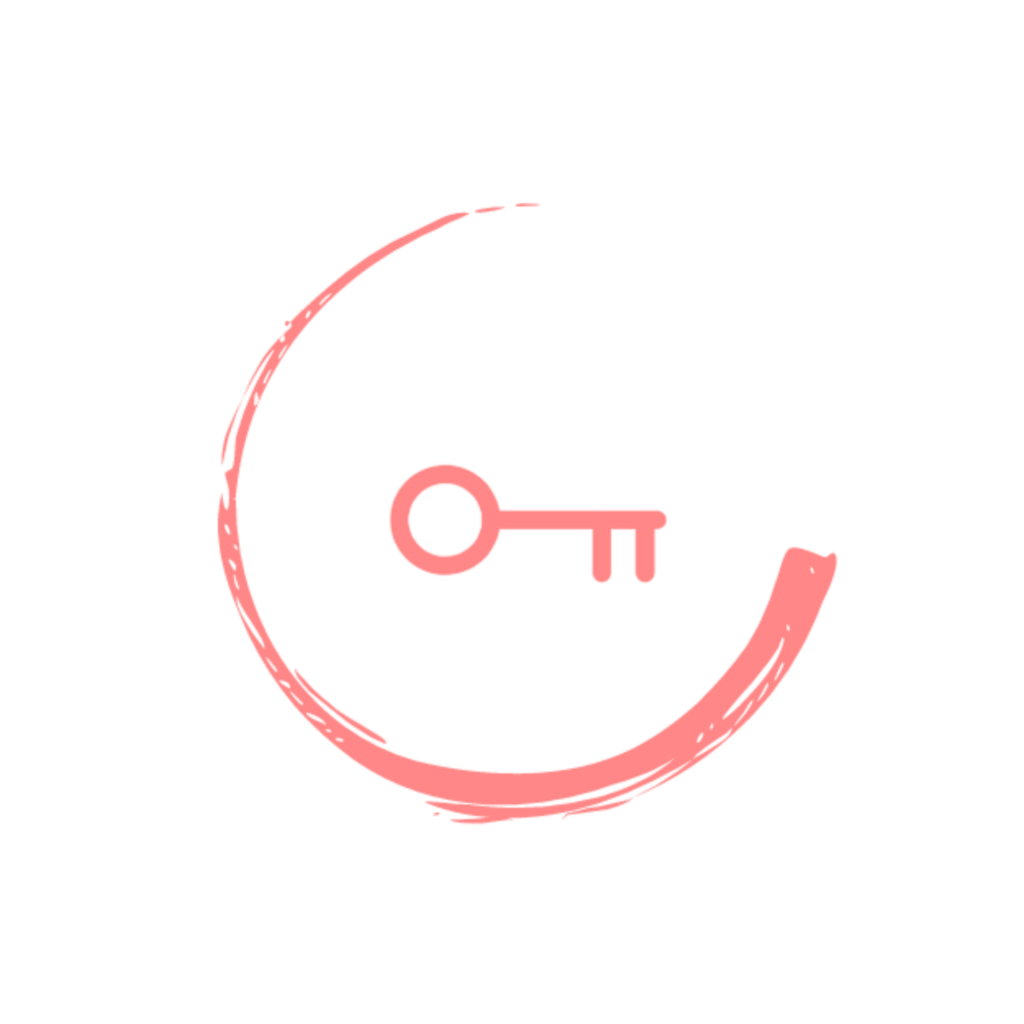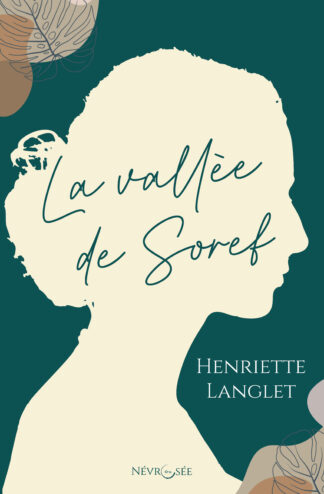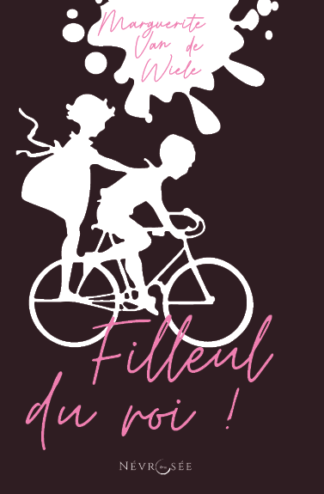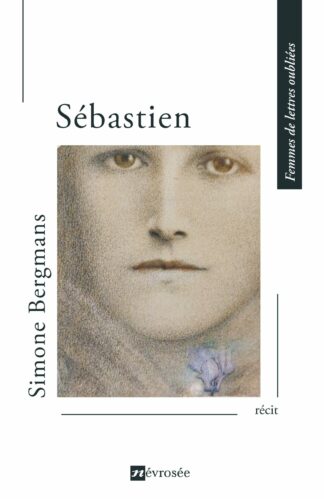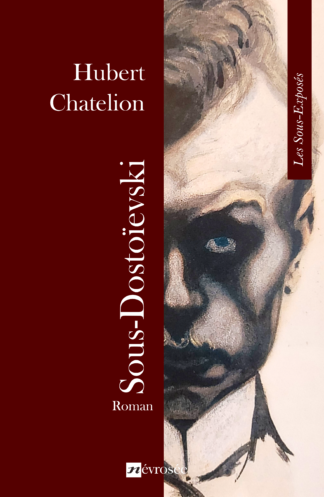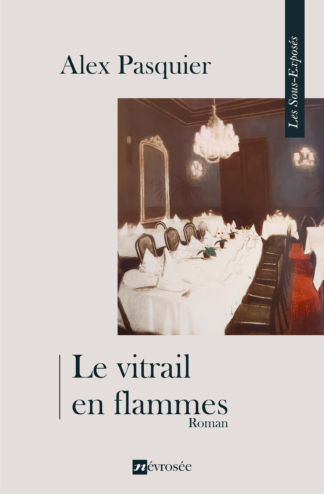4 3 2 1, le dernier roman très médiatisé de Paul Auster.
J’ai lu, il y a longtemps, « Trilogie newyorkaise ». Rien compris. J’ai fini le livre péniblement et n’ai plus jamais eu envie de lire cet auteur. J’avoue, c’était il y a fort fort longtemps. Mais le sentiment de ma propre bêtise reste encore gravé dans ma chair.
Hasard de lecture? Quand un livre nous choisit
À la sortie de 4 3 2 1, mon compagnon qui, lui, est un inconditionnel de l’auteur, se met à le lire.
De mon côté, j’étais en pleine initiation à la lecture en anglais. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j’apprécie particulièrement les auteurs Anglo-saxons. Et je commençais à me dire que ce serait tout de même pas mal si je les lisais en version originale.
J’ai commencé timidement, avec deux livres bilingues qui m’ont fait prendre conscience de deux choses : d’abord que je n’étais pas aussi nulle que je le pensais, ensuite qu’effectivement lire un livre traduit c’était risquer de lire un livre écrit par deux personnes et que si le traducteur était aussi mauvais que celui qui a traduit mes livres bilingues, ça pouvait s’avérer beaucoup plus catastrophique que mon niveau d’anglais.
J’ai donc lu un autre livre, non bilingue cette fois, et je le terminais lorsque mon compagnon, de son côté, commençait 4 3 2 1. Il me propose alors de le lire, me dit que ça devrait me plaire. Je lui répète que mon expérience austérienne ne m’a pas laissé de bons souvenirs et qu’en plus j’avais lu que Paul Auster n’était pas un auteur facile à lire en anglais. Il argumente. Me dit qu’au contraire, 4 3 2 1 est écrit dans un anglais plus qu’abordable.
Et voilà comment j’ai commencé 4 3 2 1, roman de plus de 1000 pages, écrit dans une langue qui n’est pas celle de ma mère, et par un auteur pour lequel je nourrissais un fort a priori négatif.
Je ne vous cache pas que j’étais fort sceptique. Et pourtant. Je ne remercierai jamais assez mon compagnon de m’avoir un peu forcée.
Contexte : l’Amérique des années 50
Le roman se déroule dans les Etats-Unis des années 50. Il offre un excellent panorama des problèmes raciaux en Amérique à cette époque. Il montre également l’impact de la guerre du Vietnam sur les civils américains. Si j’ai eu de nombreuses occasions de pénétrer le point de vue du soldat au combat ou de celui qui en est revenu déchiré, broyé, jamais je n’avais incarné le point de vue des civils américains. Et j’avoue que ça m’a permis de prendre conscience d’une réalité historique qui m’avait jusque-là totalement échappé.
Le roman trahit aussi les passions de Paul Auster pour la littérature, le cinéma et le base-ball. J’avoue ne pas partager la dernière, et par conséquent, j’ai trouvé ces passages un peu plus longuets. Mais je dois reconnaître qu’ils m’ont permis de reprendre un peu mon souffle et de me refaire le petit schéma des quatre histoires que j’ai essayé de tenir dans ma tête toute la durée de la lecture.
Une écriture fluide
Mon compagnon avait raison, 4 3 2 1 est écrit dans un anglais plus qu’abordable, même si certaines phrases sont particulièrement longues. Pourtant, ça ne se ressent absolument pas. Je ne m’en serais d’ailleurs probablement jamais rendue compte, sans certaines interruptions inopinées. Vous savez, quelqu’un entre dans la pièce, commence à vous parlez, et vous lui dites « deux minutes, je termine ma phrase » et c’est là que vous vous rendez compte de la longueur de la phrase qui ne semble pas vouloir se terminer.
Une lecture fluide mais exigeante
Facile à lire, donc, mais exigeant. Ce n’est pas un livre dont on peut lire deux pages par semaine. Il requiert à la fois l’attention et la disponibilité du lecteur, et je pense que c’est important de le savoir.
Des personnages identiques avec des vies différentes
Il s’agit, comme vous le savez sans doute, de quatre versions différentes de la vie d’une même personne. Mais cette vie, comme n’importe quelle autre vie, est peuplée de personnages qui, de facto, se retrouvent plus ou moins tous dans les quatre histoires.
La manière dont Paul Auster mène ces différents personnages est particulièrement impressionante. Parce qu’il n’y a pas que le protagoniste principal, Archie Ferguson, dont l’auteur nous présente des vies potentiellement différentes. C’est le cas de tous les personnages. Ce qui rend bien entendu le livre d’autant plus cohérent, puisqu’il n’y a pas que le personnage principal qui aurait pu avoir une vie différente. Pour un auteur c’est déjà difficile de faire évoluer un personnage conformément au caractère et à la personnalité qui sont les siens. Paul Auster y arrive, non pas une fois, mais quatre. Il met les personnages devant des événements différents et parvient à maintenir malgré ces différences, la cohérence des personnages qui sont donc véritablement les mêmes, avec des vies autres. Un tour de force !
Des choses qui arrivent, d’autres pas, et celles qui restent dans l’ombre
Les différentes histoires sont loin d’être linéaires, on ne suit pas nécessairement les quatre Archie aux mêmes moments de sa vie. Certaines choses arrivent dans une version et pas dans l’autre, et dans une troisième, elles sont laissées dans l’ombre. On ne sait donc pas si elles se sont produites ou pas.
Evidemment entre les similitudes et les différences de chaque histoire, il est parfois difficile de se rappeler qui a fait quoi dans quelle version. Et même en étant très attentif, je pense qu’il y a nécessairement des choses qui échapperont au lecteur. Mais l’auteur est suffisamment habile et subtil pour s’assurer qu’il ne se perde pas tout à fait. Même si je ne vous cache pas qu’il m’est arrivé de retourner en arrière pour me rafraîchir la mémoire, et ça, alors même que je lisais en moyenne plusieurs centaines de pages par jours.
Effet miroir ou quand le lecteur complique la lecture
La construction narrative de 4 3 2 1 provoque une sorte d’effet miroir.
En lisant, en essayant de voir les implications de tel ou tel comportement ou décision sur la vie du protagoniste, je me suis rendue compte à quel point l’être humain essaie, continuellement, de trouver du sens, même là où il n’y en a pas. Et c’est peut-être ce que j’ai trouvé de plus magistral dans 4 3 2 1. C’est qu’entre les lignes, on peut lire que non, notre vie n’aurait peut-être pas été meilleure si on avait fait tel ou tel autre choix. Elle aurait juste été différente, mais il est impossible de savoir ce qu’elle aurait été.
Dans la vie comme dans le récit, nous n’avons jamais tous les éléments
Dans les différents récits, des circonstances identiques, comme les luttes raciales ou l’assassinat de Kennedy influencent différemment les protagonistes.
Les protagonistes eux-mêmes s’influencent mutuellement sans qu’il soit possible de savoir ou de découvrir ce qui a influencé qui ou quoi.
Enfin, un élément qui peut paraître néfaste et semble devoir conditionner la vie du protagoniste dans un sens malheureux peut s’avérer être une chance inouïe. Un événement malheureux ne mène pas forcément au malheur et un événement heureux ne mène pas forcément au bonheur.
Paul Auster nous montre ou nous démontre qu’il y a nécessairement toujours quelque chose qui nous échappe, que nous n’avons jamais tous les éléments, et que, par conséquent, nous ne pouvons prévoir ni l’impact, ni les conséquences de nos décisions ou des événements, pas plus que nous ne pouvons donc les juger, comme le constate Archie lui-même, après un dilemme imaginaire tout à fait savoureux :
« I’m saying you’ll never know if you make the wrong choice or not. You would need to have all the facts before you knew, and the only way to get all the facts is to be in two places at the same time—which is impossible. »
Pourtant nous ne pouvons pas résister à la tentation du contrôle. Impossible de ne pas nous demander en lisant 4 3 2 1 si le hasard des événements conditionne ou non les orientations que nous prenons ou si ces orientations sont-elles elles-mêmes le fruit du hasard.
Et on comprend que cette question tourmente le lecteur, puisqu’elle est liée à celle de notre liberté.
Un petit mot sur la fin, sans rien dévoiler
Paul Auster boucle son histoire de façon magistrale. Je suis souvent déçue par la fin des livres que je lis. Je ne sais pas pourquoi. Ce fut loin d’être le cas ici. Je préfère ne rien dévoiler, mais l’auteur surprend le lecteur par une sorte de tour de passe-passe qui vient lier les quatre histoires d’une manière qui se veut presque apaisante. Il confirme également que, bien qu’inconsciemment et involontairement, le lecteur essaie de trouver du sens à l’enchaînement de chacune des histoires, en réalité, le seul sens à y trouver, c’est celui que lui a donné, arbitrairement, l’auteur. Et d’une certaine manière, il vient, à la fin du livre nous livrer une sorte de confession qui est particulièrement émouvante.
Pour conclure
Vous l’aurez compris, le roman est complet. Il offre une histoire (quatre en fait) qui fonctionnent, il actionne l’imagination et invite à réfléchir tout en offrant au lecteur quantité d’informations historiques qui s’intègrent parfaitement au récit.
Il faut encore noter que Paul Auster réalise cette prouesse avec énormément d’humour. Je vous laisse à ce propos découvrir comment Archie en est venu à s’appeler Ferguson. Et comment Paul Auster nous fait sourire dès les premières pages, pour mieux nous ensorceler. Délicieux. Aussi délicieux que les réflexions que cela entraîne chez Ferguson quand il l’apprendra, quelques centaines de pages plus tard.
Voilà ce que je peux vous dire de l’expérience 4 3 2 1.