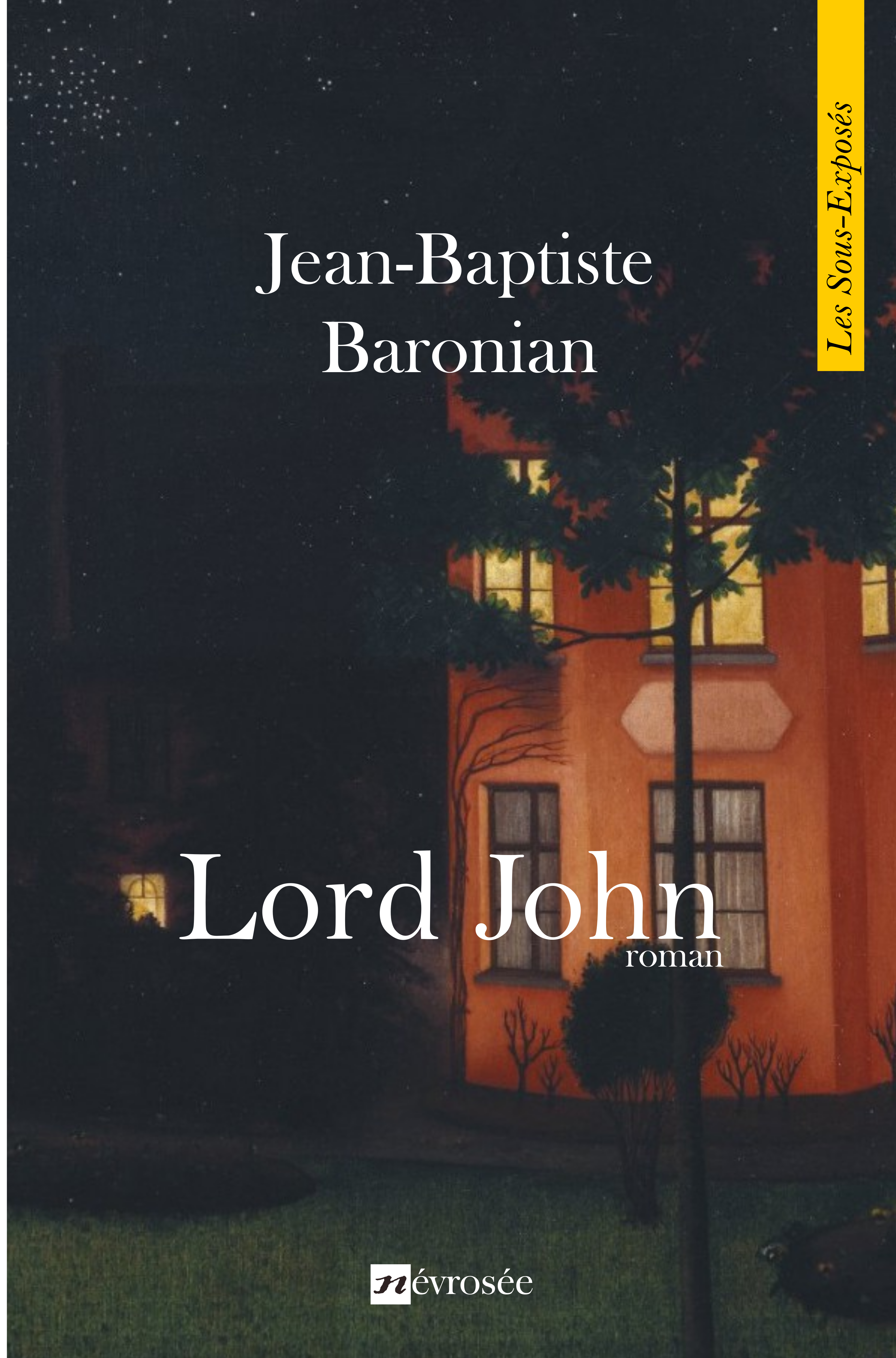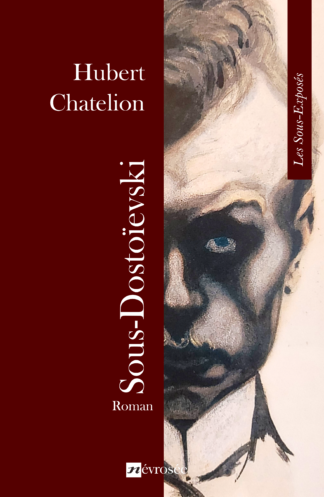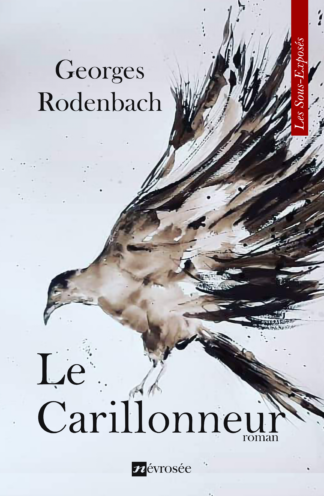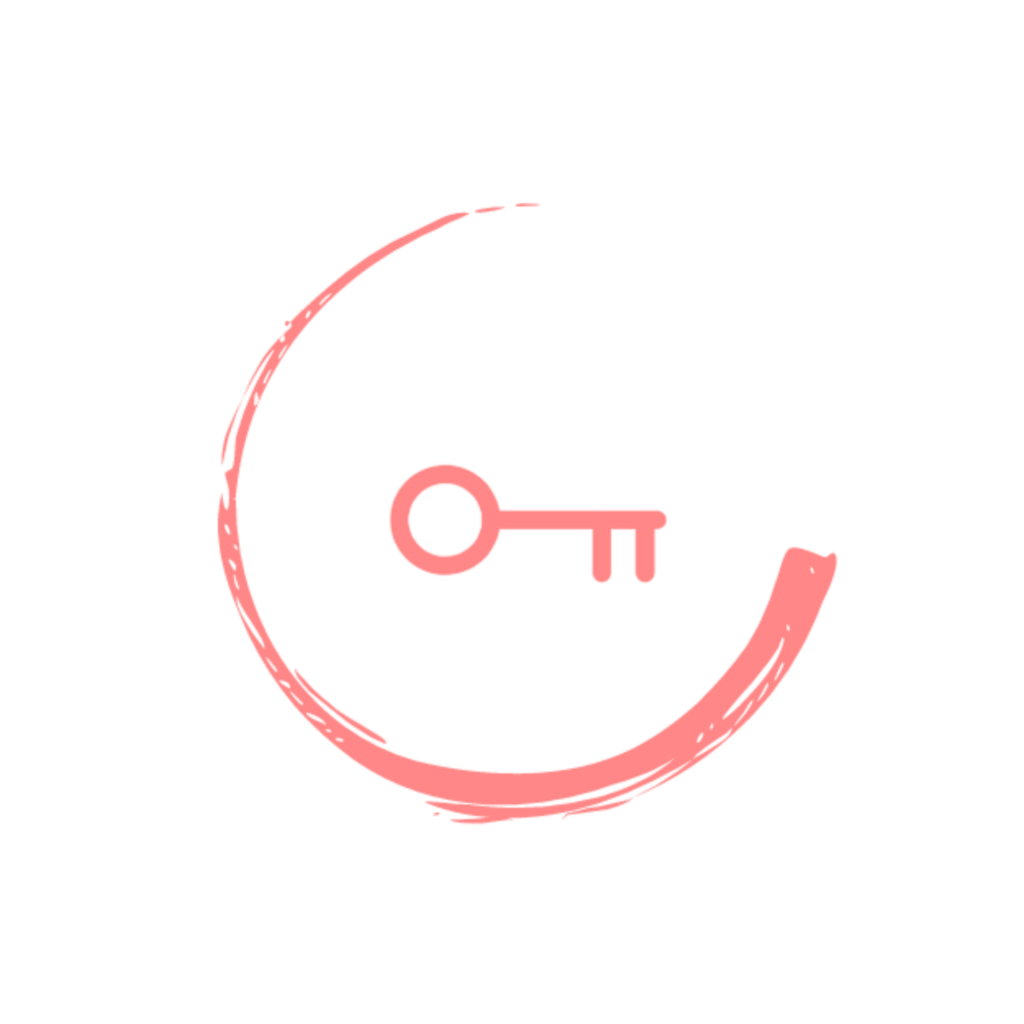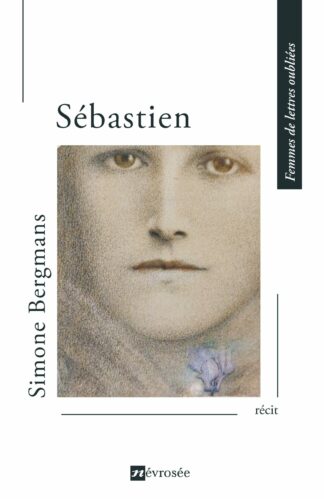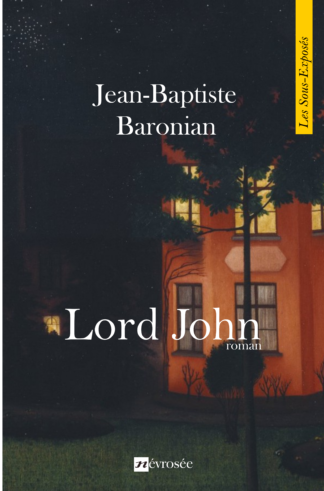Première Partie
I
Ce sont les cris de mon père qui m’ont réveillé. Il criait si fort, il gesticulait tellement que ma première pensée cohérente a été qu’une catastrophe venait de se produire. Peut-être que la vieille maison que nous habitions était la proie des flammes, ou peut-être que dans la rue les conduites de gaz avaient sauté, que d’une seconde à l’autre l’explosion allait entraîner la chute de tous les immeubles situés dans les environs. Ou peut-être que c’était la guerre, une autre guerre, qu’on en avait annoncé la foudroyante nouvelle à la radio, ce matin même, juste avant que mon père ne se précipite au pied de mon lit. En tout cas, il était extraordinairement fébrile – et il n’arrêtait pas de hurler, de bondir de gauche à droite, comme s’il cherchait le meilleur emplacement pour se faire entendre. À moins que ce ne fût ma meilleure oreille.
Après quoi, il a lancé les deux bras vers le plafond de ma chambre et il a un peu baissé le ton, conscient sans doute qu’à travers des cris ce qu’il avait à me dire resterait inintelligible. Je devais me lever, c’était une honte qu’à onze heures, car il était onze heures au moins, je ne sois pas encore debout, qu’à mon âge j’aie encore l’audace de faire la grasse matinée. Allons, bon Dieu ! qu’est-ce que j’attendais ? Est-ce que j’étais sourd ou est-ce que j’avais décidé, bêtement, de ne plus lui obéir ? Et sans me donner l’occasion de lui répondre, il a brusquement arraché la couverture et les draps qui m’enveloppaient. Mon pénis était tendu et je n’ai pas eu assez de réflexe sur le moment même pour le dissimuler. J’ai rougi. Mon père n’y a pas fait attention : il s’est simplement écarté de mon lit et, toujours d’une voix bourrue, il a ajouté qu’il n’y avait plus de temps à perdre, que dans cinq minutes, cinq et non pas six ni sept ni davantage, il fallait que nous partions.
Je me suis levé avec un bâillement.
Jamais encore mon père n’avait agi de la sorte, et si un jour il avait crié contre moi, je ne m’en souvenais plus.
J’ai gagné le lavabo de ma chambre, je me suis savonné la figure, je me suis brossé les dents. Le miroir où je me suis regardé était fendu à mi-hauteur et, tel que je me suis vu, j’ai eu l’impression que la partie inférieure de mon visage, par rapport à la partie supérieure, était horriblement plus grosse. J’ai baissé la tête, mon nez s’est comme dédoublé : au-dessus un nez très large, en dessous un nez étroit, minuscule, réduit à une sorte d’arête. Je me suis adressé un rapide sourire. Il avait quelque chose de forcé, de grotesque. Puis j’ai enfilé mon caleçon.
II
Donc, cinq ou six minutes plus tard, je suis descendu à la cuisine, une pièce basse, très petite, où il était presque impossible pour deux personnes de se tenir côte à côte ou face à face, sauf si elles se pressaient fortement l’une contre l’autre. Mon père n’y était pas. J’y suis entré dare-dare, j’ai vidé la cafetière – un café déjà froid, noir et infect. Tout de même, cela a achevé de me réveiller et, en dégringolant les marches jusqu’à la bouquinerie, au rez-de-chaussée, je me suis senti de mieux en mieux.
En bas, mon père avait déjà ouvert la porte d’entrée du magasin qui était également celle de la maison. Il a eu, en me voyant, un geste d’irritation et une méchante grimace lui a tordu les lèvres. Il grimaçait beaucoup, mon père, au moindre incident. Sans que d’ordinaire je sache ce que cela signifiait au juste, contentement ou dépit. J’ai haussé les épaules et il m’a dit sur le ton du plus grand reproche que j’aurais pu me raser, que j’avais l’air d’un voyou, d’un vrai guignol. Machinalement je me suis caressé les joues. J’aimais bien cette barbe qui me poussait, ces gros poils clairs fleurissant sur mon menton, cette ébauche de moustache qui, me semblait-il, me donnait l’aspect débonnaire d’un jeune homme mûr, un tantinet artiste. Mon père m’a indiqué la rue.
— Franchement, un coup de rasoir, ce n’aurait pas été de trop. Le jour de ton anniversaire !
Je n’ai pas bougé. J’ai soudain réalisé que j’avais aujourd’hui, le 29 avril 1964, dix-huit ans et que mon père qui ne faisait jamais rien comme tout le monde les avait fêtés par une bordée de cris. J’ai voulu prendre la parole, avec l’idée de lui dire merci, mais aucun mot ne s’est échappé de ma bouche. Les bras ballants, je me suis avancé vers la porte, je l’ai franchie et je suis allé me planter sur le trottoir, le regard fixé sur le magasin d’en face, une agence de voyages dans la vitrine de laquelle, depuis deux mois, on avait accroché une affiche touristique représentant une vue aérienne – une vue merveilleuse – du Pont de Londres. J’en rêvais de Londres, de cette affiche, je ne cessais pas d’en rêver. Et d’ailleurs mon père en était le seul responsable : il m’en parlait à tout moment, répétant toujours que Londres était la plus belle ville de la planète, celle où il avait lui-même vécu les plus belles années de sa vie avant de rencontrer ma mère qui était morte un an après m’avoir mis au monde et de rentrer au pays, la ville la plus largement, la plus ouvertement, la plus généreusement vouée à l’aventure, à l’exubérance, à l’ivresse, à la folie… Et lui, m’assurait-il chaque fois, il avait été jadis Londonien jusqu’à l’excès, jusqu’à la démesure !
Mon cœur s’est mis à cogner contre ma poitrine. Dans mon dos, mon père a fermé à clef la porte de la bouquinerie et j’ai guetté cette seconde où il me prendrait par la main, me ferait traverser la rue comme lorsque j’étais un tout petit garçon, et m’emmènerait à l’intérieur de l’agence de voyages pour m’offrir l’inoubliable cadeau de mes dix-huit ans : un séjour à Londres.
Il m’a frôlé le bras. Il a jeté un coup d’œil sur mon visage hirsute puis je l’ai vu marcher sur le trottoir, hâter le pas après deux ou trois foulées.
Je l’ai suivi.
Je ne savais pas où il allait, où il souhaitait me conduire. Ce n’était pas à Londres, j’en ai eu la certitude quand je l’ai rattrapé au bout de la rue des Eperonniers et qu’il m’a dit qu’à l’heure qu’il était son amie devait déjà s’impatienter, se demander si le rendez-vous qu’il avait pris avec elle n’était pas une galéjade. Ce drôle de mot, il l’a prononcé à deux reprises. Je l’ai retenu car ce jour-là, le 29 avril 1964, il a longtemps tourné dans ma tête.
III
La voiture de mon père, une Dauphine blanche, était garée à deux pas de la Gare Centrale. On y est montés en silence. Mon père a démarré aussitôt. Une marche arrière, un brusque coup de frein, un quart de tour de volant à gauche, un crissement des pneus sur l’asphalte – il n’avait pas son pareil pour se dégager d’un parking à toute vitesse et puis pour se jouer de tous les pièges de la circulation, même au plus fort des embouteillages. C’était peut-être à Londres qu’il avait appris à conduire, ou n’importe où en Grande-Bretagne, sur un circuit de formation destiné aux pilotes d’élite, et toutes les fois où je prenais place à ses côtés, dans sa Dauphine increvable, ses formidables talents de chauffeur me laissaient pensif. Et si là-bas, de l’autre côté de la Manche, il avait été l’égal de Fangio ou de Moss ?
En quelques minutes, on a quitté le centre de la ville. On volait – oui, on volait ! Il n’y avait que nous sur la chaussée, et c’était comme si, pour célébrer mes dix-huit ans, tous les véhicules avaient décidé de rouler au pas, comme si tous les feux rouges s’étaient mis au vert, comme si tous les agents de police avaient déserté les carrefours ! On a parcouru la rue Belliard, on a rapidement longé le parc du Cinquantenaire, on l’a contourné par l’avenue de la Renaissance et, de là, on s’est engouffrés dans une artère portant le nom d’un peintre (Raphaël ? Vélasquez ? Goya ?) et où, visiblement, il n’y avait personne.
Soudain, mon père a ralenti et avant d’atteindre l’extrémité de la rue on avait déjà gaspillé tout le temps qu’on avait gagné de haute lutte, depuis notre départ sur les chapeaux de roue. Cela aussi, c’était mon père : un homme de soixante-deux ans totalement contradictoire qui, avec une stupéfiante facilité, passait d’un extrême à un autre extrême et qui par exemple, au cœur d’un seul et même propos, était capable d’affirmer une chose et son contraire, sans jamais paraître s’en rendre compte. Dans ma naïveté, je me disais souvent qu’il était double, qu’il était animé par deux démons – ou par deux anges – et que selon son humeur et ses caprices il écoutait tantôt l’un et tantôt l’autre. Je l’ai considéré. Il avait légèrement penché la tête et, à travers le pare-brise sali, il inspectait la façade des maisons. Entre ses dents, il baragouinait, scandait des tas de mots qu’il m’était impossible de comprendre.
Il a brusquement stoppé.
Il a coupé le moteur, a tiré sur le levier du frein à main d’un geste si violent que j’ai cru qu’il allait lui rester entre les doigts. Il a alors déclaré que nous étions « dans les temps » – et on s’est ensuite dirigés vers un immeuble délabré de deux étages.
Du poing, mon père a lourdement frappé à la porte. Des bruits de pas se sont élevés derrière le battant puis une silhouette est apparue dans l’embrasure. C’était celle d’une femme, d’une grande femme brune vêtue d’un pantalon de jean et d’un chemisier rose sur lequel étaient brodés des fruits multicolores. Et ces fruits palpitaient, doucement, l’air de se balancer sur un arbre invisible, quelque part entre le ciel et la terre.
Ma gorge s’est nouée. La femme était belle, très belle, d’une beauté rude et provocante, les cheveux coupés court comme Jean Seberg. Elle a souri à mon père, elle m’a souri à moi, et j’ai essayé de lui sourire également mais sans succès. Elle a ouvert la bouche.
— C’est toi, Alex ?
Je n’aimais pas que les étrangers me tutoient et encore moins qu’ils m’appellent Alex. J’ai failli le lui dire – lui dire que j’avais un prénom complet, Alexandre, que ça ne coûtait pas beaucoup d’en prononcer toutes les syllabes. Je n’ai pas osé. Je me trouvais devant la plus belle femme que j’avais jamais vue en chair et en os et c’était un cadeau qui, à cet instant, ne nécessitait aucun commentaire.
IV
La maison était vide. Du moins l’avait-on vidée, ainsi que je l’ai appris lorsque la belle femme brune et mon père ont commencé à parler. Au grenier restaient seulement des vieux bouquins et nous étions venus pour en prendre livraison. Ils avaient appartenu à un dramaturge, auteur de pièces macabres et de farces échevelées, décédé six mois plus tôt. Sa succession avait, paraît-il, occasionné de « pénibles querelles familiales ». Sur quoi, le notaire instruit avait dû procéder à la vente des biens. Et tout, dès lors, s’était déroulé selon un processus habituel, un rite étrange que je ne connaissais pas : d’abord étaient venus les antiquaires, les vrais, les plus huppés, les plus nantis, et ils avaient acquis les meubles, les tableaux, l’argenterie, les bibelots, les tapis de valeur. Puis les brocanteurs pour des pièces moins enviables. Puis encore les biffins, ceux qui couraient chaque jour les marchés aux puces, qui se contentaient des pacotilles, des vêtements, des ustensiles de ménage.
Apparemment, la belle femme brune faisait partie de la troisième classe. J’ignorais où, quand et comment mon père l’avait rencontrée. Peut-être qu’à mon insu ils étaient amants.
Nous avons gagné un escalier de bois dont le garde-fou ne tenait presque plus et nous avons commencé à le gravir, à la queue leu leu. Après que nous avons atteint le deuxième étage, l’escalier s’est rétréci. J’ai reniflé des odeurs nauséeuses, mélange d’humidité, de rouille et de pourriture, et je me suis demandé vers quel capharnaüm nous nous dirigions. J’ai marqué le pas. La belle femme brune marchait devant, sans trop se presser. De dos, elle avait énormément d’allure. Dans la pénombre, j’ai pu admirer sa taille et ses fesses – et cela m’a donné du courage pour affronter les mauvaises odeurs et achever l’escalade.
Prudemment, je me suis agrippé à la rampe. Mon père a évoqué un souvenir : à Londres, une nuit, il avait rendu visite à un contrebandier, tout en haut d’une bâtisse de White Chapel sans électricité. Mais, par bonheur, sous les vieilles poutres craquant sans cesse, il avait participé à un merveilleux festin… La belle femme brune n’a émis aucune remarque. Elle a poussé une porte vermoulue et a dit d’une voix bien claire :
— Voilà, c’est ici ! Nous y sommes.
J’avais deviné juste, le grenier du dramaturge ressemblait à un capharnaüm, à supposer qu’un capharnaüm ressemble à quelque chose. Je n’aurais pas pu imaginer une pièce avec un tel amoncellement de livres, même dans la boutique de mon père ni dans sa cave où il enfermait sa réserve, une telle débauche de papiers accumulés. Il y en avait partout, le long des murs, sur le plancher où ils formaient des piles énormes, compactes, sur des dizaines d’étagères tordues, et au-dessus encore, entre les madriers, et jusqu’au sommet du pignon !
Un silence est tombé.
On a tous les trois regardé autour de nous. Je ne savais pas ce qu’eux ils regardaient exactement. Moi, je cherchais des yeux un coin où se serait égaré autre chose que des livres mais, de l’endroit où je me tenais, je n’en ai pas vu.
La belle femme brune a repris la parole au bout d’un moment.
— Ce ne sera pas facile de débarrasser tout ça. Qu’est-ce que tu comptes faire ?
Mon père m’a tapoté l’épaule.
— C’est le boulot d’Alex, ce n’est pas le mien !
V
Mon boulot.
Je n’ai pas pu m’empêcher de sursauter. J’ai dévisagé mon père : j’aurais juré qu’il me narguait, qu’en lui-même il ressentait la plus intense jubilation. L’air de m’avoir joliment dupé. Une galéjade.
Il s’est tourné vers notre hôtesse et lui a souri.
— Je lui fais entière confiance, Capucine, c’est un garçon extrêmement débrouillard.
J’ai moins été frappé par le superlatif ironique me concernant que par le prénom peu commun de la belle femme brune.
Elle m’a considéré, a dit qu’elle n’en doutait pas. J’étais, a-t-elle précisé, « le portrait tout craché de mon père ». Je l’étais au physique et, dès l’instant où je me mettrais à trier et à classer tous les livres empilés dans le grenier de cette maison, je le serais également « au moral ». En somme, « ce qu’on appelle l’hérédité » : mon grand-père avait été libraire, mon père l’était, j’étais tout biologiquement destiné à le devenir…
Je n’y avais jamais pensé et, pour sa part, mon père n’avait jamais non plus rien fait pour que j’y pense un jour. Il se passait vraisemblablement mille choses dans sa boutique mais, le soir, quand nous nous retrouvions, il n’en parlait pas beaucoup. De temps à autre, comme malgré lui, il laissait échapper une vague allusion sur un client, me signalait à la hâte un incident qui l’avait tracassé ou la visite que lui avait rendue un ami, un confrère ou un écrivain, néanmoins sans trop d’insistance. Il préférait – et de loin – ressasser ses souvenirs, lesquels étaient innombrables et où, bien entendu, neuf fois sur dix, Londres occupait la première place. Ces souvenirs semblaient même n’exister qu’en fonction de Londres, de ses quartiers, de ses mystères, de ses odeurs, de ses couleurs, de son fog légendaire, de ses artistes et d’un certain John qui avait été son compagnon favori – et sur tout ce qui pouvait avoir trait à la capitale britannique, il était franchement intarissable.
J’ai toussoté. Capucine a montré du doigt la tabatière, tout au fond de la pièce.
— On a coupé l’électricité. Pour bien faire, Alex devrait commencer à travailler avant qu’il ne fasse sombre.
Mon père a haussé les épaules.
— C’est si urgent que ça ? Au jugé, il y en a pour plusieurs jours… Tu as reçu un délai ?
— Pas vraiment. Sauf que je n’aimerais pas que cela traîne. Le notaire m’a remis les clefs de la maison en main propre, je souhaiterais les lui restituer au plus vite. C’est à ce moment-là que je suis intervenu.
— Si vous le voulez, je peux commencer immédiatement… Je me sens prêt.
Mon père a répliqué aussitôt.
— Ce genre de boulot ne s’improvise pas ! Alex doit apprendre le métier et le métier, qu’on le veuille ou non, exige de la méthode.
Le mot m’a paru très nébuleux. Il supposait un code, des règles et, sans doute, du flair et de l’intelligence. Ces deux dernières qualités, je croyais bien les posséder, même si je n’avais pas eu jusqu’à présent de nombreuses occasions de les mettre en pratique. Mais les autres…
J’ai regardé successivement mon père et Capucine, mon père pour qu’il m’explique la méthode, Capucine parce qu’elle venait de se déplacer et que je la voyais sous un nouvel angle. De profil, elle était plus belle, plus désirable encore. Les fruits brodés sur sa poitrine étaient furieusement appétissants… J’ai avalé ma salive et baissé la tête. Dans le court silence qui a suivi, je n’ai plus entendu que les battements saccadés de mon cœur.
VI
En fait de méthode, il n’y en avait pas une mais trente-six. Mon père m’en a donné un rapide aperçu, tout en me laissant la faculté de choisir celle qui me conviendrait le mieux. D’après lui, tout se résumait à une question de classement. Les livres, je pouvais les ranger par ordre alphabétique d’auteurs, par genre, par époque, par collection… Mais j’avais aussi le loisir d’opérer d’autres tris. Par exemple regrouper les ouvrages selon la langue dans laquelle ils avaient été originellement rédigés, selon leur format, leur état de fraîcheur, leur tirage… Ou, mieux encore, selon leur intérêt littéraire et scientifique, la qualité supposée de leurs auteurs, leur rareté – des critères sur lesquels je n’avais presque aucune idée. Et rien ne s’opposait non plus à ce que j’invente mes propres critères de sélection. Mon père était convaincu que j’avais toutes les dispositions requises pour les découvrir, qu’après avoir fouillé une heure ou deux la bibliothèque j’arriverais aisément à réglementer mon travail.
À la fin, il m’a demandé si j’avais bien compris ce qu’il attendait de moi et si j’avais des questions à lui poser. J’en avais des tas, peut-être autant qu’il y avait de livres dans ce capharnaüm. Je me suis contenté d’écarter les bras. Je devais avoir l’air idiot car Capucine a éclaté de rire et quand son rire a cessé, elle a dit que j’étais « mignon tout plein ». Cela ne m’a pas plu. Je l’ai regardée en serrant les lèvres, j’ai cherché une réplique, une repartie appropriée, aucune ne m’est venue à l’esprit. Une ou deux secondes – une éternité ! –, nous ne nous sommes pas quittés des yeux.
Mon père a consulté sa montre, s’est étonné de la rapidité avec laquelle le temps passait. Moi, le temps, je l’aurais volontiers envoyé au diable : depuis mon réveil, il me martelait la tête et me harcelait sans relâche. À croire qu’aujourd’hui, le jour de mes dix-huit ans, il avait décidé, avec la sournoise complicité de mon père, d’être impitoyable !
Dès lors, le reste de la scène s’est joué allegro vivace : mon père et Capucine se sont précipités vers la porte du grenier et soudain je me suis retrouvé seul, avec une vision d’éternité qui s’évanouissait déjà et une montagne de bouquins poussiéreux, à classer un par un.
VII
Jusque-là je m’étais tenu à distance : dans l’arc de cercle qu’avait tracé sur le plancher usé le battant de la porte. J’ai hésité avant d’aller plus loin. Je ne savais pas au juste où aller d’ailleurs – à gauche, à droite, droit devant moi… Et puis quelle serait ma méthode ?
J’ai effectué un pas, un pas frileux, un autre, un troisième et je me suis immobilisé là où, une minute auparavant, s’était tenue Capucine. J’ai essayé de me représenter ses traits : j’aurais pu évoquer une chimère, le résultat aurait été identique. Un visage flou, presque sans contour, comme si je m’étais à peine attardé sur lui. Comme si j’avais eu affaire à un passant, entrevu un quart de seconde dans la rue ! Et le pire à cet instant, c’est que je ne parvenais même plus à m’imaginer Jean Seberg.
Une étagère était dressée à mes côtés et j’ai commencé à examiner les ouvrages alignés à la hauteur de mon regard. Les titres ne me disaient rien. Ils avaient tous d’étranges accents licencieux, suggéraient d’affriolantes intrigues amoureuses : Chair de beauté, La Fiancée aux mains de glace, La Femme rousse, Folie d’un soir, Bobette et ses satyres, Baisers mortels, Nini violée, Nichonnette, Orgies bourgeoises, Madame veut un amant… Et dix autres de la même trempe. Ils étaient signés Luc Dorsan, Jacques Dersonne, Christian Brulls, Jean du Perry, Gom Gut, Georges-Martin Georges, des auteurs qui semblaient surgir de la nuit de la littérature… Le nom de Gom Gut surtout, avec sa sonorité martiale, m’a impressionné. J’ai mis la main sur un livre où il était imprimé en grosses lettres rouges et qui était intitulé Perversités frivoles. Il s’agissait en réalité d’un mince fascicule d’une soixantaine de pages contenant quelques contes, agrémentés d’illustrations. Elles étaient toutes d’assez mauvais goût – d’un mauvais goût sage par comparaison au titre.
Je me suis écarté de l’étagère. J’étais perplexe. Je n’avais pris qu’un seul bouquin et déjà je me demandais sur quel critère j’allais m’appuyer pour établir un début de classement. Les hypothèses de travail me paraissaient nombreuses, et très vraisemblablement elles se multiplieraient encore, dès le moment où je m’emparerais d’un deuxième volume…
Au hasard, j’en ai ramassé un traînant par terre. C’était de nouveau un mince fascicule mais, cette fois, la couverture salie ne mentionnait qu’un titre : Le Sorcier de la vallée noire. En dessous, je pouvais voir un dessin très fruste en couleurs, une scène d’effroi : deux hommes devant un cercueil ouvert disposé dans une espèce de laboratoire, le premier vêtu d’un costume sombre, comme figé et l’air ahuri, le second, un vieillard, brandissant un sinistre couteau. Le titre était retranscrit à la première page et il était suivi de ces mots : « Roman dramatique inédit de José Bozzi. »
Gut, Dorsan, Brulls, Bozzi… Décidément, mon initiation à la librairie démarrait dans la mélasse.
VIII
J’ai fini par m’asseoir en tailleur sur le plancher jonché de livres. Mon regard a erré un certain temps vers le fond de la mansarde où s’étaient fourvoyés quelques rayons de soleil et où dansaient des milliers, des milliards de débris poussiéreux.
La maison était silencieuse – tellement silencieuse que je me suis cru dans un monde à part, à l’abri des turbulences innombrables qui, chaque jour, chaque nuit, secouaient la ville entière et sans lesquelles j’aurais été incapable de l’imaginer. Puis, en baissant un peu la tête, j’ai remarqué que la lumière glissant à travers l’unique tabatière de la pièce éclairait un gros paquet entouré d’une ficelle. On aurait dit une pile de vieux journaux. Je me suis mis sur les genoux et je m’en suis doucement approché à quatre pattes. Aussitôt la poussière s’est collée à mes doigts. Je les ai frottés sur mon pantalon avant de saisir le paquet et d’en retirer sans peine la ficelle. Elle a claqué avec un bruit sec. Et tandis qu’elle claquait, l’ai écarquillé les yeux.
J’ai écarquillé les yeux d’émerveillement, de fascination. Comme déjà j’avais dû le faire tout à l’heure lorsque Capucine était apparue sur le seuil de cette maison inhabitée. Mais ce que je ressentais à présent n’avait rien de charnel : c’était quelque chose appartenant à un autre type d’émotion, c’était un choc plastique – oui, un choc plastique, le choc que provoque une œuvre d’art, un chef-d’œuvre. Et pourtant il n’était né que d’une image très bariolée datant du début du siècle, et des images très bariolées, j’en avais vu des centaines depuis que j’étais gosse mais jamais une pareille, une qui fût aussi baroque, aussi mirobolante, jamais une qui fût à ce point chargée de féérie et de délires !
Je l’ai contemplée un long moment, je ne pouvais pas ne pas la fixer, en admirer avec attention les détails – et d’abord cette jeune femme étendue sur le sol terreux d’une cave obscure et dont la chevelure était largement déployée. Et puis cet homme barbu au visage de monstre, qui les bras écartés, enchaîné au mur, était penché sur elle. Et cet autre sur l’avant-dernière marche d’un escalier de pierre, un revolver dans la main, prêt à tirer, à bondir. Et cet autre encore paré comme un hussard de vaudeville… En les regardant, j’ai eu le sentiment d’être transporté au cœur d’une sanglante tragédie dont l’acte décisif était en train de se jouer devant moi, à cette seconde précise. À croire que je me trouvais moi-même au cœur de la cave ténébreuse, que la terreur des personnages était aussi la mienne.
Le charme ne s’est partiellement rompu que lorsque s’est voilée la lumière venant de la tabatière. Je me suis rendu compte alors que l’image ornait la couverture d’un ouvrage de grand format où dominait cette mention : Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain. Le héros était représenté dans un médaillon, la mine fort préoccupée, une pipe aux lèvres. En dessous, en caractères plus petites, se lisait un titre : Le Vampyre qui chante.
D’instinct, j’ai voulu savoir ce que l’ouvrage racontait et je l’ai pris, tout tremblant, entre les mains… C’était, cette fois encore, un fragile fascicule… le premier d’une extraordinaire collection ! Car là, sous mes yeux enivrés, dans le paquet dont j’avais arraché la ficelle, il y en avait des dizaines d’autres, une gerbe éblouissante d’anciennes images incongrues, de titres ensorceleurs… Au fond de mon être quelque chose bouillonnait. Je me suis dit que ce quelque chose s’appelait peut-être l’euphorie.
IX
J’ai compté cent soixante-dix-huit fascicules, tous différents. Je les ai comptés sans me presser pour, chaque fois, avoir le temps d’examiner à l’aise l’illustration des couvertures, pour que puisse agir la fascination qu’elles exerçaient sur moi. Elles baignaient pour la plupart dans une atmosphère de fièvre et de paroxysme, proposaient d’ahurissantes scènes d’épouvante, d’incroyables instantanés, comme si leur auteur avait eu le génie de peindre des catastrophes sur le vif, à l’instant capital où elle se produisaient, de la même manière qu’un photographe aurait pu les surprendre avec une caméra ultraperfectionnée. Et, effectivement, tout ici n’était que catastrophe : un homme précipité dans le vide du toit d’une maison, un fantôme enveloppé de draps blancs surgissant entre les tentures d’une chambre de bonne, une kyrielle de singes amassés autour d’un individu hirsute rongeant un os, un tribunal secret où les juges avaient le visage caché par une cagoule, une tombe ouverte en pleine nuit dans un cimetière et renfermant un corps de vieillard intact, une gigantesque sculpture faite à la fois de marbre et de chair humaine, une chaise électrique, une guillotine, des pistolets, des couteaux, des fourches, des pics, des bombes, des gourdins – et toujours la nuit, la nuit la plus noire, la plus impénétrable.
Et puis, il y avait les titres des fascicules et c’étaient d’autres folies : Les Spectres-Bourreaux, La Cour d’épouvante, Les Gardiens du gouffre, Le Mystère des sept fous, Les Illustres Fils du Zodiaque, Le Dancing de l’épouvante, Le Monstre dans la neige, Les Effroyables, Le Rituel de la mort, La Maison du grand péril, Les Etoiles de la mort, Les Trois Cercles de l’épouvante, Le Fantôme des ruines rouges, Le Jardin des furies, Le Vampyre aux yeux rouges… J’étais médusé, je dérivais.
J’étais assis dans ce grenier poussiéreux et en même temps je dansais au milieu du dancing de l’épouvante, je traversais la cour d’épouvante, je franchissais les trois cercles de l’épouvante, j’étais un spectre-bourreau, un illustre fils du Zodiaque, un effroyable, j’étais ce monstre dans la neige, ce fantôme des ruines rouges, ce vampire…
Quand j’ai levé les yeux, la lumière m’a aveuglé.
Je n’ai pas bougé.
Je n’aurais pas pu, malgré la légère brûlure des rayons du soleil sur mes paupières. Il m’a paru que ce que je vivais, que ce que j’étais en train de vivre n’avait pas son pareil, qu’une sorte de miracle avait eu lieu, et j’ai eu l’illusion que désormais, quoi que je fasse, où que j’aille, ce miracle déterminerait toutes mes actions et toutes mes pensées.
Dans la maison, aux étages inférieurs, un bruit aigu a retenti. Est-ce que mon père et Capucine se trouvaient toujours là ? Peut-être qu’ils n’étaient pas partis comme je le croyais, peut-être qu’ils n’avaient pas cessé de m’épier, de suivre le moindre de mes mouvements. Peut-être qu’ils étaient restés afin de voir comment j’envisagerais d’organiser mon travail, par quel bout, en fonction de quel critère je commencerais à classer les livres. Un test, une épreuve. Et si c’était le cas, n’avais-je pas sûrement échoué ?
J’ai tendu l’oreille, sans avoir le courage de regarder pardessus mon épaule. Rien. J’ai fini par tourner la tête vers la porte entrouverte et subitement un frisson m’a parcouru. Une idée extravagante s’est imposée à moi, l’idée que le bruit que j’avais perçu avait bel et bien été provoqué par quelqu’un, non pas mon père ni Capucine, mais l’homme qui avait naguère habité l’immeuble et dont la mort remontait à deux mois.
Ou plutôt son fantôme.
Et j’ai pensé que, d’une seconde à l’autre, il allait se matérialiser dans l’embrasure.
X
En vain j’ai guetté son irruption. Si quelque chose s’est passé, je ne l’ai pas vu. Au bout de deux ou trois minutes, je me suis mis debout, puis je me suis lentement avancé en direction de la porte. De nouveau, un lourd silence pesait sur la maison mais je sentais à quel point il était fragile. Je me suis approché du garde-fou. Avant même que je ne me penche dessus, les odeurs nauséeuses qui m’avaient tellement incommodé tout à l’heure m’ont sauté au visage. En grimaçant, j’ai pincé les narines et j’ai plongé les yeux dans la cage de l’escalier. Elle était construite de telle façon que je n’ai pas pu voir plus loin que le palier du deuxième étage. Qu’est-ce que je devais faire ? Aller explorer les diverses pièces de la maison, chercher à connaître l’origine du bruit que j’avais entendu ? Ou, au contraire, revenir rapidement sur mes pas afin de continuer à sonder la bibliothèque ?
Sans davantage réfléchir, j’ai descendu les marches.
Au début, j’ai retenu ma respiration, et ce n’était pas tant pour éviter de sentir les mauvaises odeurs que parce que je n’étais pas tranquille et que l’idée que le fantôme du dramaturge hantait l’immeuble me poursuivait toujours. Mais quand je me suis arrêté au deuxième étage, j’ai eu l’impression d’être plus sûr de moi, de m’être maîtrisé et, même, d’être prêt à affronter le pire.
Deux portes donnaient sur le palier. Je n’ai pas temporisé. Ou à peine. J’ai ouvert celle sur ma gauche et mon regard a immédiatement balayé une grande pièce nue. Çà et là sur le plancher, on distinguait les traces des meubles qui y avaient été aménagés. Et sur les murs recouverts d’un papier peint rosâtre, celles des cadres, beaucoup plus nettes.
Il n’y avait rien d’autre.
J’ai poussé un soupir et je suis allé à la porte de droite que j’ai ouverte également et derrière laquelle m’est apparue une pièce tout aussi vide mais moins spacieuse.
Je n’ai pas résisté alors à la tentation de visiter le premier étage puis, à la hâte, le rez-de-chaussée et le sous-sol – et même de me rendre dans la cour minuscule, à l’arrière de la maison, un triangle dallé plein de ronces, de mousse humide et de cageots pourris. Mon fantôme n’était nulle part.