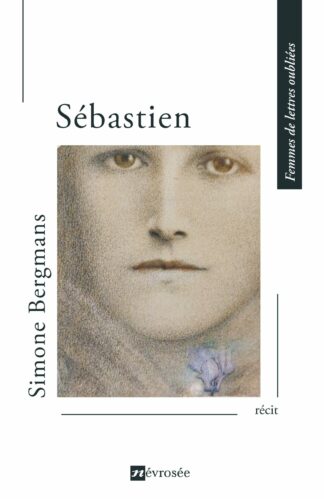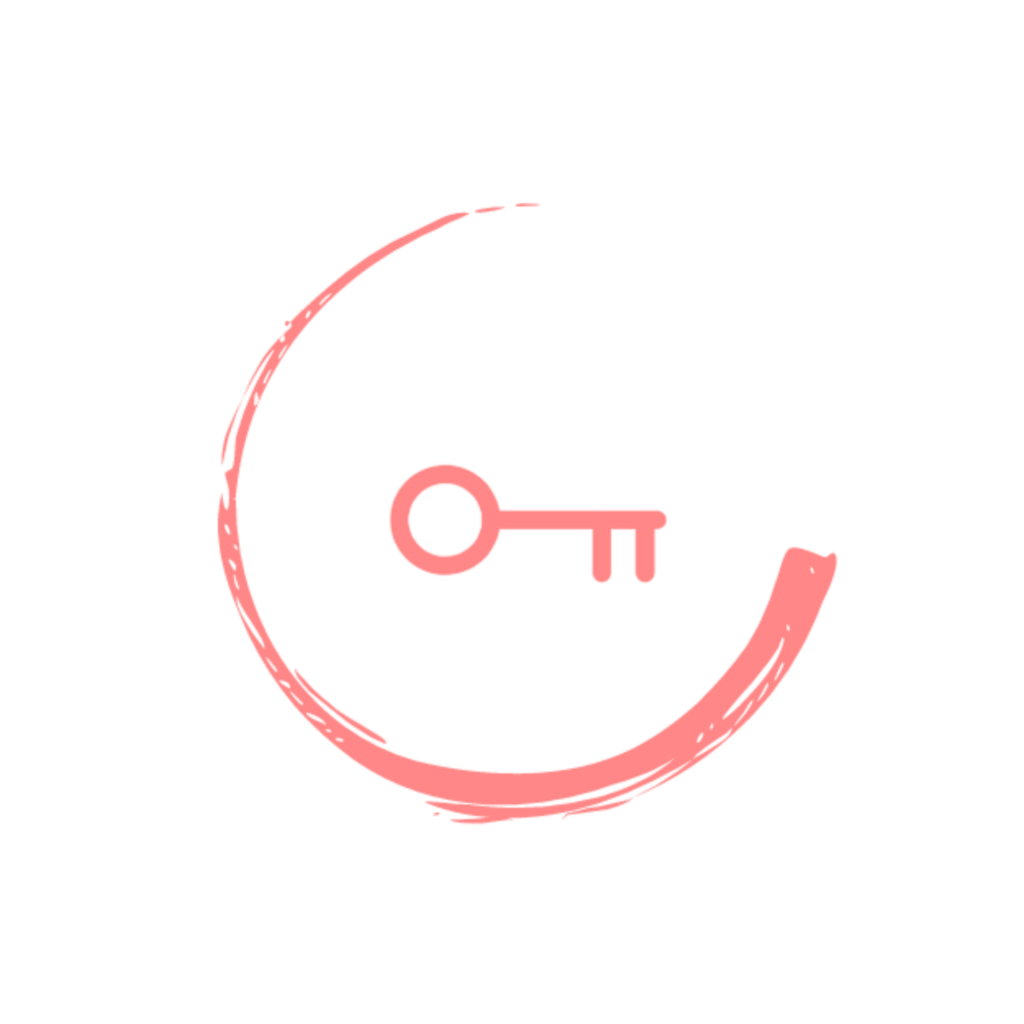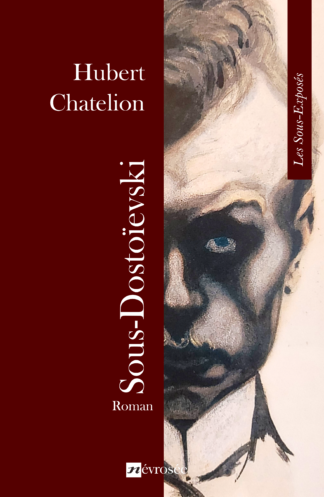Le jour où tu partis, Dieu notre père qui êtes aux cieux quitta son trône de vieillard, sedia gestatoria, et sa barbe bienveillante cessa de se répandre en flocons de grâce ouatée sur nos âmes filiales. Au moment même il ôta l’échelle par laquelle les âmes des trépassés avaient coutume de monter, nuage à nuage, jusqu’au salon firmament où les accueillaient les plates-formes inférieures et les canapés supérieurs.
À l’instant où tu partis par le métro céleste, Dieu notre père qui êtes aux cieux se mit à badigeonner de blanc ses vitres et à mastiquer ses portes, il emprisonna les nuages et repoussa les appareils photographiques, il entoura la terre de toile isolante, il omit de brancher jusqu’à moi le téléphone de ton bonheur immobile.
Je regarde et n’aperçois qu’un ciel de lait, des fenêtres boudeuses, des portes de bois, animaux de ferblanterie et putains blondes usant l’eau des seuils vicieux.
Alors, pour ne point vomir, pour ravaler la bavure coléreuse et la vaine culbute des mots sacrilèges, je te parle et je parle toi, je te raconte et je te mens, je ressuscite ton fantôme, je détruis ta réputation, j’abîme ton souvenir, je pleure ta mort éternelle.
Pour te parler je voudrais dire le vieux monsieur qui traverse la rue tous les jours vers onze heures. Tous les jours, vers onze heures du matin, assise à cette table devant la fenêtre, j’ai peur. J’ai peur de la chambre vide dans mon dos, vide de toi comme toutes les chambres que je traverse à ta recherche.
J’appelle la fenêtre au secours, mais la fenêtre est muette entre les feuilles, elle a des yeux sans cœur et pas la moindre mémoire. Dans la vigne vierge, le moineau parle comme un vieux professeur ; il dresse la queue, secoue la tête, prétend tout savoir. Il prétend que je cherche midi à quatorze heures ; lui irait droit au but, il trouverait les mots qui parlent. Comme il te ressemble, avec sa tête d’oiseau ! Le vieux monsieur aussi te ressemble. Tout te ressemble mais rien n’est toi.
Tous les jours à cette heure-ci tu es partout autour de moi à voler, voleter, lancer des mots, jouer avec les mots, blesser les mots. Alors passe le vieux monsieur et je m’accroche à ce très vague signe de toi. Vague mais réel. Le vieux monsieur, lui, existe. Le vieux monsieur boite légèrement, comme toi, avec nonchalance. Il a une canne sur laquelle il se plie, comme tu faisais. Mais chez lui le geste semble moins gratuit, on dirait qu’il ne peut pas faire autrement, on dirait que sa jambe gauche se dérobe vraiment quand il marche. Pourtant on voit qu’il veut faire oublier sa canne ou du moins ne pas la laisser prendre au sérieux. Il a l’air de dire ne faites pas attention, n’en tenez pas compte, ce n’est pas vraiment une canne, c’est plutôt un jouet, une chose, un genre… à cause de ma haute taille, et puis j’aime à me pencher, les dames sont souvent petites, et moi, j’ai toujours eu le dos fragile.
Oui, tu avais le dos fragile mais tu ne boitais pas vraiment. C’était plutôt la canne qui te faisait cette démarche inégale et te donnait peu à peu le sentiment d’être invalide. Sentiment qui n’était pas sans douceur car il faisait de toi, à travers cette toute petite infirmité, un héros à jamais. Un héros pas très important — tu savais être humble — mais marqué à vie dans sa chair ; un héros qui n’oublie pas, et que le monde ne peut oublier non plus.
Le vieux monsieur est plus jeune que toi. Quand il eut l’âge des héros, on n’apercevait pas de guerre à l’horizon. Pourtant il boite. On n’aime pas le suivre, c’est laid de le voir marcher. Dans les magasins, lorsqu’ayant pris son pain ou son journal, il se redresse et remercie la marchande avec cette effusion qui lui est particulière — et qui t’appartenait aussi — il prend soudain une autre dimension, c’est un homme, qui existe, qui a un passé, c’est quelqu’un qu’on voudrait connaître, à travers lequel on voudrait te reconnaître ou peut-être te découvrir. Car ce que tu étais, tu l’étais si faiblement, si fragilement, avec de telles intermittences… Un peu comme le soleil : trop brûlant, lorsqu’il est là, pour qu’on puisse le contempler, trop lointain, lorsqu’il s’absente, pour en garder un souvenir exact.
Je sais bien que tu as été jeune, longtemps jeune, mais je ne m’en souviens plus tellement. Je t’ai toujours connu vieillissant, j’ai toujours connu tes rides, tes longues rides de clown qui te donnaient, surtout quand tu riais, ton grand air tragique. Déjà à ce temps-là tu aimais tenir une canne. On peut d’ailleurs le voir sur les photographies, sur celle-ci, par exemple : tu me donnes la main, je suis encore toute petite dans une barboteuse à fronces et mes jambes sont en forme de bébé, toi tu me regardes en père étonné, tu joues le rôle du père, tu en es tout attendri et tu en ris. Tu ris un peu gauchement et tu balances ta canne, cette bête petite chose froide dont la compagnie te tient chaud. Tu as vingt-cinq ans, tu ressembles à Scott Fitzgerald.
Tu as le même âge que Scott Fitzgerald et vous vous ressemblez étrangement. Bien sûr, toutes les photographies d’une même époque se ressemblent, parce qu’elles montrent surtout ce que les gens ont en commun à un moment donné, une certaine manière de se tenir, de s’habiller, de prendre des airs, si bien qu’on dirait que tous étaient pareils ou presque, et ce qu’on découvre, c’est davantage la personnalité du temps que celle des personnes mêmes. Ne montrons-nous pas toujours de nous-mêmes un certain portrait ? Qu’accuse encore la photographie, ce portrait de portrait ? Quoi qu’il en soit, au-delà de ces images infidèles, au-delà de la ressemblance du vêtement, de la coupe de cheveux ou de l’air que vous preniez, cet air de vieil enfant des années vingt, vous manifestez, Scott Fitzgerald et toi, des affinités plus profondes que je résumerais comme ceci : une grande lucidité jointe à un constant refus de la réalité. Si bien que toujours vous jouez en surface le rôle que vous vivez en profondeur comme à votre insu. Cette lucidité, votre maladie, vous accable sous le poids de la vie ; pour survivre, vous êtes tenus de simuler à tout moment.
Il me semble que S. F. possédait aussi ce jouet, une canne, celle du magicien, ton talisman, le soutien du vieux monsieur qui passe.
Le vieux monsieur va passer dans un instant, j’irai le rejoindre à l’épicerie, je me tiendrai près de lui, je le boirai de tout mon corps, pour te retrouver toi, mais lui n’y fera nulle attention, il gourmandera les enfants, il donnera son sourire aux jeunes femmes et tiendra la porte aux plus âgées.
C’est en lisant les lettres de S. F. à sa fille — vous écriviez le même genre de lettres, des modèles de la-lettre-qu’un-père-écrit-à-sa-fille, cachant des faiblesses sans nom, des folies indicibles, cachant plus encore une tendresse sans limite, une tendresse éperdue… — c’est aussi en voyant le portrait de S. F. au dos du livre et cette ressemblance si frappante entre vous que j’ai eu l’idée de relire tes lettres. Après tant de déménagements, il n’en reste guère et elles sont très décevantes ; tu n’écrivais pas simplement, tu avais trop le don de la parole pour pouvoir aussi t’exprimer par la froideur de l’écriture. Ma chère petite Marie, dis-tu, je t’écris d’une très grande ville, avec des lumières et du bruit partout. Heureusement, mes amis de C. cherchent à me distraire un peu, sinon je m’ennuierais tout le temps. Je ne connais presque personne, le travail ne me plaît guère, d’ailleurs je vais bientôt rentrer. À moins qu’on me propose quelque chose de beaucoup plus intéressant : il en est vaguement question, je te tiendrai au courant. J’espère que de ton côté tu penses à ton pauvre papa. Tu sais bien que si je pars souvent c’est uniquement dans l’espoir de nous faire une situation un peu plus stable. À ton âge, on ne peut se rendre compte des difficultés de la vie. Plus tard, tu comprendras. En attendant, fais-moi confiance. Étudie bien tes leçons : tu sais comme ça me fait plaisir, et je voudrais aussi que tu sois plus gentille avec ta gouvernante, tu es trop grande, trop sérieuse pour jouer à être méchante : c’est un jeu qui n’est pas digne de toi. Lorsque je reviendrai, nous verrons ensemble si nous pouvons nous passer de la gouvernante. Pour cela, il faudrait que tu sois beaucoup plus ordonnée qu’à présent. Si tu apprenais à avoir vraiment de l’ordre et du soin, je pourrais te confier mes vêtements et plus tard nous voyagerions ensemble. Mais si tu continues à jouer le vilain bébé auprès de ta gouvernante, je serai forcé moi aussi de te considérer encore un peu comme un bébé. Tu peux m’écrire chez Madame O. J’y serai encore pour une semaine en tout cas. Mon plus grand bonheur serait de revenir auprès de toi pour toujours. Hélas ! d’autres devoirs me retiennent au loin. À mon retour je te raconterai les mille et une aventures extraordinaires qui me sont arrivées. Maintenant, le travail m’appelle. Je te quitte en t’embrassant la joue. Ton vieux papa.