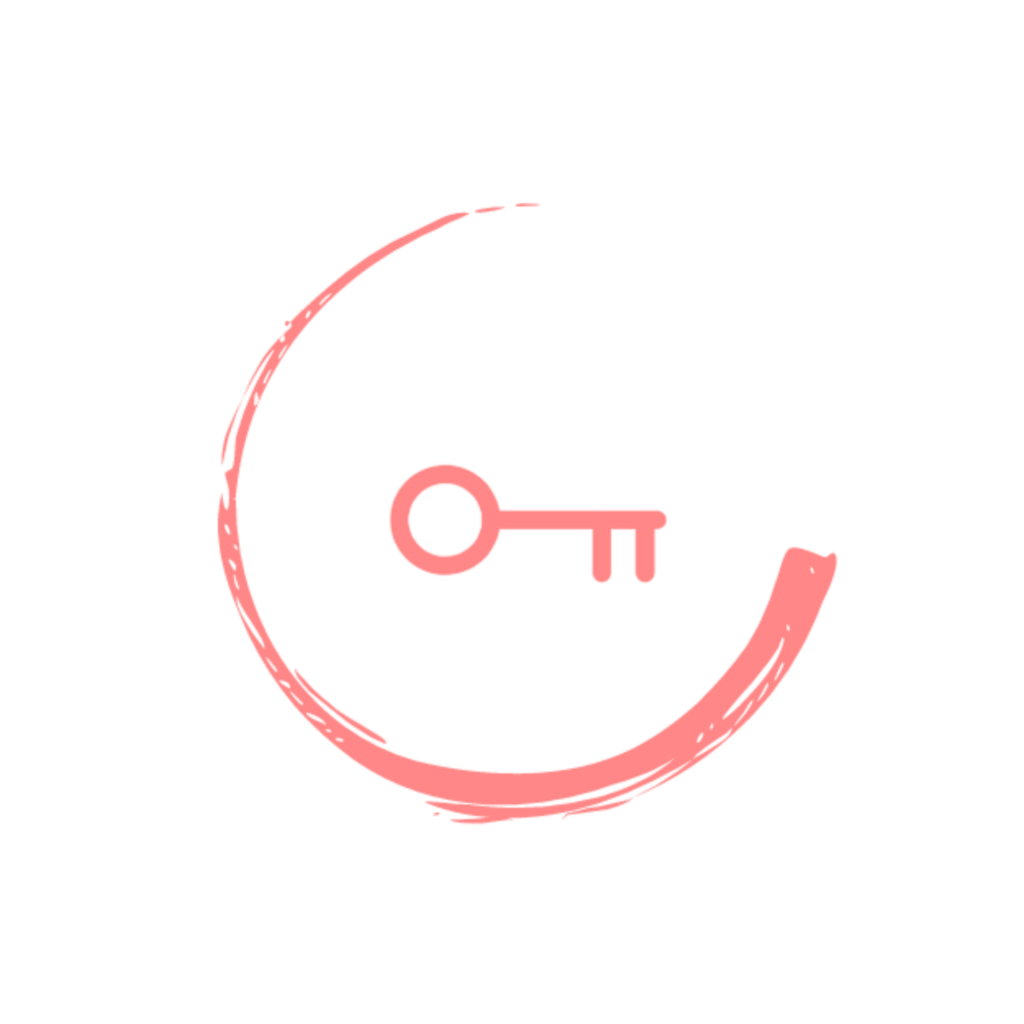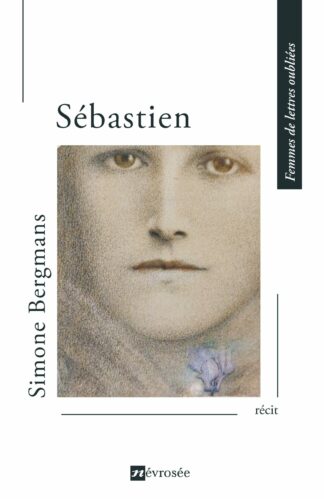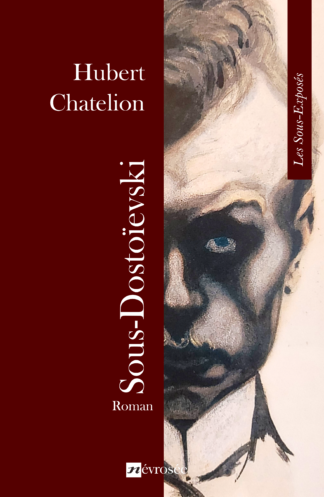J’étais pas vraiment faite pour ça, la vie.
Même si je me rappelle plus vraiment. J’avais une famille. Je crois. Ils disaient qu’il y avait eu un problème à ma naissance. Le père, surtout. Je me souviens qu’il avait le visage brûlé. La femme je me souviens plus bien. Je crois qu’elle était gentille. Je crois qu’elle est morte. Lui aussi il est mort. Ça je me souviens.
Ce que je sais, c’est que je me suis pas laissé faire.
Le hors champ, ça fout les boules. Rien doit dépasser.
On cherche une identité. Stable, unique. Étouffer ce qui hurle. Lutter. Cogner. Tout ce qu’on peut pour empêcher. Innommables innombrables. Insuffisants excédants. Mais ça transige pas. Ça s’étouffe pas. Ça s’accumule. Se tuméfie. Dans les tissus. Hématomes de l’âme. Les cases suffisent pas. Identité, jugement, ambition, confort, originalité, reconnaissance, vaine chirurgie. Maquillage inutile. Ecchymoses indélébiles.
Non, vraiment, j’étais pas faite pour ça, la vie.
C’est ça qu’il faudrait mettre sur ma tombe.
J’ai toujours été désordre. Ça s’est pas arrangé. Je suis devenue chiendent. J’ai essayé autre chose. Ailleurs. Hors territoire. Hors matière. Hors moi. Où personne devait jamais plus dégénérer sur ma carcasse. Où ma laideur et ma beauté ont cessé de rivaliser. Libre. Personne pour me faire chier avec ce que je devrais faire ou dire. Que c’est pas cohérent d’être à la fois comme ceci et comme cela. Que ça se fait pas.
Personne pour me dire ce que je suis, ce que je suis pas. Personne pour fustiger mes turgescences. Pas même moi.
De la fenêtre de ma chambre, on peut voir les vagues se fracasser contre la falaise. Hurler leur téméraire impatience. Danser leur inébranlable espérance.
Déferlement contradictoire. Vain. Libre.
À côté de vos habitats serviles et confortables, ma maison vous paraîtrait maussade, un peu étrange, un peu glauque peut-être. Brute. Tout y est tel qu’il est. Sans mensonge, ni prétention.
Pas vraiment une maison. Un gourbi, une cahute. Un endroit qui ne se soumet pas, ne transige pas. Insaisissable dans sa franchise. Magnifique dans sa laideur. Les murs offrent leurs failles et leurs entrailles. Sans honte. Le plâtre se fissure, les briques se découvrent. L’ambiance ne prétend jamais que les choses pourraient être autres que grises. Je ne sais pas qui a décidé que le gris était une couleur triste. C’est dans le gris qu’on trouve la vie. Pas dans le blanc ni dans le noir. Dans les plis entre les deux. J’ai longtemps cru que je l’avais compris. Parce que je l’avais compris avec ma tête. Quelle prétention. Que peut-on comprendre avec sa tête? On vit rien avec sa tête. La tête, c’est juste bon pour les équations mathématiques. Même si elle prétend le contraire, pour vous embrouiller.
Je veux pas que vous salissiez ma maison de vos images immondes, artificielles et conventionnelles. C’est chez moi.
Je suis revenue qu’une seule fois. Il y a longtemps. Quand elle est morte. Je pensais qu’elle viendrait avec moi.
Je sais pas trop ce que je fous là. J’erre parmi ces gens qui se croient seuls au monde. Qui dérangent ma propre suffisance. Je voudrais leur fracasser le crâne. Avec violence. Je voudrais qu’ils se taisent. Qu’ils disparaissent. Je les déteste. Je les déteste tous. Je les comprends pas. Je les comprends trop. Ils pensent qu’à eux, même quand ils prétendent le contraire. Ils brisent l’harmonie avec leurs petites individualités. Ils le font pas exprès. Je le sais. C’est pas une excuse. Fainéantise. Égoïsme paresseux doublé d’une paresse égoïste. Et je peux pas m’empêcher de leur en vouloir. Même si après, je m’en veux de leur en vouloir. On en sort pas.
Je me souviens de ces rues, aux âges et aux histoires qui se superposent. Mais je les reconnais pas. Comme dans ce cauchemar où mes yeux refusent de s’accorder.
Ici, le vide de ma tête est différent. Plus bruyant. Il crache sa merde dans mes oreilles.
Chapitre 1
Catherine, je l’aime bien. Je l’aime bien parce qu’elle me fait poiler. Elle est pas sympa. Enfin, c’est pas vraiment qu’elle est pas sympa. Elle est pas bénévole à la Croix Rouge, c’est sûr, mais elle est pas méchante non plus. C’est juste qu’elle est un peu cassante. La langue qui pique. Le cœur plus sur les lèvres que sur la main. On met son cœur où on peut. Ça change des emmerdeuses, jamais contentes, capricieuses, exclusives, irascibles, inconstantes, romantiques. Romantiques genre magma spongieux qui sort des tripes. De la boue qui colle et qui pue. Aujourd’hui je crois qu’on dirait : en mode dégoulinant. À chaque époque sa poésie. Enfin, je dis aujourd’hui, mais Aujourd’hui, on sait jamais vraiment où il est. Il fait que se balader entre hier et demain, sans qu’on sache vraiment d’où il vient ni où il va.
J’ai été comme ça. Victime fade au cœur filé. Filé, comme des bas. On peut plus rien faire avec des bas filés. Avec le cœur c’est pareil. Y a plus qu’à le jeter. Même moi, ça m’a donné envie de gerber. C’est aussi pour ça que je me suis barrée. Je me supportais plus. Pas si facile de se défaire de soi. Y a des gens qui vont au bout du monde. Font des kilomètres, affrontent mille dangers, et quand ils se retrouvent seuls dans la pampa, qu’il reste plus que ce je encombrant, ils comprennent que c’était la seule chose qu’ils essayaient de fuir. C’est moche. Heureusement que ça m’est pas arrivé. Je sais pas ce que j’aurais fait. Parce que j’aurais même pas pu me suicider. Et quand on peut plus se suicider, reste plus beaucoup d’espoir.
Je m’égare. À force de vivre au milieu des vagues, j’ai pris l’habitude de me laisser emporter. Moi aussi j’oublie souvent d’où je viens et où je vais. Surtout, j’ai arrêté de trouver ça important.
Je vous parlais de Catherine. Elle est mince. Enfin, moi je dis, quand je peux faire le tour de la taille d’une gonzesse avec les mains, c’est plus de la minceur, c’est de la carence. Vaut toujours mieux un peu trop que pas assez. Dans la famille, on a plutôt la peau sous que sur les os. Même si, pour moi, c’est plus vraiment un problème.
Mais Catherine mange beaucoup de carottes, alors elle a pas le teint blafard et terne qu’ont souvent les gens qui manquent de vitamines. Petit rituel de survie pour pas se laisser aspirer par l’angoisse : carottes-jogging. J’aurais peut-être dû essayer. J’ai toujours eu le teint terne. Pas gris. Terne. Faut dire qu’à mon époque, on en trouvait pas beaucoup des carottes. On pouvait déjà être content quand on trouvait de vieilles patates pourries.
Catherine a les yeux bleus. Très bleus, avec de longs cils et les paupières très dessinées. Et les cheveux blonds, légèrement cendrés. Couleur effacée. Couleur belge y paraît. Longs. Mi-longs peut-être. C’est difficile à dire, parce qu’ils sont toujours enfermés dans un élastique serré contre son crâne. Elle aime pas trop ses cheveux. Trop plats. Filasses. Ils manquent de caractère. Comme si la langue avait tout absorbé. À croire qu’il en restait plus assez pour les cheveux. Peut-être que si ses cheveux avaient eu autant de caractère que sa langue, ça aurait été trop. En tout cas, ils lui ressemblent pas assez pour qu’elle les montre, ses cheveux.
Elle ne porte presque jamais de jupes, toujours des pantalons. Avec des talons. Hauts et fins, comme des spaghettis. Et fermes. Comme des pics à glace. Sur les os et les talons aiguilles, ça tombe bien les pantalons. Avec des chemisiers fluides. Pas trop de variations dans les tons. Comme ça elle peut tout mélanger sans se casser la tête. S’habiller les yeux fermés ou en pensant à ses dossiers. Elle n’a pas vraiment d’amis, pas beaucoup de loisirs, pas de passion, pourtant, elle n’a jamais le temps.
Elle est architecte. Très compétente. Bosseuse. Elle est sur la liste des experts judiciaires. Elle est pas toute jeune, mais quand même, à son âge, c’est assez rare. Comme elle en veut toujours plus, elle envisage de se présenter aux élections du Conseil National de l’Ordre des Architectes. Rien que le nom ça donne envie de dormir. J’ose pas imaginer leurs réunions. Ça doit être l’ambiance. Du genre où on discute des heures sur la définition d’un mot imprononçable qui est même pas au dictionnaire. Du genre à évaluer la qualité d’une discussion à son degré de pénibilité. Comme si plus c’était chiant, plus c’était intelligent. J’ai jamais compris ça. Je crois que je comprends pas grand-chose en fait. En général je veux dire. Et en même temps, j’ai l’impression que je comprends tout. Je suis toujours coincée un peu entre les deux. C’est fatiguant. Comme dans l’expression : avoir le cul entre deux chaises. C’est un peu cliché. Je sais. On aime pas trop les clichés, parce qu’ils ont mis trop de gens d’accord. C’est mal vu. Moi je les aime bien. Ils prétendent rien. Rien de plus que ce qu’ils sont. Et puis, un cliché, c’est toujours un peu une invitation. Une invitation à se bouger. Comme un signal routier qui vous indique de prendre une déviation. Ça permet de réfléchir. De voyager.
En tout cas, on dit que Catherine a des chances d’être élue, parce qu’elle est assez bien mise avec le Président du conseil au nom qui fait dormir. C’est un ami de l’oncle Jean-Claude. Ils se sont connus dans un club de chasse. Pas Catherine et le Président. Le Président et Jean-Claude. Et pour le Président, cette amitié justifie qu’il adopte avec Catherine le même comportement paternaliste que Jean-Claude. À la limite de la condescendance. Il se targue sans doute de l’initier au monde. Catherine le déteste. S’il n’était pas Président, elle lui foutrait la main dans la gueule ou le genou dans les couilles. Peut-être les deux. Elle sourit, rien que d’y penser, même si elle ne s’y autorise pas souvent.
Elle habite seule au dernier étage d’un immeuble dans les quartiers chics de Bruxelles. Spacieux, lumineux, moderne et surtout dépouillé, son appartement. Les murs et les meubles blancs, vierges. Tout ce qui pouvait être encastré l’a été. Pas de livre, pas de photo, pas de plante, pas de bougie (pas beaucoup de gens non plus). Rien d’apparent, sauf une peinture pendue à un mur, dans le salon, en face du canapé. Une toile blanche, lacérée à plusieurs reprises, dans tous les sens. Reproduction d’un tableau de Fontana. Artiste argentin du début du vingtième siècle. Art moderne avec sûrement un nom bizarre pour se distinguer. Genre Art spatial de l’informe ou un truc comme ça.
La première fois que Catherine avait vu ce tableau (le vrai), un jour, alors qu’elle était encore étudiante et qu’elle déambulait un peu par hasard dans une galerie, tout s’était figé autour d’elle. Les gens, les toiles, les murs. Liquéfiés. Une faille informe, volatile, avait parcouru son corps. Elle avait tenté de la retenir. De la pénétrer en fixant la toile avec insistance, mais elle s’était évaporée, laissant tout de même une lourde empreinte, quelque part entre le cœur et le cerveau. Aussi incompréhensible que le tableau lui-même.
Bien qu’elle n’aime pas les choses qu’elle ne comprend pas, en emménageant dans son appartement, elle y a repensé, pour la décoration. Il lui a fallu un certain temps pour le retrouver, parce qu’aucun des tableaux de Fontana ne ressemble à l’empreinte laissée dans sa mémoire. Dans sa mémoire, les lacérations sont rouge sang. Et un tableau avec des lacérations comme ça, Fontana n’en n’a jamais peint (je sais pas si pour Fontana on doit dire peindre, sculpter, déchirer, lacérer ou profaner).
Ça l’avait beaucoup irritée, ce tableau à l’incompréhensibilité obsédante qui avait disparu. Parce qu’il devait avoir disparu. Il ne pouvait pas ne pas avoir existé. D’ailleurs il existe, dans sa tête.
Elle y repense souvent. C’est peut-être pour ça qu’elle a pendu son pastiche au mur. Une manière inconsciente de se venger. Parce que après tout, les tableaux aussi on les tue quand on les pend. Et, au fond, tout le monde le sait, même si personne n’en parle.
Son bureau est situé sur le même boulevard que son appartement. Elle pourrait s’y rendre à pieds, mais y va toujours en voiture. Peut-être que, si elle n’avait pas de garage, elle irait à pieds. Peut-être pas, parce que entre les chantiers qu’elle surveille, et ceux qu’elle expertise, elle bouge beaucoup. Si elle devait chaque fois repasser chez elle chercher sa voiture, ça lui ferait perdre trop de temps, et Catherine n’aime pas perdre son temps.
Elle a récemment engagé une assistante : Juliette. Juliette a de faux ongles qu’elle peint de toutes les couleurs et qui cognent le clavier de son ordinateur quand elle écrit. Elle porte des robes bizarres, pleines de motifs bigarrés aussi bruyants que ses ongles. Catherine n’aime pas le bruit non plus.
Il est 9h, elle devrait arriver. Parce que 9h, c’est l’heure où elle arrive au bureau tous les matins. Elle a ses petites habitudes. Et avec l’âge, les habitudes deviennent des nécessités.
Un type, genre bûcheron qui aurait troqué ses bottes, son pantalon crotté et sa chemise à carreaux contre des mocassins couleur cognac, un pantalon bleu marine et une chemise bleu clair (une sorte de gentleman bûcheron quoi) feuillette des magazines dans la salle d’attente. Je dis feuillette, parce que vu la vitesse à laquelle il tourne les pages, il ne doit pas avoir le temps de lire grand-chose. Ou alors il est vachement bastoche le gars.
La voilà. Elle est un peu énervée. Parce que Juliette lui a fixé un rendez-vous à 9h. Ça ne lui laisse pas le temps de se poser. Prendre un café avec beaucoup de lait, sans sucre et surtout sans se presser. Le seul moment de la journée où elle n’a pas l’impression d’être sur le point de rater son train (même si elle le prend jamais, le train). Un matin gâché, ça peut lui foutre en l’air toute la journée. Et non, elle n’aurait pas pu venir plus tôt. Elle ne va tout de même pas changer ses habitudes, juste parce que cette petite dinde lui a foutu un rendez-vous à 9h !
Catherine demande à Juliette d’aller lui chercher un café et Juliette propose d’installer le gentleman bûcheron, qu’elle appelle le rendez-vous, dans la salle de réunion. Le visage de Catherine se fige :
— Il est 9h ? Allez me chercher mon café et faites entrer le rendez-vous à l’heure fixée : pas 8h59, pas 9h01, 9h00.
Tête baissée, les mains l’une contre l’autre, Juliette s’exécute. Catherine la rappelle. A-t-elle commandé les nouveaux téléphones ? Parce que c’est un bureau d’architecte ici, et ces téléphones obsolètes avec leurs fils rigides et récalcitrants c’est juste bon pour un cabinet de curiosités.
Le gentleman bûcheron qui a entendu qu’il n’était pas encore 9h00 décide de se rendre aux toilettes. Lui aussi il a ses petits rituels. Il est un peu agité. Il n’est pas un client ordinaire. Ça ne sera pas facile. Ce côté de la famille est réputé pour son sale caractère, et d’après ce qu’il vient de voir, c’est mérité. Elle n’a pas l’air commode. Il pourrait encore changer d’avis. S’en aller. Mais il est décidé.
Il entre aux toilettes et s’installe. Quand il se relève, il hésite. Voudrait se retourner, se pencher sur la cuvette comme il le fait d’ordinaire. Quelque chose le retient. C’est qu’il n’est pas chez lui. La gêne guète. Il l’écarte d’un mouvement de tête et pivote le torse en tordant légèrement la nuque pour contempler sa performance. Organique, certes, mais une création toute de même. Il aime quand elle se tient en un seul bloc sans se décomposer. Un Perfecto. Que son corps puisse produire quotidiennement des choses pareilles l’impressionne. Il imagine mille petites cellules ouvrières transporter chacune son petit ouvrage pour les agglutiner ensemble et en faire cette mosaïque compacte, solide. Paraît que le dégoût de la merde est une chose acquise. En contemplant son œuvre, il pense souvent à ce gars qui est devenu célèbre avec son pot de chambre. Il n’arrive jamais à retenir son nom. Pas le nom du pot, le nom du mec. Il se demande si ça a un rapport. Il se promet chaque fois de se renseigner, puis il oublie.
Il se sent plus léger. Comme si ses angoisses gisaient dans le fond de la cuvette avec son Perfecto.
Il se regarde dans le miroir en se lavant les mains. Les épaules carrées, le cou large comme le tronc d’un séquoia, la peau mate, les cheveux noirs, bouclés, beaucoup de cheveux noirs bouclés, de grands yeux sombres, tranchés. Son physique impressionne. Il le sait. Surtout quand il se tait. Pour conserver toute sa force, il doit parler le moins possible. C’est normal. C’est la nature qui veut ça. Les gens ont l’air plus sage dans le silence, quand ils évitent la nervosité de l’effusion. Et ça ne vaut pas que pour les hommes. Imaginez que les arbres se mettent à parler frénétiquement comme les humains. Ils seraient tout de suite moins impressionnants. Parce que parler, c’est toujours tenter de se justifier. Et peut-être que si les arbres semblent si forts, c’est qu’ils n’ont pas besoin de cette folie pour exister.
Le gentleman bûcheron s’essuie les mains, se regarde encore quelques secondes dans le miroir et retourne s’asseoir dans la salle d’attente. À peine revenu des toilettes, Juliette vient le chercher et l’emmène dans la salle de réunion où il s’assied dans un des sièges en cuir noir. Le dos droit, les mains posées sur les genoux, le visage amolli par un sourire mi béat mi benêt. Le fauteuil pivote sur lui-même. Il adore ça et ne peut pas s’empêcher de le faire tourner en attendant Catherine qui le rejoint une dizaine de minutes plus tard. Quand elle arrive, il s’immobilise, gêné, tandis qu’elle s’installe en face de lui sans le regarder.
Il se présente. Les choses mettent un certain temps à s’accorder dans la tête de Catherine. Comme quand on n’arrive pas à reconnaitre quelqu’un et que le cerveau passe en revue une série de possibilités spatio-temporelles. Des images qu’il fait défiler très vite. Comme le fil d’actualités des réseaux sociaux. Un fil d’actualités inversé en quelque sorte. Parce qu’ici, il s’agit de trouver une concordance, créer une connexion et faire émerger du sens.
Le gentleman bûcheron, c’est Émeric, son cousin. Cousin qu’elle n’a jamais vu, parce que leurs mères respectives se détestent. D’ailleurs, elle pensait qu’il s’appelait Julien. Émeric et sa mère sont ce qu’on a coutume d’appeler des parias. Jamais invités aux fêtes de famille. Jamais invités tout court. Nulle part. On fait tout ce qu’on peut pour les oublier, sauf quand il s’agit de les critiquer. La mère de Catherine appelle Abigail la sorcière. La voleuse parfois. Et quant à Émeric, elle ne l’appelle pas. Pour elle, il n’existe pas. Jean-Claude est plus subtil mais pas pour autant plus tendre. Catherine a toujours pensé qu’ils en voulaient à Abigail d’avoir hérité de la maison familiale. Même si sa mère lui a souvent répété qu’elle n’aurait jamais voulu de cette satanée bicoque de toutes façons. Mais probablement qu’elle aurait bien voulu l’argent de la vente de la satanée bicoque. Les histoires de famille, ça n’a jamais vraiment été son truc à Catherine. Elle ne voit pas pourquoi, sous prétexte que les gens sont de votre famille, on devrait fourrer le nez dans leurs culottes sales. Catherine n’a d’ailleurs jamais eu très envie de s’y fourrer tout court. La famille, c’est pas toujours facile. C’est souvent plus sordide que n’importe quel fait divers, et surtout, ça grouille dans la vie des gens. Ça couvre leurs corps d’une merde qu’ils sont seuls à sentir. Dès qu’elle a pu s’y soustraire, à la famille, elle l’a fait. Seul Jean-Claude a su garder suffisamment d’ascendant sur elle pour qu’elle se contraigne à le voir de temps en temps. Elle le voit même plus souvent que sa mère. Enfin, jusqu’à ce qu’on lui diagnostique l’Alzheimer, à sa mère. Catherine n’a pas envie de penser à sa mère. Et si ce mec, ce prétendu cousin n’était pas là devant elle, elle n’y penserait pas. C’est de sa faute. C’est pour ça que la famille vaut mieux éviter.
Déjà qu’elle n’a pas pu prendre son café à l’aise. Et puis il lui plaît pas. Il l’énerve avec son air de guimauve bétonnée. Lui, son cousin ? Impossible. D’ailleurs, où a-t-il été chercher ces cheveux charbon et ces yeux ébène ? Tranchés, entêtés. Incapables d’exprimer la moindre nuance. Une couleur si foncée, c’est une agression. Dans la famille, personne n’a les cheveux si noirs et les yeux si sombres. Tout le monde a les cheveux belges. Non, ce type ne peut pas être son cousin. Évidemment, pour Catherine, Émeric est un inconnu. Elle ne peut pas ressentir la moindre familiarité avec cet étranger. Je suppose que c’est ce genre d’étrangeté qui a pu un jour pousser mère et fils à devenir amants. Pourtant il nous arrive de ressentir un sentiment d’intimité avec des personnes qui nous sont totalement inconnues. Ça m’est arrivé quand j’ai rencontré Sarah. Dès que je l’ai vue, j’ai su que nous serions comme des sœurs. Je l’ai senti instantanément. Instinctivement et de manière certaine. J’aurais pu rencontrer une sœur cachée et inconnue que ça m’aurait jamais fait le même effet. Je me demande à quoi ça tient des choses pareilles.
Émeric explique que la maison familiale, qui est classée (la satanée bicoque), doit être rénovée. Il prétend avoir retrouvé Catherine par hasard, en cherchant un architecte.
Elle a beaucoup entendu parler de cette maison. Pas vraiment une maison. Un hôtel de Maître. Un de ces colosses qui se dressent autour de la place Flagey à Bruxelles et qui se vendent avec plein de chiffres arrogants même si la plupart sont des zéros. Catherine passe régulièrement devant l’immeuble. Il est assez impressionnant, et aussi effrayant que tout ce qu’on lui a raconté à son sujet. À mi-chemin entre la forteresse et la maison hantée. Les longues traînées de crasse qui dégoulinent sur la façade n’y sont probablement pas pour rien. Les vitres sombres non plus. Tellement obscures qu’on a toujours l’impression d’y voir des spectres s’y faufiler.
C’est vrai que cette baraque a bien besoin d’être rénovée. Et même si elle est angoissante, c’est une belle opportunité pour un architecte. Catherine aurait accepté sans hésiter. Mais l’idée d’un chantier familial, avec le cousin et la tante renégats dans les pattes la révulse. S’il ne lui avait pas dit qui il était, elle aurait probablement accepté. Heureusement pour elle qu’il est honnête, parce qu’elle aurait fait le lien en voyant la maison. Et ça aurait été plus difficile de faire marche arrière.
Elle joue avec son stylo et prétend ne pas faire de travaux de rénovation. Émeric insiste un peu. La froideur de Catherine le déstabilise. Il déploie plusieurs arguments, essaie différentes techniques : trop de mots qui partent dans tous les sens et contredisent l’assurance de son corps, immobile et imposant. Il doute. Dérape.
Catherine, elle, a l’impression de sentir ses cheveux gonfler sur sa tête et ses terminaisons nerveuses s’agiter sous sa peau. Son corps appelle un appui pour soutenir son refus. À part un agenda chargé et un manque d’expertise en matière de bâtiments classés, elle ne trouve pas grand-chose. Elle tente de faire preuve de créativité en cherchant du côté de la déontologie. Invoque un conflit d’intérêts. Audacieux comme prétexte pour soulager un défaut d’intérêt. Malheureusement, il a l’air bien renseigné. Un architecte peut travailler pour sa famille.
Il est tenace. Pour s’en débarrasser, il va falloir céder quelque chose. Elle accepte d’aller voir la maison. Elle lui donnera son avis et lui renseignera un confrère. Émeric s’en contente. Pour lui c’est mieux que rien, pour elle, c’est mieux que tout.
Avant de partir, Émeric demande à Catherine des nouvelles de Suzanne. Elle lui répond qu’elle va bien. C’est pas que pour Catherine on va bien quand on a l’Alzheimer. C’est plutôt une façon de lui dire d’aller se faire foutre et d’éviter les questions et apitoiements.
C’est un gentil Émeric. La famille, c’est important pour lui. Il voudrait connaitre la sienne. Il n’a jamais compris cette mise au ban. Il a interrogé sa mère, souvent. Elle est toujours restée évasive. Prétendant qu’ils étaient juste trop différents. Quand il insistait, l’interrogeait sur ses relations conflictuelles avec sa sœur, elle répondait qu’elles n’avaient jamais été très proches, que Suzanne était, comme le reste de la famille, carriériste, légèrement arrogante et qu’à défaut d’affinités, elles s’étaient perdues de vue en grandissant. Elle nie toute animosité particulière entre elles. Il a aussi interrogé sa mère sur l’entreprise familiale. Il ne comprend pas pourquoi ils n’en font plus partie. Là encore, Abigail s’est contentée de lui répondre que c’est parce que le profit ne l’a jamais intéressée. Sa propre mère, la grand-mère d’Émeric ne s’y intéressait pas non plus. C’est elle qui a refusé de faire partie de l’entreprise. Suzanne le lui a toujours reproché d’ailleurs et a tout fait pour être réintégrée. Émeric a essayé de savoir si Suzanne était aussi en mauvais termes avec sa mère, mais Abigail persiste à prétendre que personne n’est en mauvais terme avec personne. Elle s’étonne qu’il insiste à voir des problèmes où il n’y en a pas. Elle ne comprend pas qu’on s’agite pour de si petites choses. Que les gens se fâchent, se disputent, se vexent. Pour elle, la vie est toujours belle, et la seule chose qui vaille la peine de sortir les armes, ce sont les droits de l’homme, les inégalités en tous genres, ça, ça vaut la peine de dépenser autant d’énergie. Le reste n’est que tracasseries de salon de thé.
Pourtant, il y a quelque chose. Émeric le sent. Il a réfléchi longtemps à la meilleure manière de reprendre contact avec sa famille. Sa cousine lui semblait un bon point d’entrée. Restait à trouver comment l’approcher. Évidemment, il a menti. Il a cherché Catherine avant de chercher un architecte. Quand il a découvert son métier, la maison en piteux état est devenue un excellent prétexte. Si Catherine avait été avocate, il se serait inventé un litige. Heureusement pour lui, ce n’est pas le cas, parce que je crois que les règles déontologiques des avocats sont plus strictes que celles des architectes et Catherine aurait eu un excellent argument pour refuser son affaire.